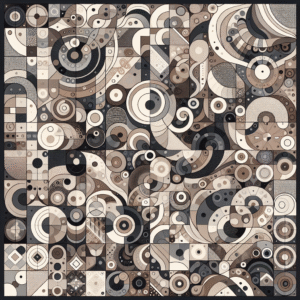Un dessin ou modèle représente bien plus qu’une simple création esthétique. Pour une entreprise, il constitue un actif stratégique, une part de son identité et une source de valeur économique. Comme tout actif, il peut cependant faire l’objet de mesures d’exécution forcée de la part d’un créancier cherchant à recouvrer une dette. La saisie d’un dessin ou modèle est une procédure technique, à la croisée du droit de la propriété intellectuelle et des voies d’exécution. Naviguer dans ce domaine requiert une compréhension fine des mécanismes en jeu, car ces actifs immatériels ne se laissent pas appréhender comme des biens matériels. Il est essentiel de connaître les règles qui gouvernent le large domaine des droits incorporels et leurs applications spéciales pour protéger ses droits, que l’on soit créancier ou débiteur.
Qu’est-ce qu’un dessin ou modèle ?
Avant d’aborder la mécanique de la saisie, il est indispensable de définir précisément ce que la loi protège sous le vocable « dessin ou modèle ». Il ne s’agit pas de l’idée abstraite derrière une création, mais bien de son incarnation formelle, de l’apparence visible d’un produit ou d’une partie de produit. Cette protection est un outil puissant pour les créateurs et les entreprises qui investissent dans le design.
Définition et critères de protection (CPI, Art. L. 511-1 & L. 511-2)
Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) définit le dessin ou modèle comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Cette définition, issue de l’article L. 511-1, est volontairement large. Elle peut couvrir des objets aussi variés que le design d’un meuble, la forme d’un flacon de parfum, le motif d’un tissu ou même l’interface graphique d’une application.
Pour bénéficier d’une protection juridique, cette apparence doit remplir deux conditions cumulatives fixées par l’article L. 511-2 du même code :
- La nouveauté : un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement, aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public. L’appréciation de la nouveauté est stricte.
- Le caractère propre : cette seconde condition, plus subtile, est remplie si l’impression visuelle d’ensemble que le dessin ou modèle suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué antérieurement. Il ne suffit pas d’une différence de détail ; l’objet doit se distinguer globalement des créations existantes.
Ces deux piliers garantissent que seuls les designs véritablement originaux et distinctifs accèdent à la protection conférée par le droit.
L’enregistrement à l’INPI : une condition essentielle (CPI, Art. L. 511-9)
En droit français, la naissance du droit privatif sur un dessin ou modèle est conditionnée par son enregistrement. C’est l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle qui pose ce principe : le droit est acquis par l’effet de l’enregistrement auprès de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI). Sans cette démarche formelle, la protection au titre du livre V du CPI n’existe pas.
Cet enregistrement public a une double fonction. D’une part, il confère au titulaire un monopole d’exploitation sur l’apparence du produit pour une durée de cinq ans, renouvelable par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans. D’autre part, et c’est ce qui nous intéresse ici, il matérialise le droit. Il le fait exister juridiquement en tant qu’actif identifiable, avec un numéro d’enregistrement, un titulaire désigné et une date de création. C’est cet enregistrement qui rend le droit « saisissable » en lui donnant une existence objective et opposable aux tiers, y compris aux créanciers.
La saisissabilité des dessins et modèles : un droit reconnu mais sans procédure dédiée
Un dessin ou modèle enregistré est un droit de propriété incorporelle. À ce titre, il a une valeur patrimoniale et entre dans le gage général des créanciers du titulaire du droit. Sa saisie est donc possible, mais elle obéit à un régime qui n’est pas toujours évident à première vue, faute de dispositions spécifiques.
Cadre juridique et l’absence de texte spécial (comparaison avec marques/brevets)
Le principe est simple : tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur. Les dessins et modèles, en tant qu’actifs valorisables, n’échappent pas à cette règle. Le droit de la propriété intellectuelle organise d’ailleurs lui-même des procédures de saisie spécifiques pour d’autres actifs, comme les brevets d’invention ou les marques.
Cependant, une particularité notable du régime des dessins et modèles est l’absence de texte spécial dans le Code de la propriété intellectuelle organisant leur saisie-exécution. Alors que le CPI contient des dispositions détaillées pour la saisie des brevets et des marques, il reste silencieux pour les dessins et modèles. Cette lacune législative ne signifie pas que la saisie est impossible. Elle implique simplement qu’il faut se tourner vers le droit commun des voies d’exécution. La procédure applicable est donc la saisie des droits incorporels, régie par les articles L. 231-1 et suivants et R. 232-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE).
Il est fondamental de ne pas confondre cette saisie-exécution avec une autre mesure portant un nom similaire : la saisie-contrefaçon. Cette dernière n’est pas une voie de recouvrement de créance, mais une procédure probatoire permettant au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de faire constater une atteinte à son monopole et de rassembler les preuves d’une contrefaçon.
Conséquences de la saisie : indisponibilité et droits pécuniaires
Une fois l’acte de saisie signifié, il produit des effets immédiats et contraignants pour le débiteur titulaire du droit. La conséquence principale est l’indisponibilité du dessin ou modèle saisi. Concrètement, le débiteur perd le droit de disposer de son actif. Il ne peut plus le vendre, le céder à titre gratuit, l’apporter en société, le donner en gage ou l’abandonner. Tout acte de disposition accompli en violation de la saisie serait inopposable au créancier saisissant.
De plus, la saisie ne porte pas uniquement sur le titre de propriété lui-même, mais également sur les « fruits » que cet actif génère. Il s’agit de l’ensemble des revenus pécuniaires qui découlent de son exploitation, comme les redevances (royalties) versées par un licencié. À compter de la saisie, ces sommes doivent être versées entre les mains du commissaire de justice et non plus au débiteur. Le licencié qui continuerait de payer le titulaire du droit s’exposerait à devoir payer une seconde fois.
Procédure de saisie des dessins et modèles
La mise en œuvre de la saisie suit les étapes définies par le Code des procédures civiles d’exécution pour les droits incorporels. La procédure est précise et implique l’intervention d’un commissaire de justice et d’un tiers bien identifié : l’INPI.
Le tiers saisi : l’Institut national de la propriété industrielle
La saisie de droits incorporels s’effectue par la signification d’un acte à un « tiers saisi », c’est-à-dire la personne qui « détient » le droit pour le compte du débiteur. Dans le cas d’un dessin ou modèle, ce tiers est l’INPI. L’institut n’est pas propriétaire du droit, mais il est le dépositaire du registre national qui officialise son existence et son titulaire. C’est donc auprès de l’INPI que le commissaire de justice va signifier l’acte de saisie, rendant ainsi la mesure opposable à tous.
L’INPI a alors l’obligation de communiquer au créancier l’ensemble des informations qu’il détient sur le droit saisi : existence, identité du titulaire, éventuels actes de cession ou de nantissement déjà inscrits, etc. Cette réponse est capitale pour que le créancier puisse apprécier la valeur et la situation juridique de l’actif qu’il vient de saisir.
Les formalités de la saisie et de la dénonciation au débiteur
La procédure débute par un exploit d’huissier (aujourd’hui commissaire de justice) signifié à l’INPI. Cet acte doit contenir, à peine de nullité, un certain nombre de mentions obligatoires, dont l’identification du créancier, le titre exécutoire, le décompte des sommes dues, et bien sûr l’identification précise du dessin ou modèle saisi (par son numéro d’enregistrement).
Une fois la saisie pratiquée, le créancier dispose d’un délai très court de huit jours pour la « dénoncer » au débiteur. Cette dénonciation, également réalisée par acte de commissaire de justice, informe le débiteur de la mesure prise à son encontre. L’acte de dénonciation doit lui rappeler qu’il dispose d’un délai d’un mois pour contester la saisie devant le juge de l’exécution du lieu où il demeure. Passé ce délai, le débiteur est réputé avoir acquiescé à la saisie, et le créancier peut alors demander la vente du droit.
La vente forcée des dessins et modèles saisis
La finalité d’une saisie-exécution est de transformer l’actif saisi en liquidités pour désintéresser le créancier. Si le débiteur ne règle pas sa dette, le créancier peut provoquer la vente forcée du dessin ou modèle. Cette vente peut prendre deux formes.
La vente amiable : conditions et limites
Le Code des procédures civiles d’exécution privilégie, lorsque c’est possible, une solution moins brutale que l’enchère publique. Le débiteur peut ainsi demander au juge de l’exécution l’autorisation de procéder lui-même à la vente du droit saisi, de gré à gré. Il dispose d’un délai d’un mois après la dénonciation de la saisie pour trouver un acquéreur et proposer les conditions de la vente. Cette solution est souvent préférable car elle permet généralement d’obtenir un meilleur prix qu’une vente aux enchères, préservant ainsi les intérêts du débiteur comme du créancier.
Le juge fixera alors un prix minimum en deçà duquel la vente ne pourra pas se faire et déterminera le délai dans lequel la vente doit être conclue. Le montant de la vente sera consigné et servira à payer le créancier saisissant.
L’adjudication : cahier des charges et publicité
En l’absence de vente amiable, soit parce que le débiteur ne l’a pas sollicitée, soit parce qu’il n’a pas trouvé d’acheteur dans les conditions fixées, le créancier peut engager la procédure de vente forcée aux enchères publiques (adjudication). Cette vente est organisée sous le contrôle du juge.
Le créancier doit faire rédiger un cahier des charges. Ce document essentiel décrit le bien saisi, retrace l’historique de la procédure et fixe les conditions de la vente. Il est consultable par tout acheteur potentiel. La vente doit ensuite faire l’objet d’une publicité suffisante pour attirer les enchérisseurs et garantir la transparence de la procédure. Cette publicité se fait par voie d’annonces dans des journaux d’annonces légales et, selon la nature du droit, dans des publications professionnelles spécialisées.
Le transfert de propriété et l’enregistrement post-vente
Que la vente soit amiable ou forcée, le transfert de propriété s’opère au profit de l’acquéreur. Dans le cas d’une adjudication, le jugement ou le procès-verbal de l’adjudication constitue le titre de propriété du nouvel acquéreur. La dernière étape, et non la moindre, consiste à rendre ce transfert opposable aux tiers. Pour ce faire, l’acquéreur doit impérativement faire inscrire son titre de propriété au Registre national des dessins et modèles tenu par l’INPI. Sans cette inscription, l’ancien propriétaire pourrait, aux yeux d’un tiers de bonne foi, apparaître toujours comme le titulaire légitime du droit.
La saisie et la vente d’un dessin ou modèle sont des procédures complexes qui exigent de la méthode et une connaissance pointue des règles applicables. Chaque étape, de la signification de l’acte à l’inscription du transfert, recèle des pièges potentiels. L’assistance d’un avocat est vivement recommandée pour sécuriser le recouvrement de la créance ou, à l’inverse, pour défendre les droits du débiteur saisi. Pour une analyse et un accompagnement dans vos démarches liées à la saisie de droits incorporels et de propriété intellectuelle, contactez notre cabinet.
Sources
- Code de la propriété intellectuelle
- Code des procédures civiles d’exécution