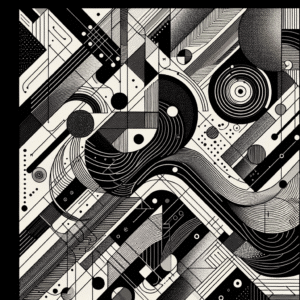Recevoir une notification de saisie sur son salaire est une épreuve qui peut déstabiliser un salarié comme un dirigeant d’entreprise. Cette mesure, qui touche directement aux revenus du travail, n’est cependant pas arbitraire. Elle est strictement encadrée par la loi pour équilibrer les droits du créancier à recouvrer sa créance et la nécessité de protéger le débiteur. Comprendre le fonctionnement de cette procédure d’exécution forcée, une des plus courantes, est le premier pas pour se défendre efficacement. Bien qu’elle s’inscrive dans le cadre plus large des mesures de saisie en droit français, elle obéit à des règles spécifiques qui mêlent droit du travail et procédures civiles. Face à la complexité des démarches et des délais, l’intervention d’un avocat peut s’avérer déterminante pour faire valoir vos droits. Notre cabinet propose un accompagnement juridique pour vos procédures d’exécution, en veillant à la protection de vos intérêts à chaque étape.
Qu’est-ce que la saisie des rémunérations du travail ?
Définition et cadre légal (code du travail, code des procédures civiles d’exécution)
La saisie des rémunérations est une procédure judiciaire qui permet à un créancier de faire prélever une partie des revenus de son débiteur directement à la source, c’est-à-dire auprès de son employeur. Cette mesure d’exécution forcée est mise en place lorsqu’un débiteur ne s’acquitte pas volontairement de sa dette. L’employeur, qualifié de « tiers saisi », a alors l’obligation légale de retenir une fraction du salaire de son employé et de la verser au greffe du tribunal, qui se chargera de la transmettre au créancier.
Son régime est défini par deux codes principaux. Le Code du travail (articles L. 3252-1 et suivants, et R. 3252-1 et suivants) fixe les conditions de fond, notamment les types de rémunérations concernées et les fractions saisissables. Le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) régit quant à lui les aspects procéduraux généraux des voies d’exécution, assurant le cadre dans lequel la saisie doit se dérouler.
Différence avec d’autres types de saisies (ex: saisie-attribution)
Il est important de ne pas confondre la saisie des rémunérations avec d’autres mesures d’exécution. La principale différence réside dans son caractère continu et sa nature judiciaire. Contrairement à la saisie-attribution, qui est une mesure instantanée pratiquée par un commissaire de justice sur un compte bancaire pour en saisir le solde disponible à un instant T, la saisie des rémunérations s’étale dans le temps. Elle porte sur des flux de revenus futurs et s’applique chaque mois jusqu’à l’apurement complet de la dette.
De plus, la saisie-attribution est une procédure extrajudiciaire (sauf en cas de contestation), alors que la saisie des rémunérations est entièrement judiciaire. Elle est initiée et contrôlée par un juge, ce qui offre des garanties procédurales spécifiques au débiteur, notamment à travers une audience de conciliation.
Les conditions de mise en œuvre de la saisie des rémunérations
Le titre exécutoire : une obligation impérative
Un créancier ne peut pas décider seul de pratiquer une saisie sur salaire. Il doit impérativement détenir un « titre exécutoire ». Il s’agit d’un acte juridique officiel qui constate l’existence d’une créance de manière incontestable et ordonne son paiement. Sans ce document, aucune saisie ne peut être engagée. L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution liste les différents titres exécutoires, parmi lesquels on trouve principalement :
- Les décisions de justice ayant force exécutoire (jugement de conseil de prud’hommes, jugement civil, arrêt de cour d’appel, etc.).
- Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire, comme un acte de prêt immobilier.
- Les titres délivrés par les personnes morales de droit public (avis de mise en recouvrement du Trésor Public, contraintes des organismes sociaux comme l’URSSAF).
- Les titres délivrés par un commissaire de justice en cas de chèque impayé.
La créance constatée par ce titre doit être liquide (son montant est déterminé ou déterminable) et exigible (le terme pour payer est échu).
Les seuils de saisissabilité des salaires (quotités insaisissables)
Afin de garantir au débiteur un minimum vital pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, la loi a établi qu’une partie de la rémunération est insaisissable. Le calcul de la part saisissable est fixé par un barème progressif, révisé chaque année, qui prend en compte le niveau de rémunération et le nombre de personnes à charge du débiteur. Plus le salaire est élevé, plus la fraction saisissable augmente.
Il existe une fraction du revenu qui est, dans tous les cas, « absolument insaisissable ». Son montant est équivalent à celui du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour une personne seule. Même un créancier d’aliments ne peut saisir cette somme. Au-delà de cette protection de base, il est important de savoir que d’autres revenus et biens insaisissables existent et constituent une protection fondamentale du patrimoine du débiteur.
Les créances concernées (salaires, pensions, etc.)
La notion de « rémunération » est entendue au sens large par la loi. La saisie peut porter non seulement sur le salaire de base, mais aussi sur ses accessoires, tels que les primes, les gratifications, les avantages en nature ou les indemnités de congés payés. La procédure de saisie des rémunérations est également applicable, dans les mêmes limites, à d’autres types de revenus de remplacement. Sont notamment concernés :
- Les pensions de retraite et d’invalidité.
- Les allocations d’aide au retour à l’emploi (ARE) versées par Pôle emploi.
- Les indemnités journalières de maladie et d’accident du travail.
En revanche, certaines prestations sociales sont totalement insaisissables. C’est le cas du Revenu de Solidarité Active (RSA), de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), ou encore de la prime d’activité.
La procédure de saisie des rémunérations
La saisine du juge de l’exécution (JEX) : compétence et formalités
La procédure de saisie des rémunérations est obligatoirement portée devant le juge de l’exécution (JEX), qui est le magistrat compétent pour statuer sur l’ensemble des difficultés relatives à l’exécution forcée. Le juge compétent est celui du lieu où demeure le débiteur. Si ce dernier habite à l’étranger ou n’a pas de domicile connu, la compétence revient au juge du lieu de résidence de l’employeur.
Le créancier engage la procédure en déposant une requête au greffe du tribunal. Cette requête doit comporter un certain nombre d’informations obligatoires, notamment l’identité des parties, le décompte détaillé de la créance et une copie du titre exécutoire sur lequel se fonde la demande. Le greffe se charge ensuite de convoquer les parties à une audience.
L’audience de conciliation : rôle et enjeux
Avant d’autoriser la saisie, le juge convoque le créancier et le débiteur à une audience de conciliation. Cette étape, qui se déroule en chambre du conseil (sans public), est fondamentale. Son objectif n’est pas de juger l’affaire à nouveau, mais de tenter de trouver un accord amiable sur le règlement de la dette. Le juge peut ainsi aider les parties à négocier un plan de remboursement échelonné, que le débiteur s’engagerait à respecter.
Si un accord est trouvé, un procès-verbal de conciliation est dressé. Si le débiteur respecte ses engagements, la saisie est évitée. S’il ne les respecte pas, le créancier pourra demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle audience. Si aucune conciliation n’est possible, ou si le débiteur ne se présente pas à l’audience, le juge constate la non-conciliation. Il vérifie alors le montant de la créance et autorise la mise en place de la saisie.
Il est à noter qu’une jurisprudence récente (Civ. 2e, 2 mai 2024) a rappelé l’importance des informations préalables à cette audience : le créancier ne peut pas substituer un autre titre exécutoire à celui qu’il a joint à sa requête initiale, garantissant ainsi que le débiteur est informé précisément de la base des poursuites. De plus, une réforme importante (loi du 20 novembre 2023), qui entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 2025, prévoit de « déjudiciariser » cette procédure pour la confier aux commissaires de justice, le juge n’intervenant plus qu’en cas de contestation.
La notification à l’employeur (tiers saisi) et ses obligations déclaratives
Une fois la saisie autorisée par le juge, le greffe du tribunal notifie l’acte de saisie à l’employeur du débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception. À compter de cette notification, l’employeur devient un acteur clé de la procédure. Il a l’obligation, dans un délai de 15 jours, de fournir au greffe une déclaration contenant plusieurs informations essentielles :
- La nature du contrat de travail du débiteur et le montant de sa rémunération.
- L’existence éventuelle d’autres saisies déjà en cours sur le salaire de l’employé (saisie administrative à tiers détenteur, paiement direct de pension alimentaire, etc.).
L’employeur qui omet de faire cette déclaration ou qui effectue une déclaration mensongère s’expose à des sanctions, pouvant aller d’une amende civile à une condamnation à payer lui-même les sommes dues à la place de son salarié.
Les versements par l’employeur et leur suivi
Chaque mois, l’employeur doit calculer la fraction saisissable du salaire de son employé, en appliquant le barème légal. Il a ensuite l’obligation de verser cette somme au greffe du tribunal judiciaire. Il ne doit en aucun cas la verser directement au créancier. C’est le régisseur du greffe qui est chargé de recevoir les fonds et de les répartir entre le ou les créanciers. En cas de pluralité de créanciers, le greffe établit un plan de répartition pour distribuer les sommes au prorata des créances, en tenant compte des éventuels privilèges.
Protection du débiteur et contestations possibles
Les fonds insaisissables et le solde bancaire insaisissable (SBI)
La protection du débiteur ne se limite pas à la seule fraction insaisissable de sa rémunération. Au-delà des sommes insaisissables sur la rémunération elle-même, la loi a instauré une protection supplémentaire en cas de saisie sur un compte bancaire : le Solde Bancaire Insaisissable (SBI). Même si le salaire est versé sur un compte qui fait l’objet d’une saisie-attribution, la banque a l’obligation de laisser à la disposition du débiteur une somme équivalente au montant du RSA pour une personne seule. Ce mécanisme garantit que le débiteur conserve un minimum de ressources pour ses besoins essentiels, même en cas de cumul de procédures.
Les délais de paiement et l’aménagement de la dette
Le débiteur n’est pas passif dans la procédure. Il peut à tout moment, et notamment lors de l’audience de conciliation, solliciter du juge des délais de paiement, conformément à l’article 1343-5 du Code civil. S’il justifie de sa situation, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. L’octroi de tels délais a pour effet de suspendre la procédure de saisie. Cette possibilité est une voie importante pour aménager le remboursement de la dette et éviter une saisie prolongée.
Les recours contre la saisie (contestation de la créance, de la procédure)
Le débiteur peut contester la saisie sur plusieurs fondements. La contestation peut porter sur la validité de la créance elle-même (montant erroné, dette déjà payée, prescription acquise) ou sur la régularité du titre exécutoire. Elle peut aussi viser la procédure de saisie (non-respect des formalités, erreur dans le calcul de la quotité saisissable). Toute contestation doit être portée devant le juge de l’exécution, qui est seul compétent pour trancher ces litiges. Il est souvent pertinent de soulever ces contestations dès l’audience de conciliation.
L’impact des procédures de surendettement des particuliers
Enfin, si le débiteur se trouve dans une situation financière irrémédiablement compromise, il a la faculté de déposer un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers gérée par la Banque de France. La décision déclarant la recevabilité du dossier de surendettement emporte automatiquement la suspension de toutes les procédures d’exécution en cours, y compris la saisie des rémunérations, pour une durée pouvant aller jusqu’à deux ans. Cette mesure offre un répit au débiteur et permet d’envisager une solution globale à son endettement.
La procédure de saisie des rémunérations, bien qu’encadrée, comporte des subtilités techniques et des délais stricts. Une erreur ou une omission peut avoir des répercussions importantes. Face à une telle mesure, l’assistance d’un avocat est souvent indispensable pour vérifier la régularité de la procédure, négocier avec le créancier ou contester la saisie devant le juge. Notre cabinet d’avocats vous apporte son expertise pour analyser votre situation et défendre au mieux vos intérêts.
Sources
- Code du travail
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code civil