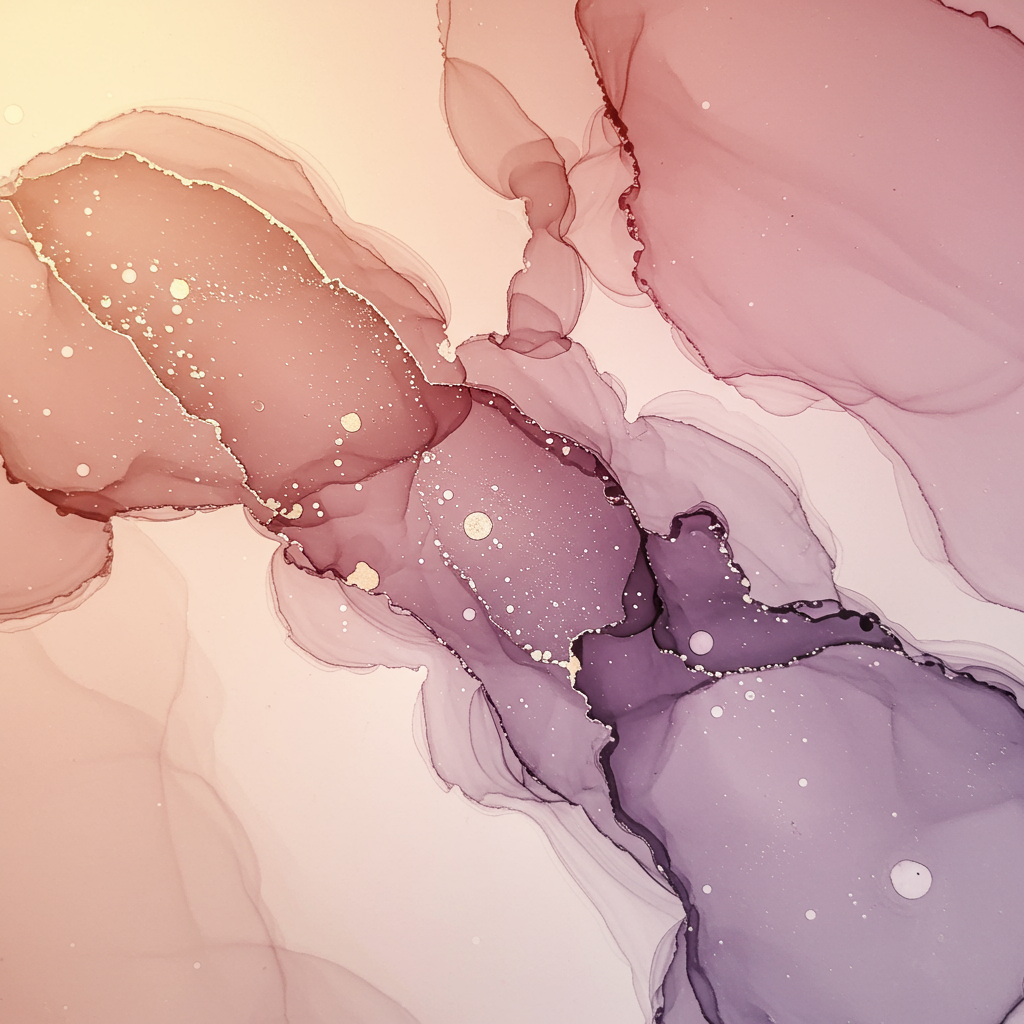Lorsqu’un litige éclate autour de la propriété ou de la possession d’un bien, le séquestre se présente comme une mesure de protection efficace pour préserver les droits de chaque partie. Le droit en France distingue deux mécanismes principaux : le séquestre conventionnel, fruit d’un accord, et le séquestre judiciaire, ordonné par un juge. Bien que leur finalité soit similaire, leurs régimes et conditions de mise en œuvre diffèrent substantiellement. Maîtriser leurs subtilités est indispensable pour sécuriser un actif dans l’attente du règlement d’une contestation.
Le séquestre conventionnel : une solution négociée
Le séquestre conventionnel est avant tout un contrat, une solution pragmatique choisie par les parties pour geler une situation conflictuelle. Sa mise en place repose sur la confiance et un accord de volontés clairement défini, encadré par des règles précises.
Définition et principes clés issus du code civil
Le texte de l’article 1956 du Code civil fournit la définition de référence, établissant que le séquestre conventionnel est le dépôt fait par « une ou plusieurs personnes, d’une chose contentieuse, entre les mains d’un tiers qui s’oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l’obtenir ». Cette définition met en lumière les trois acteurs essentiels à la validité de la convention : le ou les déposants, le tiers dépositaire (le séquestre) et le futur bénéficiaire de la restitution. L’existence d’une « chose contentieuse », c’est-à-dire un bien meuble ou immeuble faisant l’objet d’un litige, est la condition de fond de ce contrat.
L’accord des parties doit porter sur les éléments essentiels de l’opération : la description précise de la chose séquestrée, la durée de la mission et les modalités de gestion et son obligation de restitution. Un avocat peut jouer un rôle déterminant dans la rédaction de cette convention pour s’assurer que chaque mot protège les intérêts de son client et prévient toute ambiguïté future.
La formation du contrat de séquestre : un consensualisme encadré
En principe, le contrat de séquestre est consensuel, ce qui signifie qu’il n’exige pas de forme écrite pour être valable. La jurisprudence judiciaire, notamment la Cour de cassation, admet qu’une mission de séquestre peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants. Par exemple, dans un arrêt du 8 septembre 2021 (Civ. 1re, n° 19-25.760), les juges ont considéré qu’un échange de courriers et le versement effectif d’une somme séquestrée sur le compte CARPA d’un avocat suffisaient à caractériser l’existence d’une convention de séquestre et l’acceptation de sa mission par ce dernier.
Toutefois, cette souplesse a des limites. La volonté de confier une mission de séquestre doit être sans équivoque. De simples instructions vagues, comme la demande de « ne pas perdre de vue une saisie-arrêt », ne sauraient constituer un contrat de séquestre (Civ. 3e, 9 mars 2017, n° 16-12.385). L’acceptation du dépositaire, quant à elle, peut être expresse ou tacite, mais la simple détention matérielle du bien ne suffit pas à la prouver si elle peut s’expliquer par une autre cause jugée légitime.
Obligations et rémunération du dépositaire
Si la convention ne prévoit rien, le séquestre est présumé gratuit, conformément à ce que le texte de l’article 1957 du Code civil prévoit. Néanmoins, en pratique, une rémunération est souvent stipulée, surtout lorsque la mission implique des actes de gestion et d’administration. Cette rémunération est la juste contrepartie des charges assumées par le séquestre. Pour garantir le paiement de ses honoraires, le séquestre rémunéré dispose d’un droit de rétention sur la chose confiée, qu’il peut opposer à toutes les parties, y compris celle qui sera finalement jugée propriétaire.
Même gratuit, le séquestre a droit au remboursement des dépenses engagées pour la conservation du bien. Sa responsabilité est également engagée : il doit apporter à la garde de la chose des « soins raisonnables ». Cette obligation de conservation est la clé de voûte de sa mission. En cas de manquement, sa responsabilité peut être recherchée.
Le séquestre judiciaire : une mesure imposée par le juge
Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord ou que l’urgence commande une action rapide, le séquestre peut être ordonné par une décision de justice. Il devient alors une mesure conservatoire imposée, dont le cadre est fixé par le juge.
Quand et pourquoi demander un séquestre judiciaire ?
L’article 1961 du Code civil énumère les cas d’ouverture classiques du séquestre judiciaire : le bien mobilier saisi sur un débiteur, un bien dont la propriété ou la possession est litigieuse, ou les choses offertes par un débiteur pour sa libération. Cette liste n’est cependant pas exhaustive. La jurisprudence admet que le juge peut ordonner une mise sous séquestre chaque fois qu’une telle mesure apparaît nécessaire à la conservation des droits d’une partie.
Cette procédure est souvent initiée en référé, la voie de l’urgence par excellence. Le juge peut être saisi pour placer sous séquestre des actions d’une entreprise lors d’une OPA contestée, ou encore le prix de vente d’un fonds de commerce en cas de litige entre le vendeur de l’entreprise et un créancier. L’objectif est toujours le même : figer la situation pour éviter qu’un bien litigieux ne disparaisse ou ne se dégrade avant que le fond du droit ne soit tranché.
La distinction fondamentale avec les mesures de saisie
Une différence majeure doit être comprise : le séquestre n’est pas une saisie. La saisie est le premier acte d’une voie d’exécution, une procédure dont la finalité est de permettre à un créancier d’obtenir le paiement de sa créance, généralement par la vente du bien. La saisie a donc un effet attributif, au moins à terme.
Le séquestre, lui, est une mesure purement conservatoire. Il n’attribue aucun droit sur la valeur du bien. Les fonds ou le bien séquestrés restent dans une sorte de limbes juridiques, indisponibles pour les parties au litige, mais potentiellement accessibles à d’autres créanciers qui disposeraient d’un privilège ou auraient formé opposition. Ainsi, le séquestre du prix de vente d’un fonds de commerce n’empêche pas l’action directe d’un sous-traitant de l’entreprise ou la saisie par un créancier privilégié, notamment via une procédure d’opposition.
Le rôle du juge et la procédure de nomination
La demande de mise sous séquestre est généralement portée devant le juge des référés ou, si une procédure au fond est déjà en cours, devant le conseiller de la mise en état, conformément au Code de procédure civile. Le demandeur doit prouver l’existence d’une contestation sérieuse ou d’un risque de dommage imminent justifiant la mesure. Si les parties s’accordent sur le nom d’un séquestre via un accord amiable, le juge l’entérine. À défaut, le juge procède à sa nomination d’office, choisissant une personne offrant des garanties de neutralité et de compétence, souvent un administrateur ou un mandataire de justice.
La décision du juge fixe l’étendue de la mission du séquestre, ses pouvoirs d’administration, ainsi que les modalités de sa rémunération, qui entre dans la catégorie des frais de justice. Cette décision constitue le document de référence qui guidera l’action du séquestre tout au long de sa mission.
Les effets concrets du séquestre : une analyse transversale
Qu’il soit conventionnel ou judiciaire, le séquestre produit des effets importants sur les obligations des parties et engage la responsabilité de celui qui en a la charge.
L’impact sur les obligations financières : intérêts et paiement
Un des effets notables du dépôt des fonds entre les mains d’un séquestre est l’arrêt du cours des intérêts moratoires. Le débiteur qui se libère valablement en versant la somme litigieuse à un séquestre n’est plus redevable des intérêts de retard pour la période durant laquelle les fonds sont indisponibles, sa dépossession étant considérée comme légitime. La Cour de cassation l’a confirmé dans plus d’un arrêt, par exemple pour des loyers versés à un séquestre (Civ. 3e, 5 janvier 2011) ou pour une indemnité d’assurance bloquée par une volonté commune (Civ. 1re, 27 février 1985).
Cependant, depuis la réforme du droit des obligations de 2016, l’article 1345 du Code civil précise que pour que ce versement soit libératoire, le débiteur doit avoir mis en demeure le créancier de recevoir le paiement. Le séquestre lui-même peut être redevable d’intérêts s’il tarde à payer et à restituer les fonds après avoir été mis en demeure de le faire dans un certain délai. Le non-respect de ce délai l’expose à des sanctions.
La responsabilité du séquestre : une mission à risque
La mission du séquestre est lourde de responsabilités. Sa principale obligation est celle de conservation et de restitution. Il doit rendre la chose qui lui a été confiée à la personne qui sera désignée par le jugement ou par l’accord des parties une fois la contestation terminée. Toute restitution anticipée ou à la mauvaise personne constitue une faute engageant sa responsabilité délictuelle ou contractuelle.
Par exemple, un notaire séquestre de l’indemnité d’immobilisation dans une promesse de vente commet une faute s’il restitue la somme à l’une des parties sans s’être assuré que les conditions de la restitution sont bien réunies. Il s’agit là d’un cas classique illustrant la responsabilité délictuelle du notaire. De même, le séquestre du prix de vente d’un fonds de commerce qui omet d’informer les créanciers inscrits – dont le mandataire en cas de liquidation judiciaire du vendeur – engage sa responsabilité. Cette question de la responsabilité est un enjeu central qui justifie une grande prudence de la part du dépositaire et un conseil juridique avisé pour les parties.
Le cas particulier des séquestres prévus par la loi
Dans certaines situations, la loi elle-même impose le recours à un type de séquestre spécifique : le séquestre légal. C’est le cas en matière de bail commercial, où l’article L. 145-29 du Code de commerce prévoit que l’indemnité d’éviction due au locataire peut être versée à un séquestre en attendant le règlement final. La clé de ce mécanisme est de sécuriser à la fois le bailleur, propriétaire des lieux, et le locataire, l’autre partie intéressée.
Un autre exemple se trouve dans le droit de l’usufruit : si l’usufruitier, dont le droit est souvent constaté par acte authentique, ne peut fournir de caution, le bien immobilier peut être mis en séquestre (article 602 du Code civil). Enfin, des institutions comme la Caisse des dépôts et consignations (CDC) agissent comme séquestre institutionnel pour de nombreuses opérations (garanties, successions, etc.), assurant une mission de conservation des fonds.
Choisir le bon mécanisme : quand faire appel à un avocat ?
La réponse à la question de savoir s’il faut recourir à un séquestre conventionnel ou solliciter un séquestre judiciaire dépend entièrement des circonstances du litige, notamment de la relation entre les parties et de l’urgence de la situation. En général, le séquestre conventionnel offre souplesse et maîtrise, mais suppose un dialogue possible. Le séquestre judiciaire offre une solution lorsque tout accord est rompu ou qu’une partie fait obstruction.
Dans les deux cas, l’enjeu est de taille, ce qui oblige à une grande rigueur. La rédaction d’une convention de séquestre doit être d’une précision absolue pour éviter toute difficulté d’interprétation. La saisine d’un juge pour obtenir une mise sous séquestre requiert une argumentation juridique solide et la démonstration du bien-fondé de la demande. La complexité de ces mécanismes, soumis à la législation en vigueur, et les risques financiers associés rendent indispensable l’accompagnement d’un avocat compétent en sûretés et garanties. Il saura vous orienter vers la procédure la plus adaptée et défendre au mieux vos intérêts, à Paris comme sur tout le territoire.
Que ce soit pour négocier et rédiger un contrat de dépôt sécurisé ou pour agir en justice afin d’obtenir la protection d’un bien, notre cabinet est à votre disposition. Seule une analyse de votre dossier peut apporter une stratégie sur mesure. C’est une démarche utile, dès la date du litige, pour sécuriser la remise d’une somme ou d’un bien. Pour accéder à une évaluation de votre situation, prenez contact avec notre équipe.
Sources
- Code civil, articles 1955 à 1963 (du dépôt et du séquestre)
- Code de commerce, articles L. 145-29 et L. 145-30 (indemnité d’éviction)
- Code des procédures civiles d’exécution (dispositions relatives aux saisies et distributions)