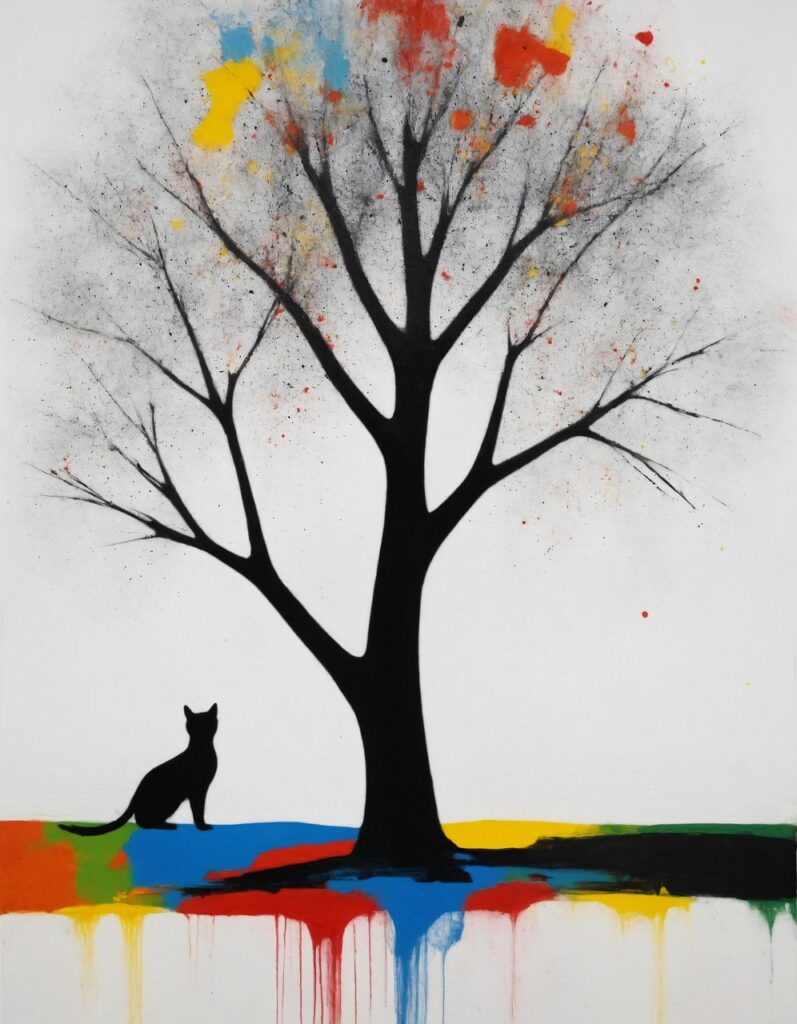L’indivision est un état juridique fréquent où plusieurs personnes, les indivisaires, possèdent ensemble un même bien, souvent à la suite d’une succession ou d’un achat en commun. Si cette situation peut être gérée amiablement, elle devient souvent une source de conflits. La licitation-partage apparaît alors comme une solution judiciaire efficace pour mettre fin à un blocage et permettre à chacun de recouvrer sa liberté patrimoniale. Pour un accompagnement expert dans ces démarches, notre cabinet d’avocats met à votre disposition sa compétence en matière d’indivision et de licitation-partage.
L’indivision et la licitation : définitions et concepts clés
L’indivision est une situation où plusieurs personnes détiennent des droits de même nature sur un même bien ou sur un ensemble de biens (meubles et immeubles), sans que leurs quotes-parts respectives soient matériellement divisées. Chaque indivisaire possède une quote-part abstraite du patrimoine indivis. Cette situation naît le plus souvent d’une succession, où les héritiers se retrouvent propriétaires ensemble du patrimoine du défunt, mais aussi d’une acquisition commune (par un couple non marié par exemple) ou de la dissolution d’un régime matrimonial.
La licitation consiste dans le procédé juridique qui permet de vendre un bien indivis aux enchères. Son interprétation varie selon le contexte. Juridiquement, elle peut être vue comme la vente d’un bien impossible à partager en nature. Plus simplement, elle s’apparente à une vente aux enchères organisée entre les coïndivisaires, ou ouverte à des tiers. Il est fondamental de distinguer la licitation-partage, où le bien est adjugé à l’un des coïndivisaires qui acquiert ainsi la pleine propriété, de la licitation-vente, où il est vendu à une personne étrangère à l’indivision. Cette distinction est essentielle, notamment sur le plan fiscal.
Le droit de sortir de l’indivision : un principe fondamental
Le droit français pose un principe cardinal à l’article 815 du Code civil : « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué ». Ce droit de demander le partage est absolu, imprescriptible et d’ordre public. La Cour de cassation, en sa qualité de Haute juridiction judiciaire, a, par une jurisprudence constante (par ex. Cass. 1re civ.), réaffirmé sa valeur fondamentale, garantissant à chaque indivisaire la possibilité de mettre fin à une propriété collective, même face à l’opposition des autres.
Les exceptions et limites au droit de sortie
Ce principe connaît cependant des tempéraments. Le partage peut être reporté, mais jamais définitivement empêché. Les principales exceptions sont :
- La convention d’indivision : les indivisaires peuvent signer un accord pour maintenir l’indivision pendant une période maximale de cinq ans, renouvelable. Une telle convention d’indivision permet d’organiser la gestion du bien et de suspendre temporairement le droit au partage.
- Le maintien judiciaire en indivision : à la demande d’un indivisaire, le tribunal peut décider d’un sursis au partage pour une durée maximale de deux ans si la réalisation immédiate de la vente risquerait de porter atteinte à la valeur du bien indivis.
Les stratégies pour sortir de l’indivision : de l’amiable au judiciaire
Lorsqu’un ou plusieurs indivisaires souhaitent sortir de l’indivision, plusieurs voies s’offrent à eux, de la plus consensuelle à la plus contentieuse.
La licitation amiable : la solution consensuelle privilégiée
La solution la plus simple et la moins coûteuse est la licitation amiable. Elle suppose un accord amiable et unanime de tous les indivisaires. Ceux-ci peuvent décider ensemble de vendre le bien à un tiers et de se répartir le prix, ou convenir que l’un d’eux rachètera les parts des autres. L’opération est alors constatée par un acte notarié, produisant les effets d’un partage ou d’une vente classique selon la situation.
La médiation ou conciliation : un préalable obligatoire ?
Avant de s’engager dans une procédure judiciaire longue et coûteuse, la question d’un mode de résolution amiable se pose. Si la loi n’impose pas systématiquement une médiation ou une conciliation comme un préalable obligatoire à l’action en licitation, les réformes récentes de la procédure civile encouragent fortement à recourir à ces dispositifs. Saisir un médiateur peut permettre de renouer le dialogue, d’explorer des solutions alternatives et de résoudre le conflit en trouvant un accord, évitant ainsi les aléas et les frais d’un procès. Cette démarche est un signe de gestion constructive du conflit.
La licitation judiciaire : la solution ultime en cas de conflit
En cas de désaccord persistant, la licitation judiciaire devient l’unique issue. Elle est mise en œuvre lorsque le partage en nature du bien est impossible et que les indivisaires ne parviennent pas à s’entendre sur une vente amiable. Un seul indivisaire qui le souhaite peut initier la procédure en assignant les autres devant le tribunal compétent pour demander le partage et, par conséquent, la vente forcée du bien indivis.
La procédure détaillée de la licitation-partage judiciaire
La procédure de licitation judiciaire est une vente aux enchères publiques orchestrée par le tribunal. Le déroulement de la procédure suit un formalisme strict pour garantir les droits de toutes les parties.
La saisine du tribunal et la demande en partage
La procédure débute par une assignation en partage et licitation, délivrée par un indivisaire aux autres par acte d’huissier. Selon la nature de l’indivision, le tribunal compétent est soit le juge aux affaires familiales (indivision post-communautaire, entre partenaires de PACS ou concubins), soit le tribunal judiciaire du lieu d’ouverture de la succession ou de la situation de l’immeuble. L’assignation doit, à peine d’irrecevabilité, contenir un descriptif du patrimoine à partager et mentionner les tentatives de résolution amiable, conformément à l’article 1360 du Code de procédure civile. Le cadre général de l’opération est régi par l’article 1377 du code susvisé.
Le jugement ordonnant la licitation : mise à prix et faculté de baisse
Si le juge constate l’impossibilité de partager le bien en nature et le désaccord des parties, il ordonne la vente par licitation. Par cette décision judiciaire, il fixe le montant de la mise à prix du bien, qui sert de point de départ aux enchères. Pour éviter que la vente ne soit infructueuse faute d’enchérisseurs, le jugement prévoit presque toujours une faculté de baisse du prix (généralement par paliers d’un quart, puis de moitié), un mécanisme nécessaire pour assurer la sortie effective de l’indivision.
La vente aux enchères à l’audience des criées
La vente se déroule à l’audience des criées du tribunal judiciaire. L’avocat du demandeur rédige un cahier des charges, qui constitue le contrat de vente, et organise les formalités de publicité légale. Une visite du bien est organisée pour les potentiels acquéreurs. Lors de l’audience, les enchères sont portées par des avocats. Le bien est adjugé au plus offrant et dernier enchérisseur après un décompte de 90 secondes.
Recours et contestations : que faire en cas de prix de vente jugé trop bas ?
Un indivisaire qui s’estime lésé par un prix d’adjudication déconnecté de la valeur réelle du bien dispose de peu de recours une fois la vente réalisée. L’action en rescision pour lésion, qui permet d’annuler une vente immobilière pour un prix inférieur à 5/12ème de sa valeur, est en principe inapplicable aux ventes aux enchères, car le mécanisme des enchères est censé refléter le juste prix du marché. Le levier le plus efficace est la surenchère du dixième. Dans les dix jours suivant l’adjudication, toute personne peut déposer au greffe une offre supérieure d’au moins 10 % au prix atteint. Cette démarche provoque automatiquement une nouvelle vente aux enchères, sur la base de cette nouvelle mise à prix, offrant une chance d’obtenir un meilleur prix.
La gestion des situations de blocage complexes
Dans les indivisions particulièrement conflictuelles, où la mésentente paralyse totalement la gestion du bien (défaut d’entretien, non-paiement des charges), des mesures exceptionnelles peuvent être sollicitées.
Le rôle de l’administrateur provisoire
Face à un état de blocage avéré qui met en péril l’intérêt commun, le président du tribunal judiciaire peut nommer un administrateur provisoire. Ce mandataire de justice se substitue aux indivisaires défaillants pour accomplir les actes de gestion urgents, administrer le bien et préparer les opérations de partage et de licitation. Sa mission est définie par le juge et vise à préserver la valeur des biens patrimoniaux indivis en attendant la sortie définitive de l’indivision.
Licitation de biens spécifiques : règles et enjeux
Si le principe du partage en nature prévaut, sa mise en œuvre dépend de la nature des biens. Pour certains actifs complexes, la licitation devient la seule option viable.
Le principe du partage en nature et ses limites
La loi privilégie toujours, lorsque cela est possible, le partage en nature, c’est-à-dire l’attribution à chaque indivisaire de lots matériels correspondant à ses droits. La licitation n’est qu’une solution subsidiaire, ordonnée uniquement si le bien ne peut être « commodément partagé ou attribué ».
Comment prouver l’impossibilité matérielle ou économique du partage ?
La preuve de l’impossibilité du partage en nature est une condition essentielle pour obtenir la licitation. Elle peut être démontrée par plusieurs facteurs, appréciés souverainement par le juge :
- L’incommodité matérielle : le bien ne peut être physiquement divisé en lots sans perdre sa substance ou son utilité. C’est le cas d’une maison d’habitation qui ne peut être scindée en appartements fonctionnels.
- La perte de valeur substantielle : la division du bien entraînerait une dépréciation économique significative de l’ensemble. Par exemple, le morcellement d’un terrain agricole le rendrait inexploitable et diminuerait sa valeur globale.
- L’indivisibilité juridique ou fonctionnelle : des contraintes réglementaires (urbanisme) ou fonctionnelles (dépendances communes) empêchent la création de lots autonomes.
Cas particulier : la licitation d’un fonds de commerce
La licitation d’un fonds de commerce indivis présente des enjeux spécifiques qui la distinguent de celle d’un simple bien immobilier. La principale difficulté réside dans l’évaluation de ses composantes incorporelles, qui en constituent souvent la valeur essentielle : la clientèle, le droit au bail, l’enseigne. La procédure de vente doit également respecter les règles du Code de commerce, notamment en matière de publicité, afin de protéger les droits des créanciers spécifiques du fonds. La transmission du bail commercial à l’adjudicataire est aussi un point de vigilance majeur qui nécessite une expertise juridique pointue pour garantir la sécurité juridique de l’opération, notamment si le fonds est exploité par une société ou constitue le support d’une entreprise familiale.
Coûts, durée et fiscalité de la procédure de licitation
La décision d’engager une licitation judiciaire doit être éclairée par une vision claire de ses implications en termes de délais, de coûts et d’impôts.
Durée moyenne de la procédure : à quoi s’attendre ?
La procédure de licitation judiciaire se déroule en deux phases distinctes. La première, devant le juge du fond pour obtenir le jugement ordonnant la vente, peut durer de 12 à 18 mois, en fonction de la complexité du dossier et de l’encombrement du tribunal. La seconde phase, celle de la vente aux enchères elle-même, est plus rapide, s’étalant sur 2 à 4 mois. Au total, il faut donc prévoir une période globale d’environ deux ans pour parvenir à la vente effective du bien.
Coût de la procédure : frais d’avocat, publicité et émoluments
Les coûts de la procédure ne sont pas négligeables. Ils incluent les honoraires de l’avocat qui pilote la procédure (souvent un forfait de 2000 à 3000 € pour la première phase), ainsi que les frais avancés pour la vente elle-même (publicité légale, diagnostics, frais d’huissier pour la visite), qui peuvent s’élever de 4000 à 9000 €. Ces frais sont avancés par l’indivisaire qui poursuit la vente mais sont ensuite prélevés sur le produit de la vente et remboursés. L’un des avantages de la vente judiciaire est que les émoluments des avocats remplacent les frais de notaire ; l’indivisaire poursuivant doit être intégralement payé de ses avances.
Fiscalité de la licitation : droit de partage et impôt sur la plus-value
La fiscalité de l’opération est un point crucial qui dépend de la qualité de l’acquéreur. C’est ici que la distinction entre licitation-partage et licitation-vente prend tout son sens :
- Si le bien est adjugé à un co-indivisaire : l’opération est considérée comme un partage. Elle est alors soumise au droit de partage, une taxe d’enregistrement actuellement au taux de 2,5 % (avec des taux réduits dans certains cas de divorce, séparation de corps ou rupture de PACS, faisant suite au mariage ou à l’union), calculé sur la valeur nette du bien. Le jugement ou l’acte doit faire l’objet de la formalité de l’enregistrement. Cette solution est généralement la plus avantageuse fiscalement.
- Si le bien est adjugé à un tiers : l’opération est une vente classique. Elle n’est pas soumise au droit de partage mais peut déclencher l’impôt sur les plus-values immobilières pour les indivisaires, après application des abattements pour durée de détention.
Conclusion : rôle des acteurs et vision stratégique
Sortir d’une indivision par la licitation est une démarche complexe qui mobilise plusieurs acteurs et requiert une stratégie claire.
L’avocat, un allié indispensable pour naviguer la procédure
Le recours à un avocat est obligatoire pour mener une procédure de licitation judiciaire. Son rôle ne se limite pas à la représentation en justice. Il est un conseil stratégique qui aide l’indivisaire à définir ses objectifs (maximiser le produit de la vente, racheter le bien, etc.) et met en œuvre la procédure la plus adaptée pour défendre ses intérêts à chaque étape, de l’assignation à la répartition équitable du produit de la vente.
Le rôle des créanciers dans la licitation
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne sont pas démunis face à l’inertie de leur débiteur. Grâce à l’action oblique, ils peuvent provoquer le partage et la licitation du bien indivis pour obtenir le paiement de leur créance sur la part revenant à leur débiteur. Ce droit permet d’éviter que l’indivision ne serve à organiser l’insolvabilité d’un de ses membres.
Face à une indivision successorale ou post-communautaire conflictuelle, il est essentiel d’agir avec méthode. N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour une analyse de votre situation et définir la stratégie la plus adaptée à vos objectifs.
Sources
- Code civil, articles 815, 840, 1686, 1873-2, 1873-3
- Code de procédure civile, articles 1271 à 1281, 1360, 1377
- Code de l’organisation judiciaire, article L. 213-3
- Code général des impôts, article 750