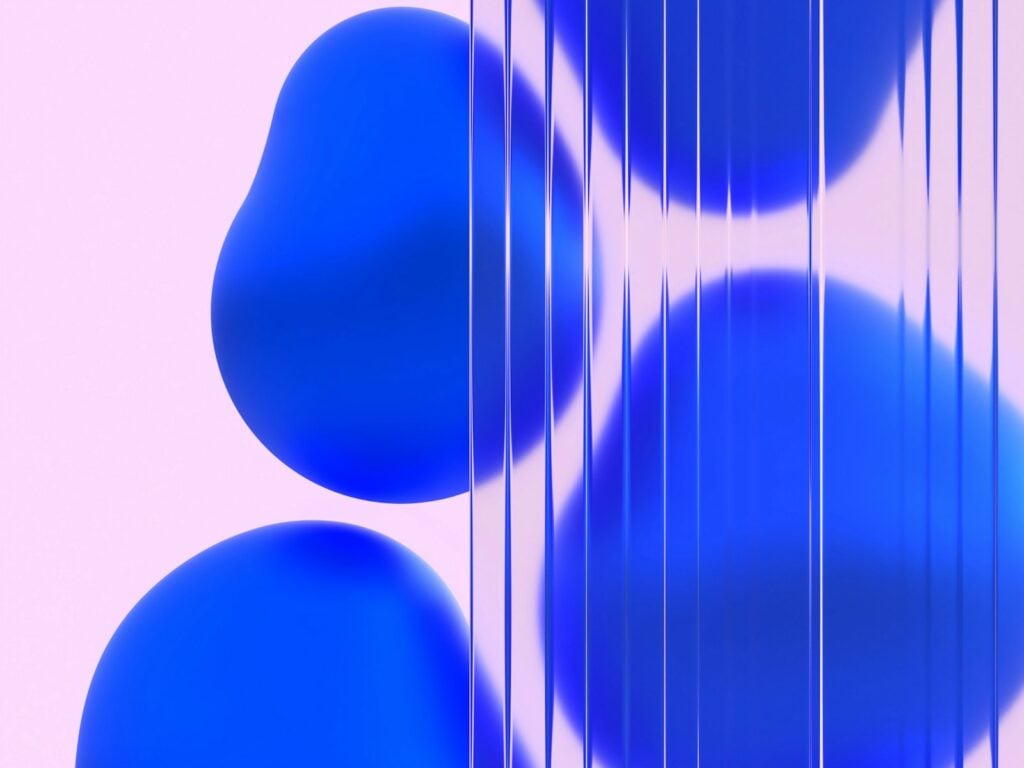Le fonds de commerce n’est pas seulement un actif qui s’achète ou se vend classiquement. Sa valeur et sa nature juridique en font un outil économique polyvalent. Il peut être l’élément central d’une structuration d’entreprise, notamment via un apport à une société. Il peut également servir de garantie pour sécuriser des financements ou des paiements différés. Pour une compréhension approfondie de ce qu’est précisément un fonds de commerce et de ses éléments essentiels, consultez notre article de référence.
Comprendre ces autres opérations, ainsi que les principales garanties qui peuvent « grever » (c’est-à-dire affecter juridiquement) un fonds de commerce, est essentiel pour tout entrepreneur. Que vous envisagiez de créer une société, de vendre votre fonds à crédit, ou d’obtenir un prêt bancaire pour développer votre activité, ces mécanismes juridiques vous concernent directement. Cet article explore deux aspects importants : l’apport de votre fonds à une société et les garanties les plus courantes – le privilège du vendeur et le nantissement conventionnel – ainsi que certaines règles communes qui leur sont applicables.
Apporter son fonds de commerce à une société
Plutôt que d’exploiter son activité en nom propre (en tant qu’entrepreneur individuel), il est fréquent d’apporter son fonds de commerce à une société (SARL, SAS, ou leurs formes unipersonnelles EURL, SASU…). Cette opération, distincte de la simple vente, répond à des objectifs spécifiques et suit ses propres règles.
Pourquoi apporter son fonds en société ?
L’intérêt majeur de l’apport est de transférer le fonds à une nouvelle personne juridique : la société. Celle-ci devient propriétaire et exploitante du fonds. Pour l’entrepreneur (devenu associé), l’avantage principal réside souvent dans la séparation des patrimoines. Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL, SAS, EURL, SASU), le patrimoine personnel de l’associé est, en principe, distinct et protégé du patrimoine de la société. En cas de difficultés financières de l’entreprise, les créanciers de la société ne peuvent normalement saisir que les biens de celle-ci, et non les biens personnels de l’associé (sauf exceptions, comme la faute de gestion ou les cautions personnelles). L’apport en société est donc un outil de limitation des risques. C’est aussi une structure qui peut faciliter la transmission future de l’entreprise ou l’entrée de nouveaux investisseurs.
Les formes de l’apport
L’apport d’un fonds peut revêtir différentes formes :
- Apport en propriété : C’est le cas le plus fréquent. La société devient pleinement propriétaire du fonds.
- Apport en jouissance : Plus rare et techniquement complexe, l’apporteur reste propriétaire du fonds mais en confère seulement l’usage et le droit d’exploiter à la société pour une durée déterminée.
- Apport pur et simple : L’apport est rémunéré exclusivement par l’attribution de droits sociaux (parts ou actions) à l’apporteur.
- Apport à titre onéreux ou mixte : Si, en contrepartie de l’apport, l’apporteur reçoit autre chose que des droits sociaux (une somme d’argent, par exemple) ou si la société prend en charge une partie de son passif personnel, l’opération s’analyse juridiquement, en tout ou partie, comme une vente et non plus comme un simple apport. Cela a des conséquences fiscales et juridiques importantes, notamment vis-à-vis des créanciers.
Formalités et obligations
L’apport d’un fonds de commerce doit être constaté par écrit, généralement dans les statuts de la société ou dans un acte d’apport séparé. Une évaluation précise du fonds apporté est nécessaire, souvent réalisée par un commissaire aux apports (obligatoire dans certains cas) pour garantir la valeur réelle de l’apport vis-à-vis des autres associés et des tiers.
Concernant les informations à fournir, il est à noter que l’obligation formelle de reprendre les mentions de l’ancien article L.141-1 du Code de commerce (origine, chiffres d’affaires passés…) a été supprimée pour les apports faits à une EURL ou SASU dont l’apporteur est l’associé unique. Toutefois, la nécessité d’une information complète et loyale demeure, fondée sur le droit commun des contrats.
L’apporteur, comme un vendeur, a l’obligation de délivrer le fonds à la société et de la garantir contre les vices cachés et l’éviction.
La protection des créanciers de l’apporteur
Lorsqu’un fonds est apporté en société, il sort du patrimoine personnel de l’apporteur. Pour protéger les créanciers personnels de ce dernier (ceux dont la dette n’est pas liée au fonds ou n’est pas prise en charge par la société), la loi (articles L.141-21 et L.141-22 du Code de commerce) a prévu un mécanisme spécifique :
- Publicité de l’apport : L’apport doit faire l’objet d’une publicité au BODACC, similaire à celle d’une vente.
- Déclaration des créances : Dans les 10 jours suivant cette publication, les créanciers personnels de l’apporteur doivent déclarer le montant de leurs créances au greffe du tribunal de commerce compétent.
- Option pour la société et les associés : Si des créances sont déclarées, la société (ou ses associés) a 15 jours pour demander en justice l’annulation de l’apport, voire de la société elle-même, si elle estime que ce passif déclaré est trop lourd.
- Solidarité : Si l’annulation n’est pas demandée ou pas obtenue, la société devient solidairement responsable avec l’apporteur du paiement des dettes personnelles qui ont été régulièrement déclarées au greffe. C’est une conséquence importante : la société peut se retrouver à payer des dettes antérieures de son apporteur.
Le privilège du vendeur : une garantie pour le paiement à crédit
Revenons à la vente classique. Lorsqu’un vendeur accorde des délais de paiement à son acheteur (crédit-vendeur), il prend un risque. Pour sécuriser sa créance, la loi lui accorde automatiquement une garantie puissante sur le fonds vendu : le privilège du vendeur. Pour une compréhension complète des obligations et précautions à prendre lors de la vente de votre fonds de commerce, nous vous invitons à consulter notre guide détaillé.
- Nature : C’est une sûreté légale, un droit de préférence qui permet au vendeur impayé d’être payé prioritairement sur le prix, en cas de revente du fonds par l’acheteur (ou en cas de vente forcée).
- Conditions strictes d’obtention : Ce privilège n’est pas automatique dans ses effets. Pour qu’il soit valable et opposable aux tiers (autres créanciers de l’acheteur, sous-acquéreur…), le vendeur doit impérativement respecter des conditions de forme précises :
- La vente doit être constatée par un acte écrit (authentique ou sous seing privé) et enregistré.
- Le privilège doit faire l’objet d’une inscription spécifique au greffe du tribunal de commerce où le fonds est exploité. Cette inscription doit être prise dans un délai strict de 30 jours suivant la date de l’acte de vente (ce délai était de 15 jours avant une réforme de 2021). Une inscription tardive serait inefficace vis-à-vis des tiers.
- L’acte de vente et l’inscription au greffe doivent obligatoirement mentionner des prix distincts pour les trois composantes du fonds : les éléments incorporels, le matériel, et les marchandises. Sans cette ventilation, le privilège risque d’être considéré comme nul.
- Effets protecteurs :
- Droit de préférence : Sur le prix de revente du fonds, le vendeur privilégié passe avant les créanciers chirographaires (sans garantie) de l’acheteur et avant les créanciers ayant inscrit une garantie (comme un nantissement) après lui. L’inscription dans le délai de 30 jours lui assure même la priorité sur les inscriptions prises par des créanciers de l’acheteur pendant ce même délai.
- Droit de suite : C’est un droit très fort. Le privilège « suit » le fonds. Si l’acheteur revend le fonds à une autre personne, le vendeur initial, s’il n’est toujours pas payé, peut faire saisir et vendre le fonds entre les mains de ce nouveau propriétaire (sous-acquéreur) pour récupérer son dû.
- L’action résolutoire : En plus du privilège sur le prix, le vendeur impayé conserve le droit de demander en justice l’annulation de la vente (action résolutoire) pour récupérer son fonds. Pour que cette action soit efficace contre les tiers (créanciers de l’acheteur, sous-acquéreur), elle doit être expressément mentionnée dans l’inscription du privilège au greffe, et le privilège doit lui-même être encore valide (non périmé, non radié).
Le nantissement conventionnel : utiliser le fonds comme garantie
Le fonds de commerce peut aussi être utilisé par son propriétaire comme garantie pour obtenir un crédit ou sécuriser une autre dette. C’est le nantissement conventionnel, une sûreté très courante, notamment pour garantir les prêts bancaires finançant l’acquisition ou le développement de l’activité.
- Définition : C’est un contrat par lequel le propriétaire du fonds (le constituant) affecte son fonds en garantie du paiement d’une dette au profit d’un créancier (le créancier nanti). Le propriétaire conserve la possession et l’exploitation du fonds (c’est une sûreté sans dépossession).
- Éléments couverts : Le nantissement peut porter sur les éléments incorporels (enseigne, nom, droit au bail, clientèle, licences, marques, brevets…) et sur le matériel et l’outillage servant à l’exploitation. En revanche, les marchandises sont toujours exclues de l’assiette du nantissement conventionnel de fonds de commerce (Article L.142-2 du Code de commerce).
- Formalités : Pour être valable et opposable aux tiers, le nantissement doit respecter les mêmes exigences formelles que le privilège du vendeur : un acte écrit (authentique ou sous seing privé), enregistré, et une inscription au greffe du tribunal de commerce dans les 30 jours de la date de l’acte (délai également modifié en 2021).
- Droits du créancier nanti : S’il est régulièrement inscrit, le créancier nanti bénéficie des mêmes droits essentiels que le vendeur privilégié : un droit de préférence sur le prix de vente du fonds (son rang par rapport aux autres créanciers inscrits dépendant de la date de son inscription) et un droit de suite lui permettant de faire vendre le fonds même s’il a changé de propriétaire.
Points communs et garanties supplémentaires pour les créanciers inscrits
Que l’on soit vendeur privilégié ou créancier nanti, l’inscription au greffe est la formalité qui donne toute son efficacité à la garantie vis-à-vis des tiers. Ces créanciers « inscrits » bénéficient de règles communes et de protections additionnelles.
- Publicité et durée de l’inscription : L’inscription rend la garantie publique. Elle est valable pour 10 ans à compter de sa date. Si la dette garantie n’est pas éteinte à cette échéance, le créancier doit impérativement demander le renouvellement de son inscription avant la fin des 10 ans, sinon sa garantie disparaît (péremption). La radiation de l’inscription (sa suppression du registre) ne peut intervenir qu’en cas de paiement intégral de la dette ou avec l’accord exprès du créancier (par acte authentique).
- Le droit de suite : Ce droit permet aux créanciers inscrits de ne pas être lésés par une revente du fonds. Ils peuvent faire saisir le fonds entre les mains de n’importe quel acquéreur successif. C’est pourquoi tout acheteur potentiel doit impérativement consulter l’état des inscriptions au greffe avant de s’engager.
- La procédure de purge : Inversement, un acquéreur qui achète un fonds grevé d’inscriptions peut chercher à « purger » ces inscriptions pour sécuriser sa propriété. Cette démarche est cruciale pour l’acheteur, qui doit également être attentif à toutes les autres précautions essentielles lors de l’acquisition d’un fonds de commerce. Il s’agit d’une procédure complexe où l’acquéreur notifie aux créanciers inscrits le prix qu’il est prêt à payer pour libérer le fonds. Les créanciers peuvent soit accepter et être payés sur ce prix (ce qui éteint leur droit de suite), soit refuser et provoquer une vente aux enchères s’ils estiment le prix insuffisant (la « surenchère du dixième »).
- Garanties accessoires contre la dépréciation du gage : La loi offre des protections supplémentaires aux créanciers inscrits contre les événements qui pourraient réduire la valeur du fonds :
- En cas de déplacement du fonds (transfert de l’activité dans d’autres locaux) : Le propriétaire doit notifier son intention aux créanciers inscrits au moins 15 jours à l’avance. S’il ne le fait pas, ou si le déplacement risque de diminuer la valeur du fonds, les créances inscrites peuvent devenir immédiatement exigibles (Article L.143-1 C. com.). Les créanciers peuvent alors demander le paiement immédiat ou exiger une nouvelle inscription au greffe du nouveau lieu d’exploitation.
- En cas de résiliation du bail : Le bailleur qui souhaite mettre fin au bail (que ce soit amiablement, par une action en justice ou par le jeu d’une clause résolutoire) a l’obligation de notifier son intention aux créanciers inscrits sur le fonds. Ceux-ci disposent alors d’un délai d’un mois pour réagir : ils peuvent notamment payer les loyers ou exécuter les obligations du locataire à sa place pour empêcher la résiliation et ainsi préserver leur garantie qui repose souvent en grande partie sur le maintien du bail (Article L.143-2 C. com.). Le non-respect de cette notification par le bailleur rendrait la résiliation inopposable aux créanciers inscrits.
Apporter son fonds en société, le vendre à crédit ou le nantir sont des opérations aux implications juridiques et financières importantes. Maîtriser les règles relatives aux garanties (privilège, nantissement) est essentiel pour sécuriser vos transactions et vos financements. Pour structurer au mieux vos opérations et défendre efficacement vos droits en tant que propriétaire ou créancier, l’expertise d’un avocat est indispensable. Notre cabinet est à votre écoute pour vous accompagner dans tous les aspects de la cession de fonds de commerce.
Sources
- Code de commerce (notamment articles L.141-5 à L.141-9, L.141-21, L.141-22, L.142-1 à L.142-5, L.143-1, L.143-2, L.143-12 et suivants)
- Code civil (principes généraux des contrats, des sûretés, des sociétés)