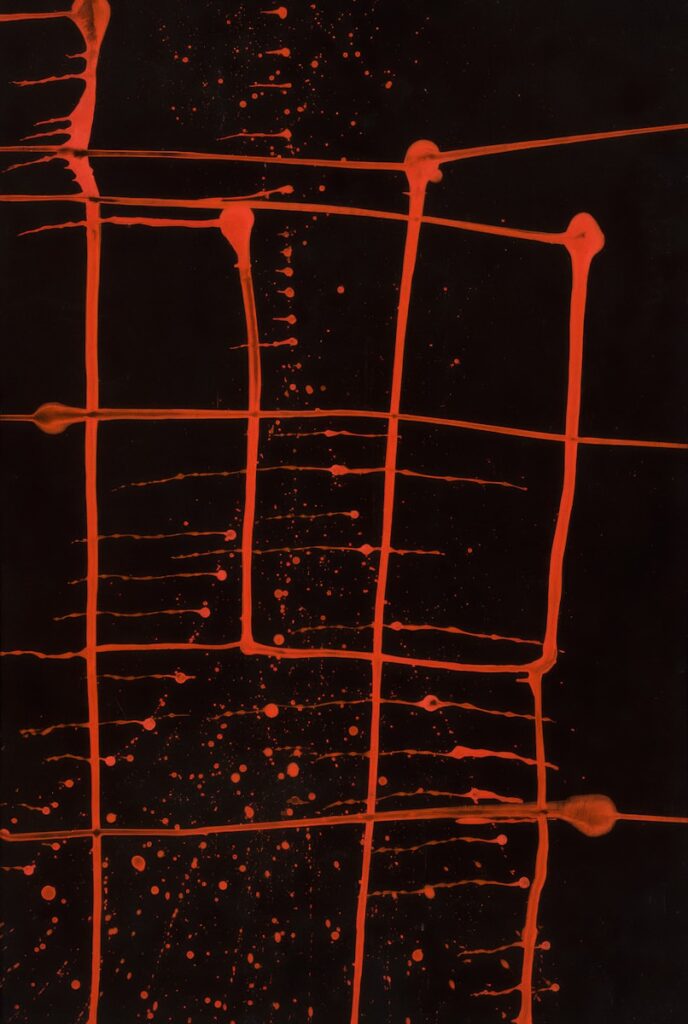Le transport routier de marchandises (TRM) est une activité essentielle à l’économie, mais c’est aussi une profession réglementée. Entrer dans ce secteur ne s’improvise pas. La loi impose un cadre strict pour garantir la sécurité, la fiabilité et la compétence des opérateurs. Avant de pouvoir lancer votre activité et faire circuler vos camions, vous devez franchir plusieurs étapes et satisfaire à des exigences précises. Cet article détaille les conditions indispensables pour accéder à la profession de transporteur routier de marchandises en France, un aspect fondamental de la vue d’ensemble de la réglementation.
Les quatre exigences fondamentales pour exercer
Depuis la refonte de la réglementation européenne, connue sous le nom de « Paquet Routier » et transposée en droit français, toute entreprise souhaitant exercer l’activité de transporteur public routier de marchandises doit impérativement satisfaire à quatre conditions cumulatives. Ces exigences visent à assurer le sérieux et la pérennité des entreprises du secteur.
L’obligation d’établissement en France
La première condition, renforcée par la réglementation récente, est celle de l’établissement. Concrètement, votre entreprise doit disposer d’un siège social ou d’un établissement principal situé en France. Ce lieu doit être plus qu’une simple boîte aux lettres : il doit s’agir de locaux réels où sont conservés les documents essentiels de l’entreprise. Pensez notamment aux documents comptables, aux contrats de transport, aux documents relatifs aux conducteurs et aux véhicules.
Ces documents doivent pouvoir être consultés par les agents de contrôle de l’État, comme les inspecteurs des transports terrestres ou les agents de la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement). Cette exigence garantit une réelle présence sur le territoire et facilite la surveillance du respect des règles.
L’exigence d’honorabilité professionnelle
La fiabilité d’une entreprise de transport repose aussi sur l’intégrité de ses dirigeants. C’est pourquoi la loi impose une condition d’honorabilité professionnelle. Cette exigence ne concerne pas seulement le chef d’entreprise individuel ou le gérant désigné pour diriger l’activité transport. Elle s’applique à toutes les personnes qui détiennent une responsabilité légale dans l’entreprise. Selon la forme juridique, cela peut inclure les associés de sociétés en nom collectif, les gérants de SARL, le président et les directeurs généraux de SA ou SAS, les associés commandités, etc..
Pour satisfaire cette condition, ces personnes ne doivent pas avoir fait l’objet de certaines condamnations pénales qui seraient incompatibles avec l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle. Sont notamment visées les interdictions de gérer. De plus, elles ne doivent pas avoir subi plus d’une condamnation pour certains délits spécifiques liés à l’activité de transport ou au droit du travail. La liste inclut, par exemple, le délit de marchandage, le travail dissimulé, des infractions graves au Code de la route ou à la réglementation sociale européenne (temps de conduite et de repos), ou encore le transport illicite de matières dangereuses. Le non-respect des règles abordées dans notre article sur le cadre légal des contrats de transport, comme la juste rémunération des sous-traitants, peut également entraîner la perte de l’honorabilité.
L’administration vérifie cette condition notamment en consultant le bulletin n°2 du casier judiciaire des personnes concernées. Une condamnation entraînant la perte d’honorabilité de l’un des dirigeants peut avoir des conséquences directes sur l’autorisation d’exercer de l’entreprise.
La capacité financière
Gérer une entreprise de transport demande des ressources financières suffisantes pour assurer son bon fonctionnement et faire face aux imprévus. La condition de capacité financière vise à garantir cette solidité. L’entreprise doit prouver qu’elle dispose de capitaux propres et de réserves (ou de garanties bancaires sous conditions) d’un montant minimal.
Ce montant est calculé en fonction du nombre de véhicules motorisés que l’entreprise compte exploiter, qu’ils soient possédés en propre, en crédit-bail ou en location. Les règles issues du « Paquet Routier » ont fixé ces seuils au niveau européen :
- Pour le premier véhicule lourd (plus de 3,5 tonnes de Poids Maximal Autorisé – PMA) : 9 000 €.
- Pour chaque véhicule lourd supplémentaire : 5 000 €.
- Pour chaque véhicule léger (PMA inférieur ou égal à 3,5 tonnes) : 900 € (ce seuil peut être adapté par la réglementation nationale, vérifier les montants exacts applicables au moment de la demande).
Il est important de noter que les garanties bancaires ou assurances professionnelles ne peuvent couvrir qu’une partie de cette capacité financière exigible, souvent plafonnée à 50%. Le reste doit provenir des fonds propres de l’entreprise. Cette solidité financière est d’ailleurs un élément qui peut influencer la négociation des conditions contractuelles.
Pour justifier de sa capacité financière, l’entreprise doit établir une liasse comptable certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé. Cette justification doit être fournie lors de la demande d’autorisation initiale, mais aussi faire l’objet d’une vérification annuelle par l’administration. Une dégradation de la situation financière peut entraîner la perte de l’autorisation d’exercer si l’entreprise ne parvient pas à régulariser sa situation dans les délais impartis.
La capacité professionnelle
Diriger une entreprise de transport routier ne s’improvise pas. Cela demande des connaissances techniques, commerciales, sociales et réglementaires. La condition de capacité professionnelle garantit que la personne qui assure la direction permanente et effective de l’activité transport possède ces compétences. Il s’agit généralement du chef d’entreprise lui-même ou d’un cadre dirigeant spécifiquement désigné à cet effet.
Le niveau d’exigence et le mode de justification de cette capacité varient selon le type de véhicules exploités par l’entreprise :
L’attestation de capacité (> 3.5 tonnes)
Si l’entreprise utilise des véhicules de plus de 3,5 tonnes de PMA (même un seul), la personne dirigeante doit être titulaire de l’attestation de capacité professionnelle « poids lourds ». Ce document est délivré par le préfet de région. Il existe trois voies pour l’obtenir :
- L’examen écrit : C’est la voie principale. Il s’agit d’un examen national annuel portant sur un large éventail de matières : gestion commerciale et financière, droit civil et commercial, droit social, droit fiscal, réglementation professionnelle et sociale des transports, normes techniques et sécurité routière, accès au marché. Sa réussite demande une préparation sérieuse.
- L’équivalence de diplôme : Certains diplômes de l’enseignement supérieur (minimum Bac+2) ou technique spécialisés dans le transport et la logistique permettent d’obtenir l’attestation par équivalence. Une liste officielle précise les diplômes reconnus. Des compléments de formation peuvent parfois être exigés. C’est une voie fréquemment utilisée par les jeunes diplômés du secteur.
- L’expérience pratique : Une personne justifiant d’une expérience d’au moins cinq années à un niveau de direction dans une entreprise de transport de marchandises peut, sous certaines conditions très strictes et après passage devant une commission, obtenir l’attestation. Cette voie est devenue plus restrictive et implique souvent de devoir compléter ses connaissances.
Le justificatif de capacité (<= 3.5 tonnes)
Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules légers (PMA inférieur ou égal à 3,5 tonnes), l’exigence est moins élevée. Le dirigeant doit posséder un justificatif de capacité professionnelle « véhicules légers ». Celui-ci est également délivré par le préfet de région et s’obtient :
- Par un stage de formation spécifique : Il faut suivre une formation obligatoire de plusieurs jours auprès d’un organisme agréé, suivie d’un examen final validant les connaissances en gestion, réglementation et sécurité applicables au transport léger.
- Par équivalence de diplôme : Certains diplômes (comme le Bac Pro Exploitation des Transports) sont également admis en équivalence.
Il est essentiel de bien identifier la personne qui assurera la direction effective et permanente de l’activité transport et de vérifier qu’elle remplit la condition de capacité adéquate avant de déposer le dossier.
L’inscription au registre des transporteurs et des loueurs
Une fois que l’entreprise pense remplir les quatre conditions (établissement, honorabilité, capacité financière et professionnelle), elle doit demander son inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route. Ce registre est tenu par le préfet de la région où l’entreprise a son siège social ou son établissement principal en France. La gestion quotidienne est souvent assurée par les services Transports des DREAL (Directions Régionales de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement – qui ont remplacé les DRE).
L’inscription n’est possible que pour les entreprises déjà immatriculées au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers (RM). La demande d’inscription se fait via un dossier complet justifiant du respect des quatre conditions vues précédemment.
Une fois inscrite, l’entreprise a l’obligation d’informer le préfet de région de tout changement susceptible d’affecter l’une de ces conditions (changement de dirigeant, de statut juridique, baisse significative des capitaux propres, nouvelle condamnation d’un responsable légal, etc.), et ce, dans un délai d’un mois. Le non-respect de cette obligation d’information est passible de sanctions pénales.
Le maintien de l’inscription au registre est conditionné au respect permanent des exigences. Si l’entreprise ne satisfait plus à l’une des conditions, le préfet, après avis de la commission territoriale des sanctions administratives (CTSA) et mise en demeure restée infructueuse, peut prononcer la radiation de l’entreprise du registre. La radiation peut aussi intervenir en cas de fausses déclarations lors de l’inscription, de cessation d’activité prolongée, ou si l’entreprise se voit retirer définitivement tous ses titres de transport. Une entreprise radiée ne peut généralement pas demander une nouvelle inscription avant un délai minimal, souvent de deux ans.
L’obtention de la licence de transport
L’inscription au registre atteste que l’entreprise remplit les conditions pour exercer. Mais pour pouvoir effectivement réaliser des opérations de transport, elle doit détenir un titre administratif spécifique : la licence de transport. C’est ce document, ou plutôt ses copies conformes présentes dans chaque véhicule, qui prouve l’autorisation d’exercer lors des contrôles routiers et conditionne le droit de faire circuler les véhicules, comme détaillé dans notre article sur les règles de circulation et opérations de transport.
L’obtention de la licence découle directement de l’inscription au registre. Elle est délivrée par le préfet de région en même temps que l’attestation d’inscription. Il existe deux types principaux de licences, en fonction des opérations envisagées et du type de véhicules :
- La licence communautaire : C’est le titre requis par la réglementation européenne pour les entreprises utilisant des véhicules dont le PMA dépasse 3,5 tonnes. Elle est indispensable pour effectuer des transports internationaux au sein de l’Union Européenne et pour réaliser des opérations de cabotage (transports intérieurs dans un autre État membre). Elle est établie selon un modèle européen harmonisé.
- La licence de transport intérieur : Elle est délivrée aux entreprises qui n’ont pas l’obligation de détenir une licence communautaire, typiquement celles qui utilisent exclusivement des véhicules légers (PMA <= 3,5 tonnes) ou des véhicules de moins de quatre roues (pour les coursiers par exemple) et qui n’effectuent que des transports nationaux.
Que la licence soit communautaire ou intérieure, son régime est similaire :
- Elle est établie au nom de l’entreprise et est incessible.
- Sa durée de validité est limitée (actuellement 10 ans pour la licence communautaire, mais à vérifier lors de la demande) et son renouvellement n’est pas automatique ; il faut en faire la demande et prouver que les conditions sont toujours remplies.
- L’original de la licence doit être conservé au siège de l’entreprise.
- L’administration délivre autant de « copies conformes » numérotées de la licence que l’entreprise exploite de véhicules. Une copie conforme doit obligatoirement se trouver à bord de chaque véhicule en circulation. L’absence de ce document lors d’un contrôle est une infraction.
Comme l’inscription au registre, la licence (et ses copies) peut être retirée temporairement ou définitivement par le préfet, après avis de la CTSA, si l’entreprise ne respecte plus les conditions d’exercice ou commet des infractions graves ou répétées aux réglementations (transport, travail, sécurité). Un retrait définitif des titres entraîne logiquement la radiation du registre. L’utilisation d’une licence suspendue, périmée ou retirée est sévèrement sanctionnée pénalement.
Cas particulier : l’établissement des entreprises étrangères
Les règles d’accès à la profession s’appliquent aussi aux entreprises étrangères souhaitant s’établir en France pour y exercer une activité de transport routier de manière stable.
Les entreprises issues d’un autre État membre de l’Union Européenne (UE) ou de l’Espace Économique Européen (EEE) bénéficient du principe de liberté d’établissement. Elles peuvent créer une succursale ou une filiale en France et demander leur inscription au registre français en respectant les mêmes conditions (honorabilité, capacité financière, capacité professionnelle) que les entreprises françaises. Leurs diplômes ou attestations de capacité professionnelle obtenus dans leur pays d’origine sont en principe reconnus mutuellement.
Pour les entreprises issues de pays tiers (hors UE/EEE), la situation est plus complexe. En principe, leur établissement en France n’est possible que s’il existe une convention internationale (souvent bilatérale) entre la France et leur pays d’origine le prévoyant, généralement sous condition de réciprocité. Toutefois, l’Accord Général sur le Commerce des Services (AGCS) de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a ouvert la possibilité d’établissement pour les ressortissants des pays membres de l’OMC, sous réserve qu’ils respectent l’ensemble des conditions françaises (y compris l’obtention de la capacité professionnelle en France, sans reconnaissance automatique des diplômes étrangers). Pour les ressortissants de pays non-membres de l’OMC et sans accord bilatéral, l’établissement reste très difficile, voire impossible.
Il est important de distinguer l’établissement stable de la simple prestation de services temporaire, comme le cabotage abordé dans notre guide sur les règles de circulation, qui obéit à des règles différentes.
Accéder à la profession de transporteur routier de marchandises est un parcours balisé par des exigences réglementaires précises et cumulatives. L’établissement, l’honorabilité, la capacité financière et la capacité professionnelle sont les piliers sur lesquels repose l’autorisation d’exercer, matérialisée par l’inscription au registre et la détention d’une licence valide. La complexité de ces démarches initiales et la nécessité de maintenir la conformité tout au long de la vie de l’entreprise soulignent l’importance d’une bonne préparation et d’un suivi attentif.
Assurer votre conformité dès le démarrage est essentiel. Notre cabinet vous accompagne dans vos démarches d’accès à la profession.
Sources
- Loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs (LOTI), modifiée.
- Code des transports (notamment les parties législatives et réglementaires relatives au transport routier).
- Décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises, modifié (notamment par Décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011).
- Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à remplir pour exercer la profession de transporteur par route.
- Arrêtés ministériels relatifs à la capacité financière, à la capacité professionnelle et aux titres administratifs de transport (notamment arrêtés du 17 et 18 novembre 1999, modifiés, et arrêtés du 28 décembre 2011).