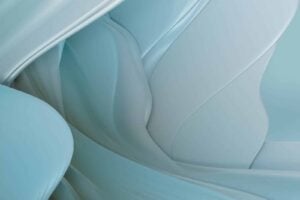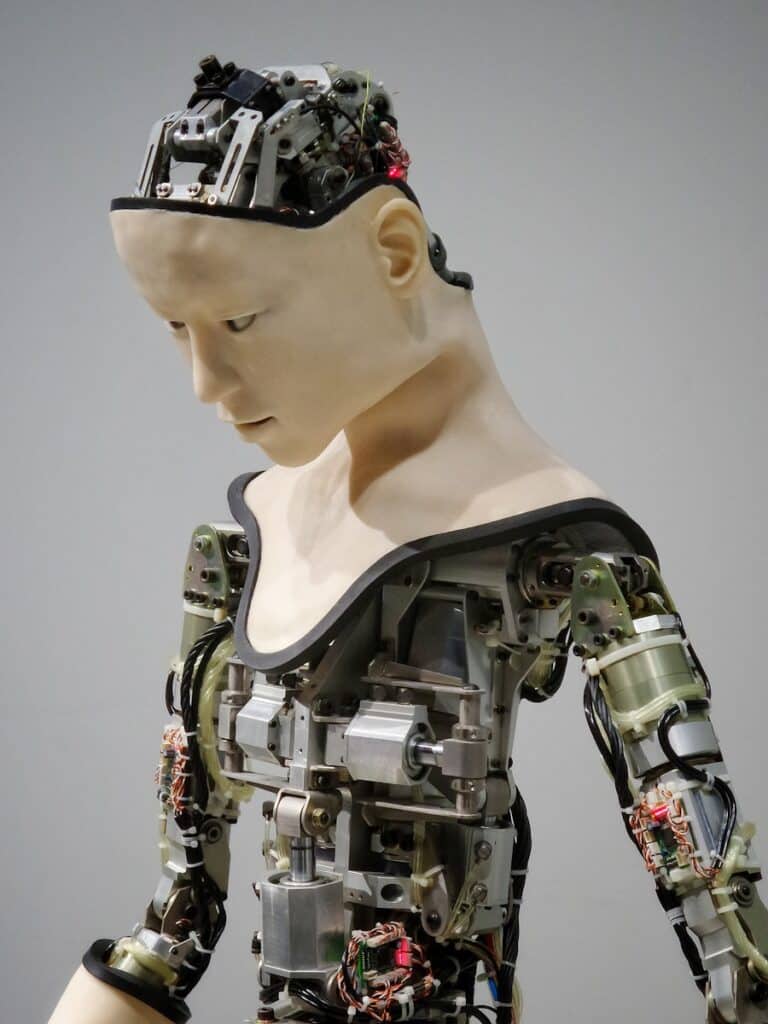Subir une saisie-attribution sur son compte bancaire est une épreuve financière souvent brutale et déstabilisante. Pratiquée sans avertissement préalable par un créancier muni d’un titre exécutoire, elle place le débiteur face au fait accompli.
La contestation de cette procédure complexe est possible, mais elle s’inscrit dans un cadre juridique et des délais légaux très stricts qu’il est impératif de maîtriser. La réaction doit être rapide et fondée sur des arguments juridiques solides pour avoir une chance de succès.
Avant de plonger dans les motifs de contestation, il est essentiel de bien comprendre les mécanismes en jeu. Pour une présentation détaillée du déroulement de cette procédure, notre article sur le fonctionnement de la saisie-attribution pose les bases essentielles.
Le cadre procédural strict de la contestation d’une saisie-attribution
La mise en œuvre de la procédure de saisie-attribution est initiée par la signification d’un acte de saisie au tiers saisi, le plus souvent votre banque. Cet acte, délivré par un commissaire de justice (anciennement huissier de justice), doit comporter des mentions obligatoires listées à l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, sous peine de nullité.
Il s’agit notamment de l’énonciation du titre exécutoire et du décompte précis des sommes dues en principal, intérêts et frais. L’heure de la signification doit également y figurer.
Le tiers saisi, par exemple l’établissement bancaire, a l’obligation de déclarer immédiatement au commissaire de justice l’étendue de ses obligations envers vous et de donner une réponse précise. Suite à cet acte de saisie, le commissaire de justice dispose d’un délai impératif de huit jours pour vous dénoncer la saisie.
Cette étape, appelée la dénonciation de la saisie, est cruciale. Si cette étape n’est pas respectée et que la saisie n’a pas été valablement dénoncée, elle est frappée de caducité, c’est-à-dire qu’elle est anéantie et perd tout effet.
C’est à compter de la réception de cet acte de dénonciation que s’ouvre pour vous le droit à la contestation. Vous disposez d’un délai de 1 mois pour agir.
Pour contester la saisie, il faut impérativement assigner le créancier saisissant à comparaître devant le tribunal compétent, en l’occurrence le juge de l’exécution (JEX) du lieu de votre domicile. L’assignation est un acte juridique formel, généralement rédigé par un avocat, qui expose les motifs de la contestation.
Sous peine d’irrecevabilité, une copie de cette assignation doit être dénoncée le même jour à l’huissier qui a pratiqué la saisie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette démarche a pour effet d’informer le commissaire de justice de la procédure de contestation et de suspendre le paiement des fonds jusqu’à la décision du juge.
Il est également requis d’en informer le tiers saisi (la banque) par lettre simple. Si le délai d’un mois expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Cinq arguments pour contester une saisie-attribution
La contestation d’une saisie-attribution peut reposer sur des vices de forme ou sur des arguments de fond remettant en cause la créance elle-même. Voici cinq motifs fréquemment invoqués devant le juge de l’exécution.
1. La nullité du titre exécutoire : le fondement de la saisie contesté
Pour pratiquer une saisie, le créancier doit détenir un titre exécutoire, comme le prévoit l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution. Un titre n’est considéré comme exécutoire que s’il est revêtu de la formule exécutoire, qui autorise le commissaire de justice à recourir à l’exécution forcée. Les titres exécutoires les plus courants sont les décisions de justice (jugements, ordonnances) et les actes notariés.
Une décision de justice de première instance est en principe exécutoire, même en cas d’appel. Cependant, l’exécution provisoire pourra avoir été suspendue par le premier président de la cour d’appel, par exemple celle de Paris.
Un acte notarié, pour être exécutoire, doit non seulement constater une créance mais aussi être revêtu de la formule exécutoire, ce qui n’est pas toujours le cas de toutes les copies.
La contestation peut donc être fondée sur le fait que l’acte présenté par le créancier n’est pas un titre exécutoire valide, soit parce que la décision de justice a perdu son caractère exécutoire, soit parce que l’acte notarié n’a jamais reçu la formule requise. Sans titre valable, la saisie est privée de tout fondement juridique et doit faire l’objet d’une mainlevée.
2. La prescription du titre exécutoire : une dette éteinte par le temps
L’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution fixe un délai de prescription pour l’exécution des titres exécutoires. En France, ce délai est de 10 ans pour les décisions de justice. Si le créancier n’a entrepris aucune démarche d’exécution pendant une période de 10 ans et que ce délai n’a pas été interrompu par un acte valable, le titre exécutoire est prescrit.
Le débiteur peut alors soulever la prescription de l’exécution du jugement. La prescription est une fin de non-recevoir : elle ne conteste pas le bien-fondé initial de la dette, mais empêche le créancier de la recouvrer par la force. Si le juge de l’exécution constate que la prescription est acquise, il doit débouter le créancier de ses demandes et ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution. Cet argument est particulièrement pertinent pour les dettes anciennes que l’on pensait oubliées.
3. L’absence de créance liquide et certaine : un montant contestable
Une saisie ne peut être pratiquée que pour une créance « liquide et exigible ». Une créance est liquide lorsque son montant est précisément déterminé en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. Si le montant réclamé par le créancier est incertain, la saisie peut être contestée. C’est souvent le cas pour des créances anciennes, ayant fait l’objet de paiements partiels non pris en compte, ou dont les intérêts ont été mal calculés suite à une erreur.
Le créancier doit être en mesure de fournir un décompte clair et justifié. En l’absence d’un historique de compte détaillé, il est impossible de vérifier l’exactitude des sommes réclamées, notamment les intérêts.
La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que le juge de l’exécution a le pouvoir et même le devoir de procéder à une demande de comptes entre les parties si cela est nécessaire (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 20-13.953). Refuser de le faire serait un déni de justice.
Le débiteur a donc tout intérêt à forcer le créancier à produire cet historique. Sans cette pièce, le juge ne pourra vérifier le caractère liquide de la créance et devra annuler la saisie.
4. Le défaut d’exigibilité de la créance : une dette non due immédiatement
La question de l’exigibilité se pose fréquemment dans les contrats de crédit à la consommation ou immobilier. Lorsqu’un emprunteur cesse de payer ses mensualités, la banque ou toute autre entreprise de crédit peut prononcer la « déchéance du terme ». Cette décision a pour effet de rendre immédiatement exigible la totalité du capital restant dû, et non plus seulement les échéances impayées. C’est sur la base de ce montant total que la saisie est souvent pratiquée.
Cependant, une jurisprudence constante de la Cour de cassation, notamment de la chambre commerciale à Paris, encadre cette pratique de manière stricte. La déchéance du terme ne peut être prononcée sans une mise en demeure préalable, laissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser sa situation (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655).
C’est une condition essentielle. Une clause qui priverait le débiteur de ce préavis pourra être jugée abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044). Si la procédure de déchéance du terme est irrégulière, la créance n’est pas considérée comme intégralement exigible. Seules les mensualités impayées le sont. Dans ce cas, la saisie-attribution pratiquée pour la totalité du prêt est infondée et doit être annulée.
5. La violation de l’ordre public consumériste : l’arme des clauses abusives
Cet argument, particulièrement complexe et renforcé par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), est d’une grande puissance. Il permet de remettre en cause une saisie même si elle se fonde sur une décision de justice devenue définitive. Le droit de la consommation est un droit d’ordre public, destiné à protéger la partie faible au contrat, c’est-à-dire le consommateur.
La CJUE a jugé que le juge de l’exécution a l’obligation de relever d’office le caractère abusif des clauses d’un contrat de consommation, même si le juge qui a rendu la décision initiale ne l’a pas fait. Auparavant, l’autorité de la chose jugée interdisait un tel réexamen.
Aujourd’hui, un débiteur peut, lors de la contestation d’une saisie-attribution, soulever la présence d’une clause abusive dans le contrat de crédit à l’origine de la dette. Si le juge de l’exécution reconnaît le caractère abusif d’une clause essentielle (par exemple, une clause d’intérêts), il peut paralyser l’exécution et ordonner la mainlevée de la saisie. Cette voie de recours offre une chance inespérée de tourner une nouvelle page et de contester une dette, même après une condamnation judiciaire.
Les biens et revenus insaisissables : une protection légale pour le débiteur
Il est important de savoir que la loi protège une partie de vos ressources financières. Toutes les sommes présentes sur un compte bancaire du débiteur, y compris un compte joint, ne sont pas intégralement saisissables. La contestation de la saisie peut aussi porter sur la violation de ces règles protectrices.
Le solde bancaire insaisissable (SBI)
Quelle que soit la nature de la dette (sauf pour une dette alimentaire), la loi impose à la banque de laisser à votre disposition une somme minimale sur votre compte bancaire. C’est le solde bancaire insaisissable (SBI). Son montant est forfaitaire et équivaut au montant du Revenu de Solidarité Active (RSA) pour une personne seule. Cette somme doit être laissée automatiquement sur votre compte, sans que vous ayez à en faire la demande. Si la banque a bloqué l’intégralité de votre compte sans respecter cette obligation, il s’agit d’un motif de contestation.
Les revenus à caractère alimentaire et social
Certaines sommes, en raison de leur nature, sont totalement ou partiellement insaisissables. Leur saisie est soumise à des règles spécifiques et non à la procédure de saisie-attribution de droit commun qui vise les créances saisissables classiques. Cela concerne principalement :
- Les prestations familiales et allocations sociales (allocations familiales, RSA, allocation de solidarité spécifique) qui sont en principe totalement insaisissables. Elles ne deviennent saisissables que pour le recouvrement de dettes spécifiques (par exemple, un indu de prestations sociales).
- Les pensions alimentaires, les prestations compensatoires, les rentes d’accident du travail et les rentes viagères versées à titre d’indemnité. Les capitaux ou rentes payables au titre d’un contrat d’assurance-vie sont également soumis à un régime spécifique et ne sont pas librement saisissables.
- Une partie de vos revenus du travail (salaires, traitements). Ces derniers ne peuvent être saisis que dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations, qui fixe des quotités saisissables en fonction du niveau de revenu. Cette procédure est distincte de la saisie-vente qui porte sur les biens matériels.
Si la saisie-attribution a porté sur des sommes déclarées insaisissables par la loi, sa validité est directement remise en cause. Le juge de l’exécution doit alors ordonner la mainlevée de la saisie sur ces fonds, qui n’étaient pas légalement saisissables.
La procédure de contestation d’une saisie-attribution est technique et les délais légaux pour agir sont très courts. Le choix des arguments doit être fait avec soin et étayé juridiquement pour convaincre le juge de l’exécution. Au-delà de ces motifs, une action peut parfois être fondée sur le caractère de la saisie-attribution abusive. Faire valoir ses droits dans cette procédure complexe nécessite une expertise juridique précise. Notre cabinet d’avocats vous accompagne pour analyser votre situation, vous offrir une assistance complète et mettre en œuvre la stratégie de contestation la plus adaptée.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la consommation
- Code de commerce