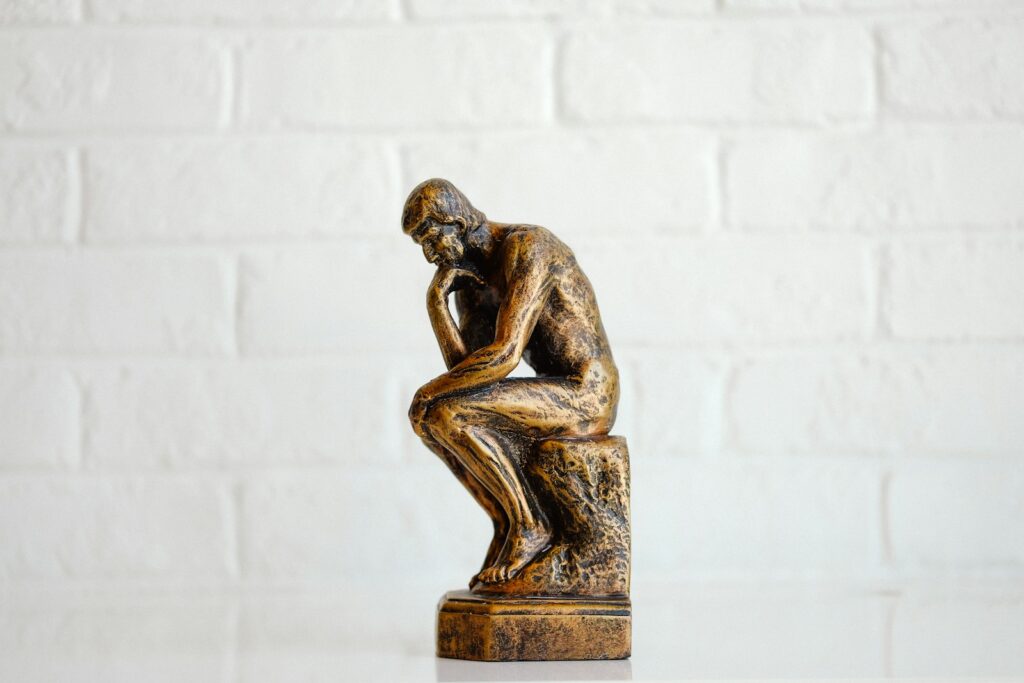« `html
Lorsqu’une entreprise entre en liquidation judiciaire, l’issue peut sembler inéluctable : la disparition de l’activité et la vente des actifs. Cependant, la procédure doit formellement se terminer, et cette fin, appelée clôture, peut revêtir différentes formes aux conséquences variables, notamment pour le débiteur personne physique. De plus, pour les entrepreneurs individuels confrontés à des difficultés mais disposant de très peu d’actifs, une alternative à la liquidation classique existe : le rétablissement professionnel. Cet article explore les modalités de clôture de la liquidation judiciaire et ses effets principaux, ainsi que les caractéristiques de la procédure de rétablissement professionnel.
La clôture de la liquidation judiciaire
La procédure de liquidation judiciaire n’est pas éternelle. Le tribunal fixe d’ailleurs dès l’ouverture un délai prévisionnel au terme duquel la clôture devra être examinée (Art. L. 643-9 C. com.). Ce délai (souvent deux ans initialement) peut être prorogé si nécessaire, mais l’objectif est bien de mettre un terme aux opérations. Cette clôture peut intervenir de deux manières distinctes, prévues par l’article L. 643-9 du Code de commerce.
Quand la procédure prend-elle fin ?
La clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par un jugement du tribunal, saisi par le liquidateur, le débiteur, le ministère public, ou même d’office. Après deux ans, tout créancier peut également en faire la demande. Deux motifs peuvent justifier cette clôture :
- La clôture pour extinction du passif : C’est l’hypothèse la plus favorable, mais aussi la plus rare en pratique. Elle intervient lorsque le liquidateur a réussi à désintéresser intégralement tous les créanciers (le passif exigible est éteint) ou lorsqu’il dispose des sommes suffisantes pour le faire. Dans ce cas, l’objectif d’apurement du passif est pleinement atteint.
- La clôture pour insuffisance d’actif : C’est le cas de figure le plus fréquent (plus de 95% des clôtures). Le tribunal prononce cette clôture lorsque la poursuite des opérations de liquidation est devenue impossible ou inutile faute d’actifs suffisants pour payer, même partiellement, les créanciers. Cela arrive quand tous les biens ont été vendus et que le produit de la vente ne suffit pas à couvrir les dettes, ou lorsque les actifs restants sont invendables ou d’une valeur si faible que leur vente entraînerait des frais disproportionnés. Le simple fait qu’il reste des actifs invendables ne suffit plus à empêcher la clôture depuis une modification législative visant à accélérer la fin des procédures.
Il est important de noter que le jugement de clôture met fin à la mission du liquidateur (qui doit rendre ses comptes) et du juge-commissaire.
Les effets majeurs de la clôture pour insuffisance d’actif
Si la clôture pour extinction du passif met simplement fin à la procédure, la clôture pour insuffisance d’actif a des conséquences bien plus significatives, en particulier pour le débiteur personne physique.
Principe : l’absence de reprise des poursuites par les créanciers
L’effet principal et le plus marquant de la clôture pour insuffisance d’actif est posé par l’article L. 643-11 du Code de commerce : elle ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Autrement dit, les créanciers dont les dettes n’ont pas été payées (ou seulement partiellement) pendant la liquidation ne peuvent plus, en principe, poursuivre le débiteur après la clôture pour obtenir le paiement du solde.
C’est une mesure forte, parfois qualifiée de « purge des dettes » ou de « droit à l’oubli », destinée à permettre au débiteur personne physique de « rebondir », de redémarrer une activité sans être indéfiniment poursuivi par le poids de son passé entrepreneurial. C’est la pérennisation de l’arrêt des poursuites qui avait été ordonné lors de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Pour les sociétés, la question se pose moins car la clôture pour insuffisance d’actif entraîne leur dissolution et la disparition de leur personnalité morale.
Cette règle ne signifie pas que la dette est éteinte juridiquement, mais que le créancier perd son droit d’action contre le débiteur principal. L’absence de recouvrement des poursuites est considérée comme nécessaire pour l’activité économique et l’emploi, permettant aux entrepreneurs ayant échoué de tenter une nouvelle aventure. La directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité encourage d’ailleurs les États membres à prévoir des mécanismes de remise de dettes pour les entrepreneurs.
Exceptions : quand les créanciers peuvent-ils agir à nouveau ?
Ce principe de non-recouvrement des actions connaît cependant d’importantes exceptions, listées à l’article L. 643-11 du Code de commerce. Dans ces cas, certains créanciers retrouvent leur droit de poursuivre le débiteur après la clôture pour insuffisance d’actif :
- Créances spécifiques exclues par nature :
- Les actions concernant des biens acquis par le débiteur via une succession ouverte pendant la procédure de liquidation.
- Les créances résultant d’une condamnation pénale du débiteur.
- Les créances liées à des « droits attachés à la personne du créancier » (par exemple, une pension alimentaire, une indemnisation pour préjudice corporel lié à une faute inexcusable de l’employeur).
- Les créances nées d’obligations environnementales spécifiques (remise en état d’un site classé, etc.).
- Les créances résultant de fraudes aux organismes de protection sociale.
- Cas liés au comportement du débiteur : Le « droit au rebond » n’est pas accordé au débiteur jugé « indigne » :
- Si le débiteur a été sanctionné par une faillite personnelle ou reconnu coupable de banqueroute.
- Si le débiteur est un « récidiviste » : c’est-à-dire s’il a déjà fait l’objet, lui ou une société qu’il dirigeait, d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif dans les 5 ans précédant l’ouverture de la nouvelle procédure. Il en va de même s’il a bénéficié d’un rétablissement professionnel dans les 5 ans.
- En cas de fraude du débiteur à l’égard d’un ou plusieurs créanciers. Cette fraude doit être constatée par le tribunal, soit lors de la clôture, soit ultérieurement sur demande de tout intéressé.
- Situation des cautions et coobligés : L’absence de reprise des poursuites est une exception personnelle au débiteur principal. Elle ne profite pas aux personnes qui se sont portées caution pour lui, ni aux coobligés (par exemple, les co-emprunteurs solidaires). Ces garants restent tenus de payer la dette et peuvent ensuite se retourner contre le débiteur (action récursoire), même après la clôture. Cette créance de recours de la caution ou du coobligé qui a payé à la place du débiteur n’est pas affectée par le principe de non-reprise des poursuites.
- Créanciers postérieurs privilégiés non payés : Les créanciers dont la créance est née après le jugement d’ouverture pour les besoins de la procédure ou de l’activité (Art. L. 641-13) et qui n’ont pas été payés recouvrent leur droit de poursuite individuelle. Le tribunal peut toutefois leur imposer des délais de paiement (jusqu’à 2 ans), sauf pour les créances publiques (impôts, URSSAF…).
- Procédure territoriale : Si la liquidation judiciaire ouverte en France était une procédure « territoriale » (secondaire) concernant l’établissement français d’une entreprise dont le siège est dans un autre pays de l’UE, les créanciers recouvrent leur droit de poursuite. Cela vise à éviter qu’une entreprise étrangère ne « liquide » ses dettes en France pour mieux recommencer ensuite.
Lorsqu’un créancier recouvre son droit d’agir, il doit obtenir un titre exécutoire (ou faire constater qu’il remplit les conditions s’il en a déjà un) avant de pouvoir engager des saisies contre le débiteur (Art. L. 643-11, V).
La fin du dessaisissement pour le débiteur personne physique
Dès le jugement de clôture (pour insuffisance d’actif comme pour extinction du passif), le débiteur personne physique n’est plus dessaisi. Il retrouve la pleine capacité d’administrer et de disposer de ses biens, de contracter, de créer une nouvelle entreprise (sauf sanction de faillite personnelle ou interdiction de gérer). Il peut également reprendre les actions en justice qui n’étaient pas liées au patrimoine liquidé ou recouvrer des créances oubliées par le liquidateur. La clôture suspend aussi l’interdiction d’émettre des chèques qui aurait pu le frapper avant la procédure, sauf si les créanciers recouvrent leur droit d’agir.
La possibilité de réouverture de la procédure
Même après une clôture pour insuffisance d’actif, la procédure peut être rouverte si des éléments nouveaux apparaissent (Art. L. 643-13 C. com.). Cette réouverture peut être demandée par tout créancier intéressé ou le ministère public. Les conditions sont strictes :
- Il faut découvrir que des actifs n’ont pas été réalisés.
- Ou qu’une action dans l’intérêt des créanciers a été omise (par exemple, une action en responsabilité contre un tiers).
La réouverture permet au liquidateur (le même ou un nouveau) de reprendre ses fonctions pour réaliser l’actif découvert ou engager l’action omise, puis de répartir les sommes obtenues. La réouverture fait revivre la procédure antérieure et produit ses effets rétroactivement pour tous les actifs qui auraient dû être réalisés avant la clôture initiale. Elle doit précéder toute action en responsabilité contre un liquidateur qui aurait été négligent.
Cas particulier : clôture malgré des instances en cours
Pour éviter que des liquidations ne s’éternisent uniquement à cause de procès longs et incertains (prud’hommes, responsabilité…), le tribunal peut désormais prononcer la clôture même si des instances initiées par le liquidateur sont encore en cours (Art. L. 643-9, al. 3 C. com.). Dans ce cas, le tribunal désigne un mandataire spécifique (souvent l’ancien liquidateur) dont la seule mission sera de poursuivre ces instances et de répartir les sommes éventuellement obtenues à leur issue. Le débiteur lui-même ne peut pas reprendre ces instances après la clôture.
Le rétablissement professionnel : une alternative sans liquidation ?
Face au constat que de nombreuses liquidations judiciaires concernent de très petites entreprises sans actifs significatifs (« impécunieuses »), rendant la procédure classique lourde et coûteuse pour un résultat quasi nul pour les créanciers, le législateur a créé en 2014 une procédure alternative : le rétablissement professionnel (Art. L. 645-1 et s. C. com.). Inspirée du rétablissement personnel pour les particuliers surendettés, cette procédure vise à offrir une sortie plus rapide et simplifiée à certains entrepreneurs individuels, aboutissant à un effacement de leurs dettes sans passer par une liquidation formelle.
À qui s’adresse cette procédure simplifiée ?
Les conditions d’éligibilité au rétablissement professionnel sont strictes et cumulatives (Art. L. 645-1, L. 645-2 C. com.) :
- Être une personne physique : La procédure est réservée aux entrepreneurs individuels (commerçants, artisans, professions libérales, agriculteurs). Les sociétés sont exclues. Depuis la loi de 2022, cela s’applique à l’entrepreneur individuel relevant du nouveau statut unique.
- Ne pas avoir de salarié : L’entreprise ne doit avoir employé aucun salarié au cours des 6 mois précédant la demande.
- Avoir un actif de faible valeur : La valeur de l’ensemble de l’actif déclaré (tous patrimoines confondus pour l’entrepreneur individuel nouveau statut) doit être inférieure à un seuil fixé par décret, actuellement 15 000 euros. Important : la résidence principale insaisissable de droit n’est pas prise en compte dans ce calcul.
- Être en cessation des paiements et redressement manifestement impossible : Les conditions de fond qui justifieraient une liquidation sont requises.
- Ne pas avoir d’instance prud’homale « en cours l’impliquant ».
- Ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an.
- Ne pas être un « récidiviste » : Ne pas avoir fait l’objet d’une liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’un rétablissement professionnel dans les 5 années précédentes.
- Être de bonne foi ? La bonne foi n’est pas explicitement une condition d’ouverture, mais son absence constatée en cours de procédure conduit obligatoirement à la conversion en liquidation judiciaire (Art. L. 645-9). Il est probable qu’une mauvaise foi flagrante dès le départ empêcherait l’ouverture.
Comment est-elle ouverte ?
Initialement, seul le débiteur pouvait demander le rétablissement professionnel. Face à sa faible utilisation, la loi PACTE de 2019 a rendu son examen obligatoire par le tribunal lorsqu’une demande de liquidation judiciaire est formée (par le débiteur, un créancier ou le ministère public) et que les conditions du rétablissement semblent réunies (Art. L. 645-3 C. com.). Le tribunal doit alors vérifier si le débiteur remplit les critères et, si c’est le cas, doit ouvrir la procédure de rétablissement professionnel, avec l’accord du débiteur. Cet examen préalable a lieu aussi en cas de résolution d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
La procédure elle-même est rapide (4 mois maximum). Le tribunal désigne un juge commis et un mandataire judiciaire (ou une personne qualifiée équivalente). Le mandataire informe les créanciers connus et recueille les informations sur le passif. Le juge commis enquête sur la situation du débiteur.
Quels sont ses effets principaux ?
Le rétablissement professionnel se distingue nettement de la liquidation :
- Pas de dessaisissement : Le débiteur conserve l’administration et la disposition de ses biens.
- Pas d’arrêt automatique des poursuites : Les créanciers peuvent continuer à agir, mais le juge commis peut accorder au débiteur des délais de paiement (max 4 mois) et suspendre les saisies pendant cette durée (Art. L. 645-6 C. com.).
- Effet majeur : l’effacement des dettes : Si la procédure aboutit, le jugement de clôture entraîne l’effacement de certaines dettes (Art. L. 645-11 C. com.). Sont concernées les dettes nées avant le jugement d’ouverture, qui ont été portées à la connaissance du juge commis et qui relevaient du patrimoine dont la situation est irrémédiablement compromise. L’effacement est l’objectif central de cette procédure « express ».
Les limites de l’effacement des dettes
L’effacement n’est cependant pas total et la procédure comporte des risques :
- Dettes non effaçables : Comme pour la clôture de la liquidation, certaines dettes sont exclues de l’effacement (Art. L. 645-11). Il s’agit notamment :
- Des créances salariales (si l’absence de salarié dans les 6 mois n’était pas respectée ou pour des dettes antérieures).
- Des pensions alimentaires.
- Des créances issues de condamnations pénales ou attachées à la personne du créancier.
- Des dettes fiscales et sociales ? Le texte ne les mentionne pas explicitement comme exclues de l’effacement, contrairement aux délais de paiement post-clôture de liquidation. La question reste débattue, mais il est probable qu’elles soient effacées si elles sont antérieures et connues.
- Des créances des cautions et coobligés ayant payé : ils conservent leur recours contre le débiteur.
- Des dettes nées après l’ouverture ou celles qui n’ont pas été portées à la connaissance du juge.
- Absence d’effacement si passif disproportionné : La loi de 2022 a ajouté qu’aucune dette ne peut être effacée si le passif total apparaît disproportionné par rapport à la valeur de l’actif (hors biens insaisissables de droit). C’est un garde-fou contre les abus.
- Remise en cause possible : Si, après la clôture, il s’avère que le débiteur a dissimulé des actifs ou minoré son passif, le tribunal peut, sur demande, rouvrir une procédure de liquidation judiciaire et annuler l’effacement des dettes (Art. L. 645-12 C. com.). Les créanciers recouvrent alors leurs droits.
La possible conversion en liquidation judiciaire
Le rétablissement professionnel n’est pas une garantie de succès. Si, au cours de la procédure de 4 mois, le juge commis constate que les conditions ne sont pas (ou plus) remplies (par exemple, découverte d’un actif supérieur au seuil, mauvaise foi du débiteur, absence de cessation des paiements avérée…), il fait un rapport au tribunal qui peut alors prononcer la conversion de la procédure de rétablissement en liquidation judiciaire (Art. L. 645-9 C. com.). Le débiteur se retrouve alors dans la procédure qu’il cherchait à éviter. Il en va de même si une fraude est découverte après la clôture.
Le choix entre la clôture de la liquidation et le rétablissement professionnel dépend donc crucialement de la situation spécifique de l’entreprise et de l’entrepreneur. Pour une analyse détaillée des conséquences pour les créanciers et la réalisation des actifs en liquidation, vous pouvez consulter notre article dédié. Un aperçu général du processus est également disponible.
Pour une analyse personnalisée de votre cas et obtenir un conseil juridique sur les issues de la liquidation, notre équipe se tient à votre disposition.
Sources
- Code de commerce : articles L. 643-9, L. 643-10, L. 643-11, L. 643-12, L. 643-13, L. 645-1 à L. 645-12, R. 643-16, R. 643-24, R. 644-2, R. 644-3, R. 645-1, R. 645-10, R. 645-11, R. 645-14, R. 645-18.
- Code civil : article 1844-7, 1844-8.
« `