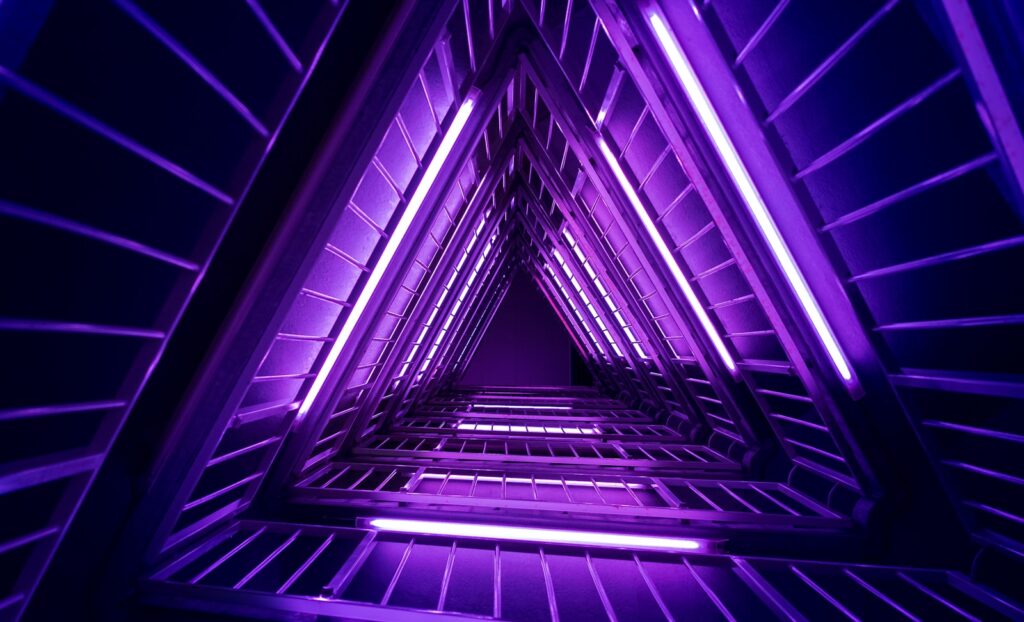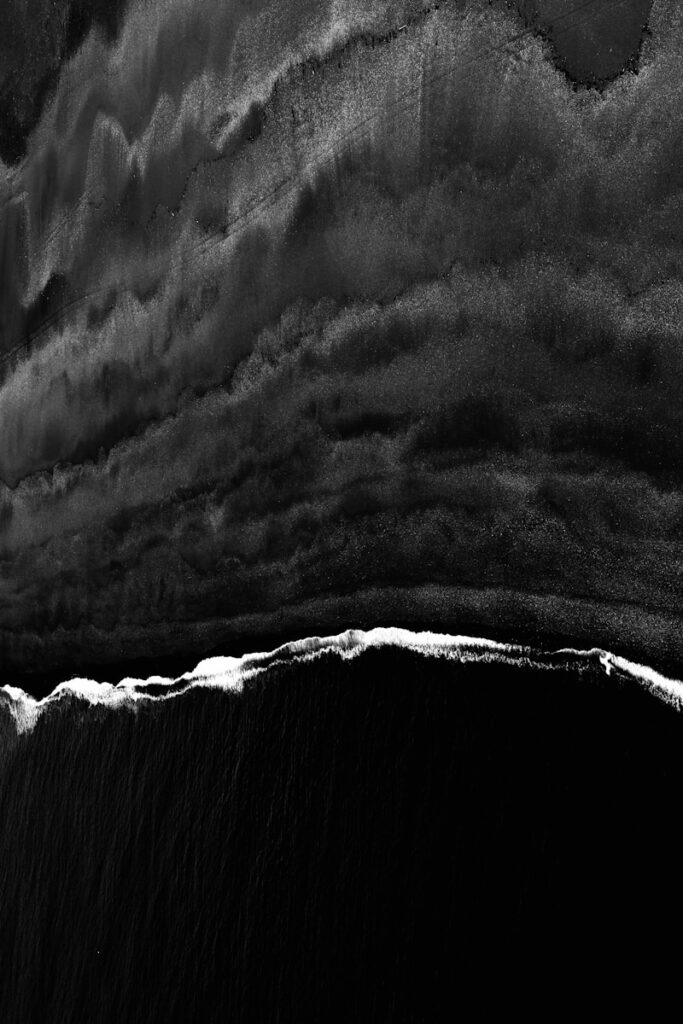La mise en place d’un réseau de distribution sélective permet à un fournisseur de choisir ses revendeurs sur la base de critères définis, afin de préserver son image de marque et d’assurer une commercialisation de qualité. Ce mécanisme, courant pour les produits de luxe, de haute technologie ou cosmétiques, se situe à la croisée des chemins entre la liberté contractuelle et le droit de la concurrence. Une mauvaise structuration de ces accords peut en effet conduire à des sanctions pour pratiques anticoncurrentielles. Notre cabinet, confronté régulièrement à des litiges en la matière, propose un éclairage sur la jurisprudence qui a façonné ce domaine. Il est essentiel pour une tête de réseau de comprendre les limites à ne pas franchir pour sécuriser ses canaux de vente, une problématique qui s’inscrit dans le cadre plus large des restrictions verticales en droit de la concurrence. Pour une assistance dans la défense de vos intérêts en cas de litiges liés aux réseaux de distribution, une expertise juridique est indispensable.
La licéité de principe des systèmes de distribution sélective
Contrairement à une idée reçue, la distribution sélective n’est pas en soi interdite par le droit de la concurrence. Elle est considérée comme une forme de concurrence « hors-prix », axée sur la qualité du service, qui peut être bénéfique pour le consommateur. Cependant, sa validité est soumise à des conditions strictes, largement définies par la jurisprudence européenne puis reprises par les autorités françaises.
La jurisprudence Metro I et II (conditions de licéité)
Les arrêts fondateurs de la Cour de Justice des Communautés Européennes, *Metro* de 1977 et 1986, ont posé les bases de la validité des réseaux de distribution sélective. Pour échapper à la qualification d’entente anticoncurrentielle, un tel système doit respecter trois conditions cumulatives. D’abord, la nature du produit doit justifier une sélection des revendeurs, par exemple en raison de sa technicité ou de son image de prestige. Ensuite, le choix des distributeurs doit s’opérer sur la base de critères qualitatifs, objectifs et vérifiables, comme la qualification du personnel ou l’aménagement du point de vente. Enfin, ces critères ne doivent pas être appliqués de manière discriminatoire et ne doivent pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir une distribution de qualité.
L’influence sur le droit français (Conseil de la concurrence)
Le droit français s’est rapidement aligné sur cette approche pragmatique. Le Conseil de la concurrence, devenu l’Autorité de la concurrence, a constamment appliqué les « critères Metro » pour évaluer la licéité des réseaux. Il examine si les restrictions imposées aux distributeurs sont proportionnées à l’objectif de préservation de la qualité et de l’image des produits. Cette analyse s’inscrit aujourd’hui dans le cadre plus global fixé par le Règlement (UE) 2022/720 sur les restrictions verticales, qui offre une exemption par catégorie à de nombreux accords verticaux, y compris la distribution sélective, à condition que les parts de marché du fournisseur et de l’acheteur ne dépassent pas 30 % et que l’accord ne contienne pas de restrictions caractérisées.
L’objectivité de la sélection des distributeurs
La pierre angulaire de la validité d’un réseau de distribution sélective réside dans le caractère objectif et qualitatif des critères d’agrément. Le fournisseur ne peut refuser un revendeur sur la base de considérations arbitraires. La jurisprudence a progressivement dessiné les contours de ce qui est acceptable.
Exigence de qualification professionnelle (Vichy, Givenchy)
Pour certains produits, la présence d’un personnel qualifié est une exigence légitime. Dans l’affaire *Vichy*, il a été jugé que la commercialisation de produits dermo-cosmétiques pouvait être réservée aux pharmaciens, en raison de leur capacité à fournir un conseil éclairé. De même, pour les parfums de luxe, la jurisprudence *Givenchy* a validé l’exigence d’une conseillère de beauté pour assister la clientèle. L’objectif est de garantir que le consommateur reçoive un niveau de service approprié à la nature du produit.
Critères liés à l’espace de vente (espace clos, vitrine)
L’environnement dans lequel le produit est vendu est un autre critère fréquemment utilisé, surtout dans le secteur du luxe. Les tribunaux ont admis la licéité de clauses imposant un espace de vente spécifique, séparé d’autres activités, ou la présence d’une vitrine pour la mise en valeur des produits. Ces exigences doivent toutefois être justifiées par la nécessité de maintenir une présentation prestigieuse et ne doivent pas avoir pour seul but d’exclure certains types de distributeurs de manière déguisée.
Compatibilité de l’enseigne avec l’image de marque
Un fournisseur est en droit de veiller à ce que l’enseigne et l’environnement global du point de vente ne portent pas atteinte à l’image de sa marque. Un magasin dont le positionnement serait manifestement incompatible avec le prestige des produits pourrait légitimement se voir refuser l’agrément. L’appréciation se fait cependant au cas par cas et le refus doit être motivé par des éléments tangibles et objectifs, et non par une simple perception subjective de l’inadéquation de l’enseigne.
Le principe de non-discrimination et la sélection quantitative
Même si les critères de sélection sont objectifs, ils doivent être appliqués de manière égale à tous les candidats distributeurs. Toute différence de traitement doit être justifiée. La limitation du nombre de distributeurs, ou sélection quantitative, est par ailleurs vue avec une méfiance accrue par les autorités.
Interdiction des clauses et applications discriminatoires (Binon, Biotherm)
La jurisprudence, notamment dans les affaires *Binon* et *Biotherm*, a sanctionné des réseaux où les critères, bien que licites en apparence, étaient en pratique appliqués de manière laxiste pour certains distributeurs et avec une extrême fermeté pour d’autres. Si un fournisseur admet dans son réseau des revendeurs qui ne respectent pas les conditions affichées, il ne peut plus ensuite opposer ces mêmes conditions pour refuser un nouvel entrant qui s’y conformerait. Une telle pratique révèle que l’objectif réel n’est pas la qualité de la distribution, but une restriction de la concurrence.
La sélection quantitative : limites et exceptions (Rolex, Seiko)
Limiter a priori le nombre de revendeurs dans une zone donnée (sélection quantitative) est une pratique bien plus restrictive que la simple sélection qualitative. Elle n’est admise que de manière très exceptionnelle. La jurisprudence, notamment dans les affaires d’horlogerie de luxe comme *Rolex* ou *Seiko*, a pu la valider lorsque le fournisseur démontre qu’elle est indispensable pour assurer une rentabilité suffisante à ses distributeurs, compte tenu des investissements importants qu’il leur impose pour la promotion et le service après-vente de produits très techniques. La preuve à apporter est cependant lourde.
L’exclusion de certaines formes de distribution
Historiquement, les têtes de réseau ont souvent tenté d’exclure purement et simplement certaines formes de vente jugées incompatibles avec leur image, comme la vente par correspondance ou, plus récemment, la vente en ligne. La jurisprudence a fortement encadré ces exclusions.
Interdiction de l’exclusion a priori (pharmacie, VPC)
Un principe fondamental est qu’aucune forme de commerce ne peut être exclue par principe. Un distributeur, qu’il soit une pharmacie, un grand magasin ou un vendeur par correspondance (VPC), doit être admis dans le réseau dès lors qu’il remplit les critères qualitatifs objectifs définis par le fournisseur. Refuser un agrément au seul motif que le candidat opère via un canal de distribution particulier est illicite.
La vente par internet : règles spécifiques et jurisprudence (Pierre Fabre, Coty, Stihl)
La question de la vente en ligne a donné lieu à un contentieux abondant. L’arrêt *Pierre Fabre* de 2011 a marqué un tournant en jugeant qu’une clause interdisant de manière générale et absolue la vente sur internet était une restriction caractérisée à la concurrence. Par la suite, l’arrêt *Coty* de 2017 a apporté une nuance importante : pour les produits de luxe, un fournisseur peut interdire à ses distributeurs agréés de vendre sur des plateformes tierces (marketplaces) qui ne sont pas contrôlées par le distributeur. La Cour a estimé qu’une telle interdiction était proportionnée à l’objectif de préservation de l’image de luxe. L’affaire *Stihl* a confirmé cette ligne pour des produits techniques nécessitant une démonstration physique. Ainsi, si l’interdiction totale est prohibée, des restrictions visant à encadrer les conditions de la vente en ligne pour préserver la qualité sont admises, comme détaillé dans notre analyse sur les restrictions verticales spécifiques au commerce en ligne.
La liberté commerciale des distributeurs
Une fois agréé, le distributeur doit conserver une certaine liberté commerciale. Le contrat de distribution sélective ne doit pas se transformer en un carcan annihilant toute autonomie. Les principales libertés concernent la politique tarifaire et les relations avec d’autres fournisseurs.
Liberté tarifaire et limites des prix imposés
C’est un principe cardinal du droit de la concurrence : le distributeur agréé est libre de fixer ses propres prix de revente. La tête de réseau peut communiquer des prix de vente conseillés, mais ne peut en aucun cas imposer des prix de vente minimaux. Une telle pratique constitue une restriction caractérisée, faisant perdre à l’accord le bénéfice de toute exemption et exposant l’entreprise à de lourdes sanctions.
Liberté de commercialiser des produits concurrents (clauses de marques, chiffre minimal)
Le fournisseur ne peut généralement pas imposer une exclusivité totale à ses distributeurs en leur interdisant de vendre des produits concurrents. De telles clauses de non-concurrence sont très strictement encadrées par le droit européen. Il est toutefois possible d’exiger qu’un certain chiffre d’affaires minimal soit réalisé avec les produits du réseau ou que les marques concurrentes ne bénéficient pas d’une mise en avant préjudiciable à la marque du fournisseur. L’équilibre est délicat et les clauses doivent être rédigées avec une grande prudence pour ne pas être jugées excessives.
La liberté des rétrocessions au sein du réseau
Les ventes entre membres agréés d’un même réseau de distribution sélective, aussi appelées rétrocessions, doivent en principe rester libres. Interdire à un distributeur de s’approvisionner auprès d’un autre membre du réseau est considéré comme une restriction anticoncurrentielle. Ces échanges permettent une meilleure gestion des stocks et favorisent une concurrence interne (intrabrande) qui bénéficie au consommateur final.
La protection des réseaux de distribution sélective
Un réseau licite et bien structuré a le droit de se défendre contre les ventes réalisées par des tiers non agréés. L’efficacité et la crédibilité du système dépendent de sa capacité à rester étanche.
L’étanchéité du réseau et sa licéité
Pour qu’un réseau sélectif soit considéré comme légitime, le fournisseur doit démontrer qu’il l’applique de manière cohérente et qu’il lutte activement contre les ventes parallèles. Si le fournisseur reste passif face à des revendeurs non agréés notoires, il perd sa légitimité à refuser de nouveaux entrants ou à imposer des contraintes à ses membres. L’étanchééité n’est pas seulement un droit, c’est aussi une condition de la validité du réseau.
Actions contre les distributeurs hors réseau (concurrence déloyale, marques)
La tête de réseau dispose de plusieurs outils juridiques pour agir contre les revendeurs non agréés. L’action en concurrence déloyale est la plus courante. Elle peut être engagée si le tiers a obtenu la marchandise par des moyens frauduleux (par exemple, en trompant un membre du réseau) ou si ses méthodes de vente dégradent l’image de marque des produits. Dans certains cas, lorsque les agissements du tiers relèvent d’une captation de la réputation et des efforts d’autrui, ils peuvent s’analyser en parasitisme économique. L’action en contrefaçon de marque peut également être envisagée si le revendeur non agréé altère les produits ou leur conditionnement, ou si la revente porte atteinte à la fonction de garantie d’origine de la marque.
La mise en place et la gestion d’un réseau de distribution sélective exigent une analyse juridique continue pour s’assurer de sa conformité. Pour une analyse approfondie de votre situation et un conseil adapté, prenez contact avec notre équipe d’avocats.
Sources
- Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), notamment les articles 101 et 102.
- Code de commerce, notamment les articles L. 420-1 et suivants sur les pratiques anticoncurrentielles.
- Règlement (UE) n° 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.