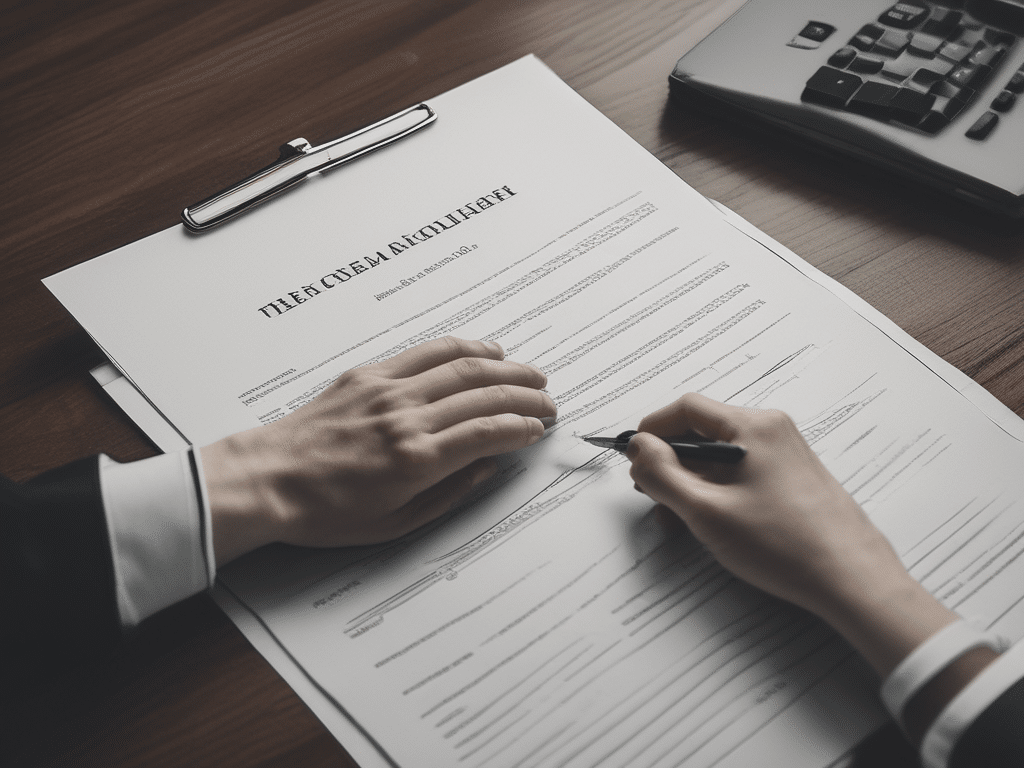La lettre de change, après sa création et sa possible circulation, arrive à son terme naturel : le paiement. C’est l’étape où le bénéficiaire, ou le dernier porteur, obtient la somme d’argent promise. Mais comment ce paiement se déroule-t-il concrètement ? Quelles sont les règles à respecter concernant l’échéance et la présentation ? Et surtout, que faire immédiatement si le paiement n’intervient pas comme prévu ?
Le règlement d’une lettre de change est encadré par des règles précises du Code de commerce, visant à concilier les intérêts du créancier (obtenir son dû) et ceux du débiteur (payer dans de bonnes conditions), tout en maintenant la sécurité nécessaire à cet instrument. Cet article vous guide à travers les aspects pratiques du paiement, de la détermination de l’échéance aux premières démarches en cas d’incident.
L’échéance : le moment clé du paiement
L’échéance est la date à laquelle la lettre de change devient exigible. Son indication sur le titre est une mention obligatoire, capitale pour toutes les parties. Pour une compréhension complète de la sécurité du paiement, notamment via la provision et l’acceptation, il est essentiel de maîtriser ces mécanismes.
Importance et types d’échéance
L’échéance fixe le jour où le porteur doit présenter la traite pour être payé et où le tiré doit s’acquitter de sa dette. Elle sert également de point de départ pour de nombreux délais importants, notamment ceux concernant les recours en cas d’impayé et la prescription des actions.
Rappelons brièvement les quatre types d’échéances possibles prévus par l’article L. 511-22 du Code de commerce :
- À jour fixe : Une date calendaire précise est indiquée.
- À un certain délai de date : Payable après un délai calculé à partir de la date de création.
- À un certain délai de vue : Payable après un délai calculé à partir de la date de sa présentation à l’acceptation (ou du protêt faute d’acceptation).
- À vue : Payable dès sa présentation au tiré.
Calculer et respecter l’échéance
La détermination précise du jour d’échéance suit des règles spécifiques, notamment pour les délais exprimés en mois ou jours (détaillées à l’article L. 511-24 du Code de commerce). Il faut aussi tenir compte des jours fériés. Si l’échéance tombe un jour férié légal, le paiement ne peut être exigé que le premier jour ouvrable suivant (article L. 511-79). Les jours fériés intervenant pendant le calcul d’un délai sont comptés, mais si le dernier jour du délai est férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. Des règles spécifiques existent aussi pour les paiements dans des pays utilisant des calendriers différents (article L. 511-25).
Il est possible de proroger conventionnellement l’échéance, soit en créant une nouvelle traite (renouvellement), soit en modifiant la date sur le titre existant. Attention cependant, une telle modification nécessite l’accord des parties concernées (notamment le tiré accepteur et les garants) pour leur être opposable et ne pas entraîner la perte des garanties. Des prorogations légales peuvent aussi intervenir en cas de force majeure ou de moratoires exceptionnels décrétés par les autorités (article L. 511-50).
Un principe fondamental régit l’échéance cambiaire : l’interdiction des délais de grâce. Sauf cas très exceptionnels prévus par la loi (recours anticipés), le débiteur d’une lettre de change ne peut obtenir de délai de paiement judiciaire ou légal. Il doit payer au jour dit (article L. 511-81).
La présentation au paiement : une obligation pour le porteur
Contrairement à une créance ordinaire, le porteur d’une lettre de change a l’obligation de la présenter activement au paiement pour conserver tous ses droits.
Quand présenter la traite ?
Le moment de la présentation dépend de l’échéance :
- Pour une traite à jour fixe, à un certain délai de date ou de vue, la présentation doit se faire soit le jour même de l’échéance, soit l’un des deux jours ouvrables qui suivent (article L. 511-26). Une loi de 1940, techniquement toujours en vigueur bien que datée, mentionne un délai de dix jours ouvrables, mais la prudence commande de respecter le délai de deux jours.
- Pour une traite à vue, la présentation doit intervenir dans le délai d’un an à compter de sa date de création (sauf si le tireur a fixé un délai différent, plus court ou plus long – article L. 511-23).
Il est interdit d’exiger le paiement avant l’échéance, sauf exceptions légales (ouverture d’une procédure collective du tiré, par exemple). Un paiement effectué par le tiré avant l’échéance se fait « à ses risques et périls » et pourrait ne pas être libératoire s’il paie une personne qui n’était pas le véritable porteur légitime (article L. 511-28).
Qui présente et où ?
Seul le porteur légitime (celui qui justifie de son droit par une suite ininterrompue d’endossements, ou son mandataire muni d’une procuration, ou un créancier gagiste) peut valablement présenter la traite au paiement. Le débiteur doit vérifier cette légitimité apparente (article L. 511-11). La présentation se fait au lieu indiqué pour le paiement sur la traite, qui est soit le domicile du tiré, soit le domicile d’un tiers désigné (le domiciliataire, souvent une banque).
La présentation à une chambre de compensation ou via les systèmes interbancaires de télécompensation (pour les Lettres de Change Relevé – LCR, par exemple) équivaut à une présentation au paiement (article L. 511-26, al. 2).
Conséquences du défaut de présentation
Le porteur qui ne présente pas la traite au paiement dans les délais requis est considéré comme négligent. Cette négligence entraîne la déchéance de ses recours cambiaires contre les endosseurs et contre le tireur qui aurait fourni provision (article L. 511-49). Il conserve cependant son action contre le tiré accepteur et contre le tireur qui n’aurait pas fait provision.
Pour se protéger de cette négligence, le débiteur qui constate que la traite n’est pas présentée peut consigner la somme due à la Caisse des dépôts et consignations aux frais et risques du porteur (article L. 511-30). Cette consignation le libère de sa dette.
La réalisation du paiement : qui paie ? qui reçoit ? comment ?
Le jour J est arrivé, la traite est présentée. Comment le paiement s’effectue-t-il ?
Les parties et leurs obligations
Le porteur légitime réclame le paiement. Celui qui doit payer est en premier lieu le tiré, qu’il ait accepté ou non. En cas de défaillance, le porteur se tournera vers les autres signataires (tireur, endosseurs, avalistes).
Pour que le paiement soit libératoire, le payeur (souvent le tiré) doit respecter certaines obligations :
- Vérifier la régularité apparente de la chaîne des endossements pour s’assurer qu’il paie bien le porteur légitime (article L. 511-11). Il n’a pas à vérifier l’authenticité des signatures des endosseurs.
- Ne commettre ni fraude, ni faute lourde (article L. 511-28). Payer sciemment un voleur ou malgré une opposition légale (voir article 4) constituerait une faute engageant sa responsabilité.
De son côté, le porteur doit remettre la traite acquittée au débiteur qui paie (article L. 511-27). C’est la contrepartie indispensable du paiement.
Les modalités de paiement
Plusieurs moyens sont possibles :
- Paiement en numéraire : C’est le mode classique. Si la traite est libellée en devise étrangère, le paiement peut se faire dans cette devise ou dans la monnaie du lieu de paiement, au cours du jour de l’échéance (sauf si le tireur a exigé un paiement effectif dans la devise étrangère – article L. 511-29).
- Paiement par chèque ou virement : Le porteur peut accepter d’être payé par chèque bancaire, chèque postal ou mandat de virement (article L. 511-40). Si ce moyen de paiement revient impayé (chèque sans provision, virement rejeté), le porteur doit accomplir des formalités spécifiques (protêt du chèque, notification du rejet) pour conserver ses recours liés à la lettre de change initiale. Le débiteur doit alors soit payer la traite et les frais, soit restituer la traite initialement remise.
- Paiement partiel : Contrairement au droit commun, le porteur d’une lettre de change ne peut pas refuser un paiement partiel qui lui serait offert (article L. 511-27, al. 2). Il doit l’accepter. Le débiteur peut exiger que ce paiement partiel soit mentionné sur la traite et qu’une quittance lui soit délivrée. Le porteur conserve ses recours pour le solde restant dû et doit faire dresser protêt pour ce montant.
Concernant l’imputation des paiements, si le débiteur a plusieurs dettes envers le porteur, les règles du Code civil (article 1342-10) s’appliquent : le débiteur peut indiquer quelle dette il entend régler, sinon le créancier peut faire l’imputation sur la quittance, et à défaut, on impute sur les dettes échues, puis sur celles que le débiteur avait le plus d’intérêt à acquitter.
La preuve et les effets du paiement
Une fois le paiement réalisé, comment le prouver et quelles en sont les conséquences ?
Prouver le paiement
La preuve principale est la remise de la lettre de change acquittée par le porteur au débiteur qui a payé. Le fait pour le débiteur de détenir le titre non acquitté fait naître une présomption simple de paiement en sa faveur (article 1342-9 du Code civil), mais le porteur peut prouver que la remise n’était pas volontaire ou faite pour une autre raison.
Effets du paiement
Le paiement valablement effectué éteint l’obligation cambiaire du débiteur qui a payé. Si ce paiement est fait par le tiré qui avait reçu provision, il libère également tous les autres signataires (tireur, endosseurs, avalistes). La lettre de change n’a plus de valeur juridique.
Si le paiement est effectué par un garant (tireur, endosseur, avaliste), il ne libère que ce garant et les signataires qu’il garantissait lui-même (ceux qui lui sont postérieurs dans la chaîne). Le garant qui a payé est alors subrogé dans les droits du porteur et peut exercer des recours contre ses propres garants (signataires antérieurs).
Attention au cas des exemplaires multiples. Le paiement d’un exemplaire est libératoire, sauf si le tiré avait accepté plusieurs exemplaires. Dans ce cas, il reste tenu sur chaque exemplaire accepté qu’il n’a pas récupéré (article L. 511-73).
Le paiement par intervention : une alternative en cas de défaillance
Si le tiré ne paie pas à l’échéance, un tiers (ou une personne déjà signataire autre que l’accepteur) peut se proposer de payer « par intervention » pour l’honneur d’un débiteur exposé au recours (article L. 511-67). Ce paiement, qui doit couvrir toute la somme due, doit être constaté par un acquit sur la traite indiquant pour qui il est fait. L’intervenant qui paie est alors subrogé dans les droits du porteur contre le débiteur pour qui il a payé et contre les garants de ce dernier (article L. 511-71).
Que faire en cas de défaut de paiement ? Le Protêt
Si, malgré la présentation, le tiré ne paie pas (totalement ou partiellement), le porteur doit réagir vite pour préserver ses droits contre les garants. La première étape est, sauf dispense, de faire constater officiellement ce défaut de paiement. Pour aller plus loin dans la gestion des impayés et des autres imprévus liés à la lettre de change, consultez notre article dédié.
Le protêt faute de paiement : définition et rôle
Le protêt faute de paiement est un acte authentique dressé par un huissier de justice ou un notaire, qui constate la présentation de la lettre de change et le refus (ou l’impossibilité) de paiement par le tiré ou le domiciliataire. C’est une formalité indispensable pour que le porteur puisse exercer ses recours cambiaires contre le tireur et les endosseurs (sauf exceptions).
L’obligation de faire dresser protêt
Le porteur doit faire dresser ce protêt dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où la traite est payable (article L. 511-39). Ce délai est crucial. Le protêt doit être dressé au lieu de paiement indiqué sur la traite.
Les dispenses de protêt
Le porteur est dispensé de faire dresser protêt dans certains cas :
- Clause « retour sans frais » ou équivalente sur la traite. Mais attention, cela ne dispense pas de présenter la traite au paiement dans les délais !
- Si un protêt faute d’acceptation a déjà été dressé.
- En cas de procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) ouverte contre le tiré (accepteur ou non), la production du jugement suffit.
- En cas de force majeure empêchant la présentation ou le protêt (avec des règles spécifiques selon la durée de l’empêchement – article L. 511-50).
Contenu, avis et publicité
Le protêt doit contenir des mentions précises (transcription de la traite, sommation de payer, réponse du débiteur, etc. – article L. 511-53). L’officier ministériel qui dresse le protêt doit en aviser le tireur (si son adresse est connue) dans les 48 heures (article L. 511-42). Le porteur doit aussi aviser son propre endosseur, qui avisera le sien, et ainsi de suite. Le défaut d’avis n’entraîne pas la déchéance des recours, mais peut engager la responsabilité de celui qui a omis l’avis.
Enfin, les protêts faute de paiement concernant des lettres de change acceptées font l’objet d’une publicité via une inscription sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce (articles L. 511-55 et suivants) et sont centralisés par la Banque de France, ce qui peut affecter le crédit du débiteur défaillant.
Alternatives au paiement classique : autres modes d’extinction
L’obligation née de la lettre de change peut aussi s’éteindre par les mécanismes classiques du droit civil : dation en paiement (donner autre chose que de l’argent), novation (remplacer l’obligation par une nouvelle, par exemple via un renouvellement d’effet), remise de dette, compensation (si porteur et débiteur sont réciproquement créanciers et débiteurs), confusion (si le porteur devient débiteur principal).
Un mode spécifique au droit bancaire est la contre-passation : lorsqu’une banque a escompté une traite qui revient impayée, elle peut débiter le compte de son client remettant. Cette opération vaut paiement et éteint le recours cambiaire de la banque contre le remettant (sauf si le compte est clôturé ou si le remettant est en procédure collective, auquel cas les règles sont différentes).
Le paiement d’une lettre de change ou la gestion d’un impayé soulèvent des questions juridiques précises. Respecter les délais et les formalités est essentiel pour préserver vos droits. Si vous rencontrez des difficultés de paiement ou d’encaissement, notre cabinet peut vous assister dans vos démarches en droit commercial.
Sources
- Code de commerce, notamment articles L. 511-11, L. 511-13, L. 511-22 à L. 511-43, L. 511-49, L. 511-50, L. 511-52 à L. 511-59, L. 511-67 à L. 511-71, L. 511-73, L. 511-79 à L. 511-81.
- Code civil, notamment articles 1342-4, 1342-9, 1342-10, 1345 et suivants.