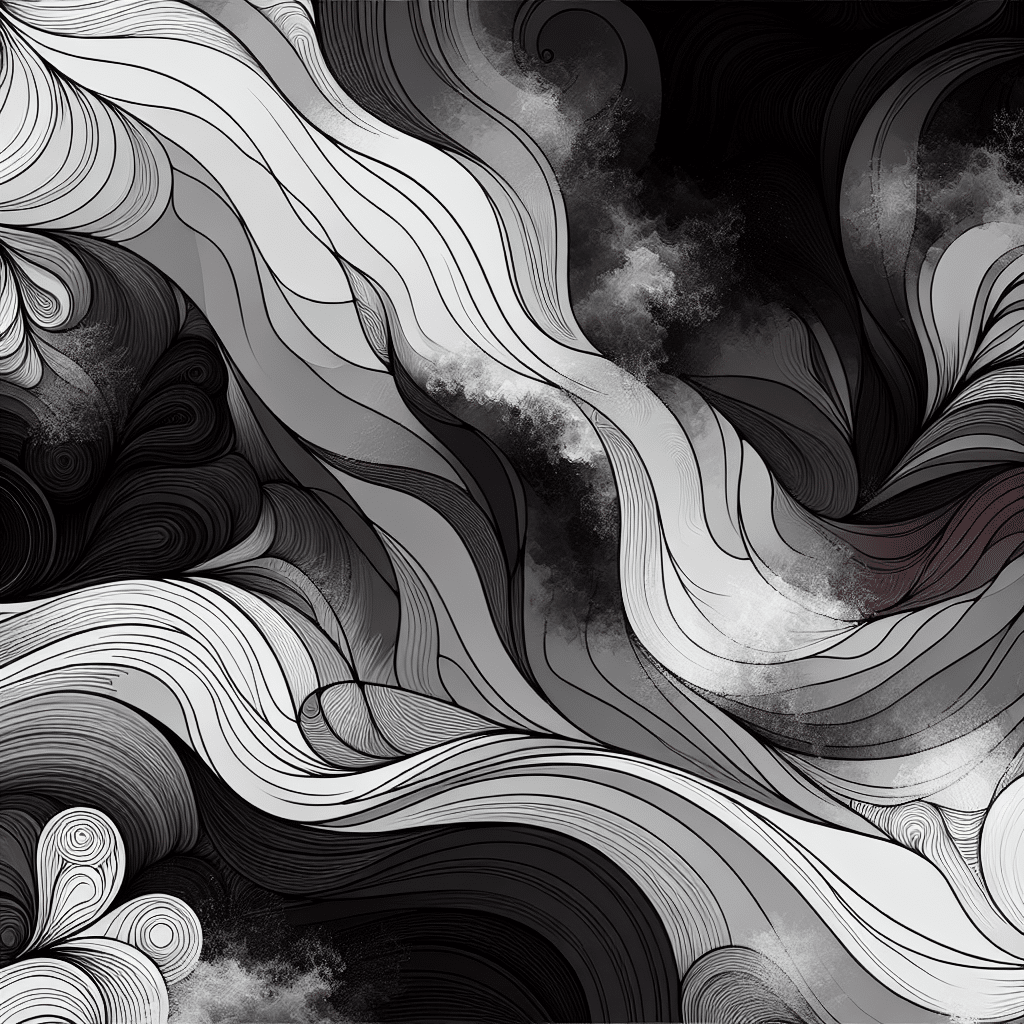L’univers de l’aviation, qu’il s’agisse de transport commercial, d’affaires ou de loisirs, repose sur une technologie sophistiquée et des opérations complexes. Mais derrière le vrombissement des réacteurs et la logistique des vols se cache une réalité incontournable : le risque. Des incidents mineurs aux catastrophes majeures, les conséquences financières peuvent être considérables. C’est ici qu’intervient l’assurance aérienne, un mécanisme indispensable qui permet aux acteurs du secteur de se prémunir contre les aléas inhérents à leur activité. Comprendre ses fondements – les dangers spécifiques qu’elle couvre, les particularités de son marché et l’environnement réglementaire qui l’encadre – est essentiel pour toute entreprise ou personne impliquée dans l’aéronautique.
Quels sont les risques couverts par l’assurance aérienne ?
Le besoin d’assurance dans le secteur aérien découle de la multitude de dangers potentiels. On peut distinguer deux grandes catégories de risques auxquels les polices d’assurance tentent de répondre.
Les risques « ordinaires » liés à l’aéronautique
Ces risques, bien que courants dans leur nature, prennent une dimension particulière dans le contexte aérien. Il s’agit d’abord des dommages pouvant affecter l’aéronef lui-même. Un avion au sol n’est pas à l’abri d’un incendie, d’une explosion ou même d’un vol. Ces événements, similaires à ceux qui peuvent toucher n’importe quel bien de valeur, nécessitent une couverture spécifique compte tenu du coût élevé des appareils.
Au-delà des dommages matériels à l’appareil, la principale préoccupation concerne la responsabilité civile. De nombreux acteurs peuvent voir leur responsabilité engagée suite à un événement lié à l’activité aéronautique. L’exploitant de l’aéronef, le pilote, le transporteur, mais aussi les gestionnaires d’aérodromes ou les associations aéronautiques peuvent être tenus de réparer les dommages causés à des tiers. Ces dommages peuvent résulter d’une grande variété d’événements : un accident au sol ou en vol, une erreur de pilotage aux conséquences tragiques, la chute de pièces détachées, une panne mécanique ou même des conditions météorologiques imprévues.
Pour les transporteurs aériens, le régime de responsabilité est très encadré par des conventions internationales, notamment la Convention de Varsovie de 1929 et, plus récemment, la Convention de Montréal de 1999, qui a considérablement renforcé les droits des passagers. Le droit français s’aligne sur ces textes, comme le prévoit l’article L. 321-3 du Code de l’aviation civile. Ces conventions établissent souvent une responsabilité de plein droit, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute, mais assortie de plafonds d’indemnisation, même si la tendance est à l’augmentation de ces plafonds et à une responsabilité quasi illimitée pour les dommages corporels. L’assurance responsabilité civile des transporteurs doit donc impérativement tenir compte de ce cadre légal spécifique.
Enfin, comme dans d’autres secteurs, des assurances de personnes, type assurance décès ou invalidité, trouvent naturellement leur place pour couvrir les conséquences humaines d’un accident aérien, que ce soit pour les passagers ou les équipages.
La prise en compte des risques exceptionnels
L’assurance aérienne doit aussi composer avec des risques d’une nature plus exceptionnelle, souvent liés au contexte géopolitique ou à des actes de malveillance. Historiquement, les assureurs ont pu proposer, souvent moyennant une surprime significative, des couvertures pour des événements normalement exclus, tels que les dommages résultant de guerres (civiles ou étrangères), d’insurrections, d’émeutes, de grèves avec violence, d’actes de sabotage ou de détournements d’avions.
La couverture du risque terroriste est devenue une préoccupation majeure, en particulier après les attentats du 11 septembre 2001. Cet événement a eu un impact considérable sur le marché de l’assurance aérienne. Dans un premier temps, face à l’ampleur potentielle des sinistres, de nombreux assureurs ont brutalement résilié leurs garanties couvrant le terrorisme. Par la suite, ces garanties ont été progressivement remises en vigueur, mais à des conditions tarifaires beaucoup plus élevées et avec des clauses permettant aux assureurs de se retirer plus facilement en cas de nouvelle crise majeure.
Ces péripéties ont ouvert un débat, notamment au sein de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), sur la pertinence de faire supporter l’intégralité de ce risque systémique par le seul marché privé de l’assurance. L’idée que les États devraient assumer une part significative du risque terroriste, considéré comme relevant davantage de la sécurité nationale que de l’assurance classique, a fait son chemin, sans pour autant aboutir à une solution globalisée à ce jour. Cette question illustre bien le lien étroit entre les risques à couvrir et la structure même du marché de l’assurance.
Comment fonctionne le marché de l’assurance aérienne ?
Le secteur de l’assurance aérienne présente des caractéristiques qui le distinguent nettement des autres branches de l’assurance.
Un marché international et concentré
L’assurance aérienne est, par nature, un marché globalisé. Les risques sont souvent transnationaux et les montants en jeu, notamment pour assurer les flottes des grandes compagnies aériennes ou couvrir leur responsabilité en cas de catastrophe, sont colossaux. Aucune compagnie d’assurance nationale, même la plus importante, ne pourrait supporter seule de tels engagements.
En conséquence, le recours à la réassurance est systématique et massif. Les assureurs directs (ceux qui délivrent la police à la compagnie aérienne ou à l’exploitant) ne conservent qu’une part limitée du risque et cèdent le reste à des réassureurs répartis dans le monde entier. Ce mécanisme de partage des risques est indispensable à la viabilité du système.
Ce besoin de mutualisation à grande échelle a conduit à une forte concentration du marché. Relativement peu d’acteurs sont véritablement des « assureurs aviation » agréés pour couvrir l’ensemble des risques spécifiques (corps de l’aéronef, marchandises transportées, responsabilité civile aérienne). Si la plupart des grands groupes d’assurance français sont présents sur ce segment, le centre de gravité historique et opérationnel se situe très largement au Royaume-Uni, autour du marché du Lloyd’s de Londres et de l’International Underwriting Association (IUA). Cette prédominance britannique confère au marché londonien un rôle directeur dans la fixation des conditions et des tarifs.
Organisation et régulation du marché
Cette concentration et l’interdépendance forte entre assureurs et réassureurs favorisent une collaboration étroite. Des comités d’assureurs, souvent basés à Londres, jouent un rôle important dans l’élaboration des clauses standardisées qui forment la base de la plupart des polices d’assurance aérienne dans le monde.
Cette proximité peut cependant frôler des pratiques anticoncurrentielles. La crise qui a suivi les attentats de 2001 a mis en lumière ce risque. La décision quasi simultanée de tous les grands assureurs de suspendre les garanties terrorisme, puis de les rétablir à des conditions tarifaires très similaires, a suscité des soupçons d’entente. Des associations d’usagers ont saisi la Commission européenne, qui a ouvert une enquête pour violation potentielle des règles de concurrence du Traité CE (aujourd’hui article 101 du TFUE).
L’affaire s’est finalement réglée par un accord amiable. Les assureurs ont accepté des réformes visant à introduire plus de transparence et à garantir un fonctionnement plus concurrentiel. La création de l’Aviation Insurance Clauses Group (AICG) permet désormais une participation officielle des assurés à l’élaboration des clauses standard. Par ailleurs, un nouveau forum de liaison (« Aviation Liaison Forum ») a remplacé l’ancien comité exécutif conjoint avec un mandat plus restreint, afin d’éviter une coordination excessive entre les principales associations d’assureurs. Un protocole de gestion de crise a également été mis en place pour tenter de maintenir un minimum de concurrence même en période de forte tension sur le marché.
Quel est le cadre juridique applicable ?
L’assurance aérienne ne flotte pas dans un vide juridique. Bien au contraire, elle est soumise à un ensemble complexe de règles issues de différentes sources, qui viennent encadrer la liberté contractuelle pourtant revendiquée dans ce domaine des « grands risques ».
L’influence prépondérante du droit aérien
L’activité aérienne elle-même est l’une des plus réglementées au monde. La sécurité est la préoccupation numéro un. La Convention de Chicago de 1944 pose les bases de la réglementation internationale, déclinée au niveau national par des textes comme le Code de l’aviation civile en France. Ces textes imposent des exigences très strictes concernant la conception, la construction, l’entretien et la navigabilité des aéronefs, ainsi que la formation et les licences des équipages. Le respect scrupuleux de ces normes, contrôlé par des autorités comme la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), constitue le socle technique sur lequel les assureurs évaluent les risques et accordent leurs garanties. Le non-respect de ces règles peut entraîner un refus de couverture en cas de sinistre.
Au-delà de la sécurité technique, le droit aérien régit aussi les relations commerciales, notamment le contrat de transport. Les droits des passagers ont été significativement renforcés, par exemple par le règlement européen n∘261/2004 qui impose des obligations d’indemnisation et d’assistance en cas de refus d’embarquement, d’annulation ou de retard important.
Comme évoqué précédemment, l’évolution de la responsabilité civile des transporteurs aériens, sous l’impulsion des conventions internationales (passage progressif de Varsovie à Montréal), a un impact direct sur les besoins d’assurance. L’augmentation des limites d’indemnisation et l’élargissement des préjudices couverts obligent les compagnies à souscrire des garanties de responsabilité civile plus élevées.
Le rôle du droit des assurances
Paradoxalement, le Code des assurances français est relativement discret sur l’assurance aérienne. Son article L. 111-1 précise que les règles générales du contrat d’assurance (Titres I, II et III du Livre Ier) ne concernent, sauf exceptions, que les assurances terrestres. Les assurances maritimes et fluviales ont leur propre régime (Titre VII). L’assurance aérienne n’est mentionnée que de manière incidente, par exemple pour l’exclure du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles pour les dommages aux aéronefs (article L. 125-5).
Ce silence a longtemps alimenté des débats juridiques. Dans la pratique, cependant, les autorités de contrôle françaises ont historiquement exigé que les polices d’assurance aérienne commercialisées en France se réfèrent au Code des assurances. Cette pratique, devenue une sorte de coutume, a conduit à ce que la plupart des contrats mentionnent qu’ils sont régis par le Code des assurances.
Cette référence, bien que d’origine pragmatique, n’est pas sans conséquence. Elle soumet de facto les contrats d’assurance aérienne aux nombreuses dispositions d’ordre public du Code des assurances français, conçues initialement pour protéger les assurés dans le cadre des assurances terrestres « de masse ». Par exemple, la règle selon laquelle l’assureur peut opposer au tiers victime les exceptions qu’il pourrait opposer à son assuré (article L. 112-6) a été appliquée par la Cour de cassation à une assurance aérienne. Cela nuance l’idée d’une liberté contractuelle totale dans ce domaine, classé pourtant parmi les « grands risques » où les parties sont censées être plus équilibrées (article L. 111-6).
Une clarification partielle est intervenue avec l’ordonnance n∘ 2011-839 du 15 juillet 2011 et son décret d’application n∘ 2012-850 du 4 juillet 2012. Ces textes ont créé des chapitres spécifiques dans le Code des assurances pour les risques aériens et aéronautiques. Ils précisent notamment que les règles générales du contrat d’assurance terrestre (Titres I à III du Livre Ier) s’appliquent obligatoirement aux contrats souscrits par les associations aéronautiques (aéroclubs) et, sur option, à ceux souscrits par des professionnels utilisant exclusivement certains types d’aéronefs légers (moins de 5700 kg pour les avions hors turboréacteurs, moins de 2700 kg pour les autres). Pour les autres assurances aériennes, notamment celles des grandes compagnies, le flou juridique sur le droit applicable subsiste, même si la référence au Code des assurances reste la pratique dominante.
L’obligation d’assurance : une exigence croissante
Enfin, comme dans beaucoup d’autres domaines à risque, l’obligation de s’assurer s’est développée en matière aéronautique. Le droit français impose depuis longtemps une assurance de responsabilité civile à de nombreux acteurs : exploitants d’aérodromes, aéroclubs, organisateurs de manifestations aériennes, etc. Cette assurance est souvent une condition pour obtenir l’autorisation administrative d’exercer l’activité.
L’Union européenne a également renforcé ces exigences, notamment avec le règlement n∘785/2004 du 21 avril 2004, entré en vigueur en 2005. Ce texte, directement applicable dans les États membres, impose aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs opérant dans l’espace aérien européen (vols intra-UE, à destination ou en provenance de l’UE) des exigences minimales d’assurance. L’objectif est d’aligner les couvertures sur les niveaux de responsabilité prévus par la Convention de Montréal.
Le règlement exige une couverture minimale pour la responsabilité à l’égard des passagers, des bagages, du fret et des tiers au sol. Il impose également explicitement que la police couvre les risques liés aux actes de guerre, au terrorisme, à la piraterie aérienne, au sabotage, à la capture illicite d’aéronefs et aux troubles civils. Des montants minimaux d’assurance sont fixés, variant notamment en fonction du poids de l’appareil pour la responsabilité envers les tiers.
Le règlement prévoit des exclusions pour certains types d’appareils (aéronefs d’État, modèles réduits, certains ULM et planeurs légers pour des usages non commerciaux). Toutefois, une ambiguïté rédactionnelle demeure quant à savoir si cette exclusion vise uniquement l’obligation d’assurer les risques de guerre/terrorisme pour ces appareils, ou si elle les exempte totalement de l’obligation d’assurance prévue par ce règlement. L’interprétation la plus probable, confirmée par les considérants du texte, est une exemption totale, mais le texte mériterait clarification.
Les exploitants doivent prouver qu’ils respectent ces obligations en déposant un certificat d’assurance auprès des autorités compétentes de l’État membre. Le non-respect peut entraîner des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives », pouvant aller jusqu’au retrait de la licence d’exploitation pour un transporteur européen ou au refus d’atterrissage pour un transporteur non européen. On note cependant qu’aucun mécanisme de type « bureau central de tarification », comme il en existe pour l’assurance automobile, n’est prévu pour forcer un assureur à couvrir un risque que le marché refuserait.
La complexité des risques et du cadre légal de l’assurance aérienne nécessite une analyse experte. Pour vérifier la conformité de vos couvertures ou évaluer vos besoins, notre cabinet se tient à votre disposition.
Sources
- Code des assurances (notamment art. L. 111-1, L. 111-6, L. 112-6, L. 125-5, L. 171-5 et suivants)
- Code de l’aviation civile (notamment art. L. 321-3)
- Règlement (CE) n° 785/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif aux exigences en matière d’assurance applicables aux transporteurs aériens et aux exploitants d’aéronefs
- Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol
- Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Montréal) du 28 mai 1999
- Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (Convention de Varsovie) du 12 octobre 1929
- Convention relative à l’aviation civile internationale (Convention de Chicago) du 7 décembre 1944
- Ordonnance n° 2011-839 du 15 juillet 2011 relative aux assurances en matière de transport
- Décret n° 2012-850 du 4 juillet 2012 précisant les contrats d’assurance aérienne et aéronautique soumis à certaines dispositions du code des assurances