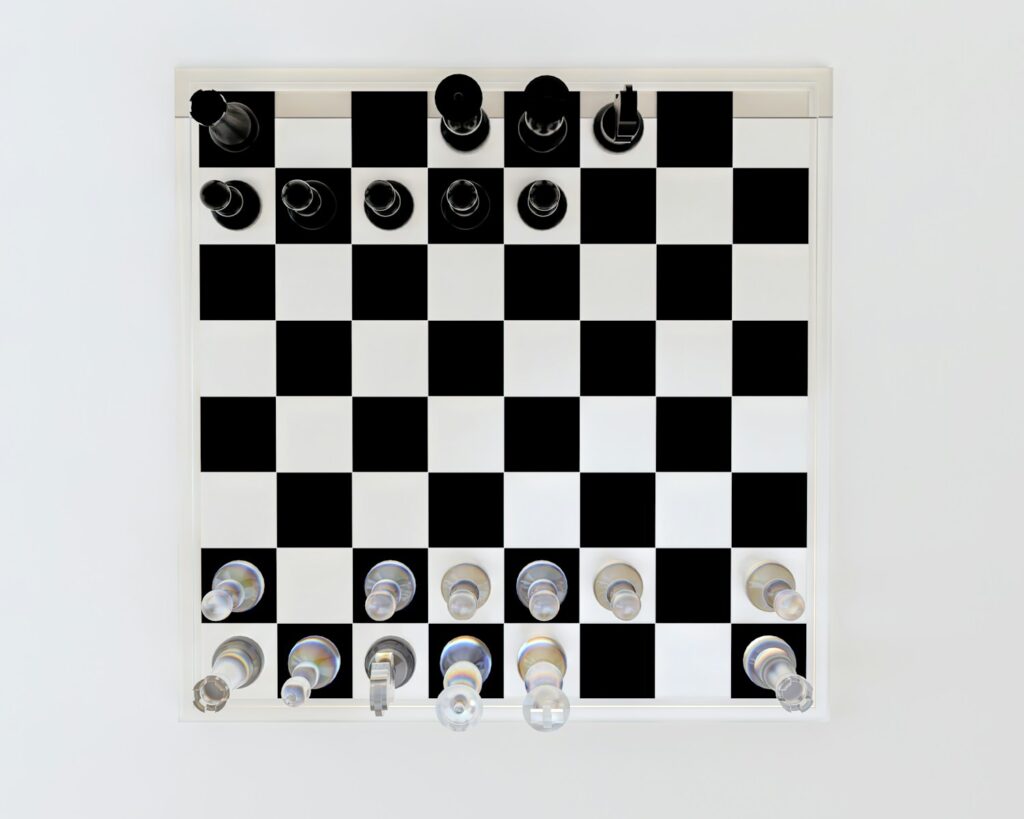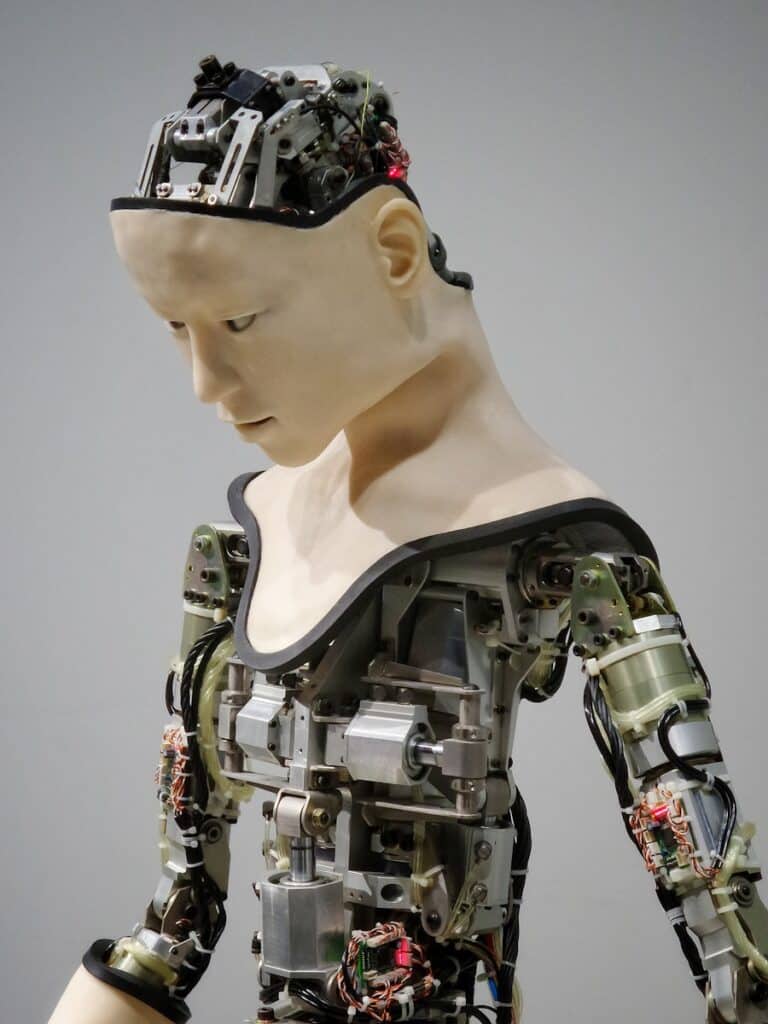L’astreinte constitue un outil juridique fondamental pour contraindre un débiteur à exécuter ses obligations. Toutefois, son application varie selon les domaines du droit. Certains régimes dérogatoires modifient sensiblement son fonctionnement, sa liquidation et ses effets. Examinons les particularités de l’astreinte en matière d’expulsion, en droit pénal, en droit administratif et dans les litiges internationaux.
1. L’astreinte en matière d’expulsion : un régime protecteur
Un régime dérogatoire issu de la loi du 21 juillet 1949
La loi n°49-972 du 21 juillet 1949, désormais codifiée aux articles L.421-1 et L.421-2 du Code des procédures civiles d’exécution, instaure un régime spécifique pour les astreintes en matière d’expulsion. Ce régime limite considérablement l’efficacité de l’astreinte par rapport au droit commun.
« Les astreintes fixées pour obliger l’occupant d’un local à quitter les lieux ont toujours un caractère provisoire » (art. L.421-1 CPCE).
Ce texte s’enracine dans un contexte historique de crise du logement d’après-guerre. Mais sa persistance aujourd’hui paraît anachronique et déséquilibre les droits du propriétaire.
Un domaine d’application strictement encadré
La jurisprudence s’efforce de limiter le champ d’application de ce régime dérogatoire. Ainsi, n’entrent pas dans son périmètre :
- L’occupation d’un terrain nu (Com. 23 déc. 1964, Bull. civ. III, n°589)
- Les baux ruraux (Soc. 28 déc. 1951, D. 1952. 665)
- L’occupation suite à adjudication (Civ. 2e, 10 fév. 2000, n°98-13.354)
- L’entrée frauduleuse dans les lieux (Civ. 2e, 10 fév. 1993, n°91-13.627)
En revanche, le texte s’applique aux locaux commerciaux et professionnels, ce qui étend considérablement sa portée.
Des spécificités de liquidation défavorables au créancier
Ce régime présente trois particularités majeures :
- L’astreinte est toujours provisoire, jamais définitive
- La liquidation n’intervient qu’après l’exécution de la décision d’expulsion, ce qui lui ôte son caractère comminatoire
- Son montant ne peut excéder la somme compensatrice du préjudice effectivement subi
Cette dernière caractéristique transforme l’astreinte en simple indemnité, alors que le droit commun affirme que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts » (art. L.131-2 CPCE).
Le propriétaire peut toutefois cumuler cette astreinte avec une indemnité d’occupation (Civ. 2e, 6 déc. 1989, Bull. civ. II, n°215), ce qui atténue partiellement cette limitation.
2. Les astreintes prononcées par les juridictions répressives
Fondement légal des astreintes pénales
Contrairement au droit civil, il n’existe pas de régime général de l’astreinte en matière pénale. Les articles 132-66 à 132-70 du Code pénal encadrent l’astreinte uniquement dans le cadre de l’ajournement du prononcé de la peine.
L’article 132-67 CP précise : « la juridiction peut assortir l’injonction d’une astreinte lorsque celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ».
Les juridictions répressives peuvent aussi prononcer des astreintes pour leurs décisions portant sur les intérêts civils, régies alors par le droit commun des articles L.131-1 et suivants du CPCE.
Focus sur les astreintes en matière d’urbanisme
Les astreintes pénales trouvent une application particulière en droit de l’urbanisme. L’article L.480-7 du Code de l’urbanisme dispose :
« Le tribunal impartit au bénéficiaire des travaux irréguliers ou de l’utilisation irrégulière du sol un délai pour l’exécution de l’ordre de démolition, de mise en conformité ou de réaffectation ; il peut assortir son injonction d’une astreinte de 500 € au plus par jour de retard. »
Ces astreintes constituent « des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales » (Crim. 6 nov. 2012, n°12-82.449).
Leurs spécificités :
- Elles sont prononcées et liquidées exclusivement par le juge pénal
- Leur montant peut être relevé au-delà du maximum légal si le délinquant ne s’exécute pas dans l’année
- Elles sont liquidées par l’État et reversées aux communes concernées
La Cour de cassation maintient une jurisprudence stricte, refusant la suppression de l’astreinte même si un permis de construire est obtenu ultérieurement (Crim. 30 mai 2006, n°05-87.694).
3. L’astreinte administrative : une arrivée tardive
Une émergence difficile dans le contentieux administratif
L’astreinte a longtemps été rejetée par les juridictions administratives. Le Conseil d’État affirmait qu’un juge administratif ne pouvait « ordonner à peine d’astreinte » à l’Administration d’adopter un comportement déterminé (CE 27 janv. 1933, Le Loir, Lebon 136).
Ce rejet s’appuyait sur le principe de séparation des pouvoirs : le juge ne pouvait faire acte d’administrateur sans empiéter sur l’exécutif.
Ce n’est qu’avec la loi n°80-539 du 16 juillet 1980, puis surtout la loi n°95-125 du 8 février 1995, que l’astreinte a véritablement intégré le contentieux administratif, désormais codifiée aux articles L.911-1 et suivants du Code de justice administrative.
Les modalités de prononcé et les juridictions compétentes
L’astreinte administrative peut être prononcée selon deux modalités :
- Immédiatement dans la décision au fond (art. L.911-3 CJA)
- A posteriori, en cas d’inexécution d’une décision (art. L.911-4 et L.911-5 CJA)
Toutes les juridictions administratives peuvent prononcer des astreintes (tribunaux administratifs, cours administratives d’appel, Conseil d’État), y compris en référé.
L’article L.911-4 CJA précise que la juridiction qui a rendu la décision est compétente pour prononcer l’astreinte a posteriori. Une procédure précontentieuse est prévue pour tenter d’obtenir l’exécution sans recourir à l’astreinte.
Des particularités significatives
L’astreinte administrative présente plusieurs spécificités :
- Elle ne peut viser que des personnes morales de droit public ou des organismes privés chargés d’un service public
- Elle peut être ordonnée d’office par le juge
- Le juge peut choisir directement une astreinte définitive sans passer par une astreinte provisoire
- Une part de l’astreinte peut ne pas être versée au requérant mais affectée au budget de l’État (art. L.911-8 CJA)
Cette dernière caractéristique évite l’enrichissement injustifié du requérant. Le Conseil d’État a récemment précisé que cette règle ne s’applique pas lorsque l’État est lui-même débiteur (CE, ass., 10 juill. 2020, n°428409).
4. L’astreinte en droit international privé
Pouvoir du juge français dans les litiges internationaux
Le juge français peut-il prononcer une astreinte dans un litige international ? La Cour de cassation répond par l’affirmative.
Dans l’arrêt Worms (Civ. 1re, 19 nov. 2002, n°00-22.334), elle approuve les juges du fond d’avoir fait injonction sous astreinte à une banque française de renoncer à une procédure engagée en Espagne.
L’astreinte étant une mesure personnelle qui s’adresse directement à la personne et non à ses biens, elle n’est pas considérée comme une atteinte à la souveraineté étrangère.
Liquidation et reconnaissance des astreintes étrangères
Le juge français peut assortir d’une astreinte une décision étrangère ayant reçu l’exequatur. En revanche, il ne peut pas liquider une astreinte prononcée par un juge étranger.
Le règlement Bruxelles I bis précise : « Les décisions étrangères rendues dans un État membre condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l’État membre requis que si le montant en a été définitivement fixé par la juridiction d’origine » (art. 55).
La CJUE a confirmé cette approche en précisant que l’astreinte suit le même régime d’exécution que la décision qu’elle vient garantir (CJUE 9 sept. 2015, Bohez c/ Wiertz, aff. C-4/14).
Pour la liquidation, la Cour de cassation précise que « le juge compétent pour liquider une astreinte lorsque le débiteur demeure à l’étranger est celui du lieu d’exécution de l’injonction » (Civ. 2e, 15 janv. 2009, n°07-20.955).
La diversité des régimes spéciaux d’astreinte témoigne d’une tension entre efficacité de la mesure et protection des débiteurs. Dans certains domaines comme l’expulsion, l’astreinte perd une grande partie de sa force comminatoire. En revanche, en matière administrative et internationale, son application s’est progressivement étendue.
Pour sécuriser votre stratégie contentieuse, une analyse préalable du régime applicable s’impose. Le cabinet vous accompagne pour identifier le régime d’astreinte le plus adapté à votre situation et maximiser vos chances d’obtenir l’exécution effective des décisions de justice vous concernant.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L.131-1 à L.131-4 et L.421-1 à L.421-2
- Code pénal, articles 132-66 à 132-70
- Code de justice administrative, articles L.911-1 à L.911-8
- Code de l’urbanisme, article L.480-7
- Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 relative aux astreintes en matière d’expulsion
- Loi n°80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes en matière administrative
- Loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l’organisation des juridictions
- Civ. 2e, 10 février 1993, n°91-13.627
- Civ. 2e, 10 février 2000, n°98-13.354
- Civ. 1re, 19 novembre 2002, n°00-22.334 (arrêt Worms)
- Civ. 2e, 15 janvier 2009, n°07-20.955
- Crim. 6 novembre 2012, n°12-82.449
- CE, ass., 10 juillet 2020, n°428409, Association Les Amis de la Terre
- CJUE, 9 septembre 2015, Bohez c/ Wiertz, aff. C-4/14