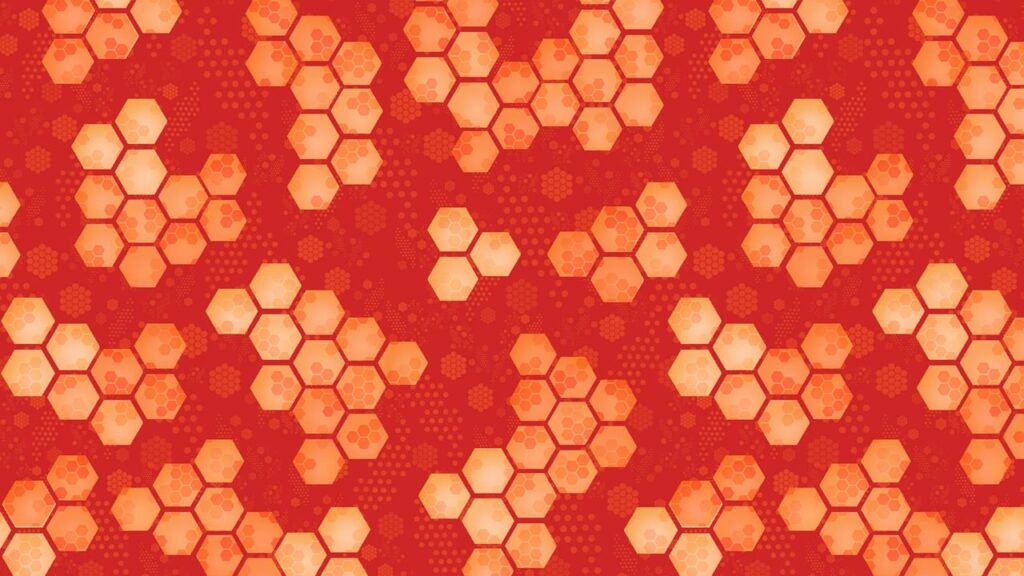Quand un bien n’est pas entre vos mains, sa récupération peut s’avérer épineuse. La saisie-revendication et la saisie-appréhension sont des outils juridiques permettant de récupérer un bien meuble. Mais ces procédures se heurtent à divers obstacles qui peuvent compromettre leur efficacité.
Les obstacles liés au droit de propriété
La règle « en fait de meubles, possession vaut titre »
L’article 2276 du Code civil pose un principe fondamental : « En fait de meubles, la possession vaut titre ». Cette règle protège celui qui détient un bien meuble en lui conférant une présomption de propriété. Elle constitue un rempart puissant contre les revendications.
Pour que cette règle s’applique, la possession doit présenter certaines qualités :
- Être effective (détention matérielle du bien)
- Ne pas être précaire (ce qui exclut les situations de dépôt, location, prêt)
- Être exempte de vice comme l’équivoque ou la clandestinité
- Le possesseur doit être de bonne foi
La Cour de cassation a rappelé ce dernier critère dans un arrêt du 23 mai 2000 : le possesseur doit avoir la conviction d’acquérir le bien du véritable propriétaire.
Les exceptions à la règle
Deux exceptions principales permettent d’écarter la protection de l’article 2276 :
- En cas de perte du bien
- En cas de vol du bien
Dans ces deux situations, l’action en revendication reste possible pendant trois ans à compter de la perte ou du vol. Le revendiquant n’a pas à démontrer la mauvaise foi du possesseur.
La preuve de la mauvaise foi
La bonne foi étant présumée (article 2274 du Code civil), prouver la mauvaise foi incombe au revendiquant. Cette démonstration peut s’avérer compliquée. La mauvaise foi suppose que le possesseur savait qu’il acquérait le bien d’une personne qui n’en était pas propriétaire.
Impact des procédures collectives
La procédure collective (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) crée un cadre contraignant pour les saisies.
Période suspecte et nullité des mesures conservatoires
L’article L.632-1, I, 7° du Code de commerce frappe de nullité les mesures conservatoires pratiquées après la date de cessation des paiements. Une saisie-revendication pratiquée pendant cette période est donc vulnérable.
La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 18 février 1999 qu’une saisie-revendication s’analyse comme une mesure d’exécution forcée que le jugement d’ouverture interdit.
Arrêt des poursuites individuelles
L’article L.622-21 du Code de commerce arrête ou interdit toute procédure d’exécution, y compris l’injonction de délivrer ou de restituer visant à obtenir un titre exécutoire, tant sur les meubles que sur les immeubles après le jugement d’ouverture.
Cela empêche donc de pratiquer une saisie-revendication après l’ouverture d’une procédure collective. En revanche, cette règle ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en revendication, telle que prévue par les articles L.624-9 et suivants du Code de commerce.
La procédure spécifique de revendication
En cas de procédure collective, le créancier qui souhaite récupérer un bien doit suivre un parcours spécifique :
- Adresser une demande amiable en revendication dans les trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture
- En cas de refus des organes de la procédure dans le délai d’un mois, saisir le juge-commissaire dans le mois suivant
Ce délai de trois mois est préfix. Son non-respect entraîne la forclusion de l’action.
La clause de réserve de propriété : un atout majeur
La clause de réserve de propriété constitue une protection efficace pour le vendeur. Définie à l’article 2367 du Code civil, elle « suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie ».
En cas de procédure collective, l’article L.624-16 du Code de commerce facilite la revendication des biens vendus avec réserve de propriété. La jurisprudence a validé la saisie-revendication pratiquée par un créancier titulaire d’une telle clause, même lorsque son débiteur fait l’objet d’une procédure collective (CA Lyon, 26 février 2003).
Impact du surendettement des particuliers
Suspension des procédures d’exécution
La recevabilité d’un dossier de surendettement entraîne la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées contre les biens du débiteur (article L.722-2 du Code de la consommation).
Cette suspension produit effet jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures, ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel.
Particularités de la procédure de rétablissement personnel
Dans le cadre d’un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, l’article L.742-7 du Code de la consommation prévoit que le jugement d’ouverture entraîne, jusqu’au jugement de clôture, la suspension des procédures d’exécution.
La question de savoir si la saisie-revendication entre dans ce champ de suspension reste débattue. L’article R.722-5 du Code de la consommation, par la généralité de ses termes, semble l’inclure dans l’interdiction.
Possibilités d’action malgré le surendettement
La Cour d’appel de Douai (9 mars 2017, n° 16/02076) a jugé qu’il n’entre pas dans la compétence du juge du surendettement d’enjoindre aux locataires de restituer un véhicule. Il appartient alors au bailleur de procéder par voie de saisie-appréhension.
Cette décision suggère que certaines actions de récupération de biens restent possibles même en situation de surendettement, notamment lorsqu’elles s’appuient sur un droit de propriété.
Autres situations particulières
Biens fongibles et problèmes d’identification
Les biens fongibles posent un défi particulier : comment revendiquer un bien interchangeable avec d’autres de même nature ?
La jurisprudence considère que « si le caractère fongible d’un bien ne fait pas par lui-même obstacle à sa revendication, celle-ci ne peut aboutir que dans la mesure où le bien en cause n’a pas été confondu avec d’autres de même espèce » (Com. 25 mars 1997, n° 94-18.337).
L’individualisation est donc une condition nécessaire à la revendication de biens fongibles.
Biens incorporés à d’autres biens
L’incorporation d’un bien dans un autre pose également problème. L’article 2370 du Code civil prévoit que l’incorporation d’un meuble faisant l’objet d’une réserve de propriété à un autre bien « ne fait pas obstacle aux droits du créancier lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage ».
La jurisprudence admet la revendication lorsque la substance de la chose n’est pas altérée, moyennant indemnisation des travaux éventuellement réalisés (Com. 17 mai 1988).
Titulaires de privilèges spéciaux
Certains créanciers bénéficient de privilèges facilitant la revendication :
- Le bailleur d’immeuble dispose d’un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués (article 2332, 1° du Code civil)
- Le vendeur de meuble impayé peut revendiquer les biens vendus dans les huit jours de la livraison (article 2332, 4° du Code civil)
Souvenirs de famille et biens particuliers
La Cour de cassation a reconnu aux membres d’une famille un droit à la revendication des souvenirs de famille (Civ. 2e, 29 mars 1995, n° 93-18.769). Ce droit particulier permet d’empêcher l’aliénation de biens ayant une valeur patrimoniale et morale pour la famille.
D’autres biens spécifiques comme les aéronefs, les yachts de plaisance, ou les documents de bord d’un navire peuvent faire l’objet de procédures particulières de revendication.
Face à la complexité de ces procédures de récupération de biens, l’accompagnement d’un avocat expert en voies d’exécution est souvent indispensable pour sécuriser vos droits et maximiser vos chances de succès.
Sources
- Code civil : articles 2276, 2274, 2367, 2370
- Code de commerce : articles L.622-21, L.624-9, L.624-16, L.632-1
- Code de la consommation : articles L.722-2, L.742-7, R.722-5
- Code des procédures civiles d’exécution : articles R.222-17 à R.222-25, L.222-1, L.222-2
- Cour de cassation, Commerciale, 25 mars 1997, n° 94-18.337
- Cour de cassation, 2e civ., 18 février 1999, n° 96-21.218
- Cour de cassation, Commerciale, 23 mai 2000, n° 98-13.134
- Cour de cassation, 2e civ., 29 mars 1995, n° 93-18.769
- Cour d’appel de Lyon, 26 février 2003, n° 02/06030
- Cour d’appel de Douai, 9 mars 2017, n° 16/02076