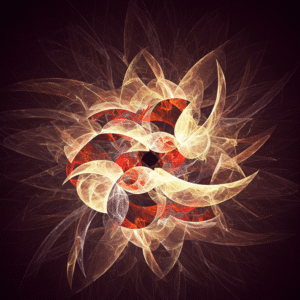Contracter un crédit en couple est une démarche courante, souvent perçue comme une simple formalité administrative. Pourtant, les implications juridiques qui en découlent sont loin d’être anodines et varient considérablement selon la nature de l’union : concubinage, pacte civil de solidarité (PACS) ou mariage. La question de la responsabilité financière de chacun en cas de défaillance est directement liée au statut juridique du couple. Cet article a pour but de fournir une vue d’ensemble des règles applicables, un sujet que nous abordons de manière plus générale dans notre publication sur les droits et obligations du débiteur saisi. Comprendre ces mécanismes est essentiel pour anticiper les risques et protéger son patrimoine, un domaine où l’assistance d’un avocat compétent en droit du crédit peut s’avérer déterminante.
Introduction au remboursement de crédit aux consommateurs et le rôle du couple
Définition et portée de l’opération de crédit
Une opération de crédit, selon le Code monétaire et financier, est un acte par lequel une personne met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre, à titre onéreux. Concrètement, cela englobe la majorité des prêts consentis par des professionnels, qu’il s’agisse de crédits à la consommation pour l’achat d’un véhicule ou de prêts immobiliers. Le caractère onéreux, le plus souvent matérialisé par le paiement d’intérêts, est une condition essentielle de cette qualification.
Le caractère onéreux et les crédits aux consommateurs
Le crédit destiné aux consommateurs est spécifiquement encadré par le Code de la consommation. La loi définit précisément les acteurs : le prêteur, qui doit être un professionnel agissant dans le cadre de son activité, et l’emprunteur, une personne physique contractant dans un but non professionnel. Cette législation vise à protéger le consommateur en imposant un formalisme strict et des obligations d’information au créancier.
Le contrat de prêt : définition et régime
Le prêt d’argent est l’opération de crédit la plus répandue. Il se caractérise par la remise de fonds par le prêteur, que l’emprunteur s’engage à restituer avec des intérêts. Autrefois considéré comme un contrat « réel » (formé par la remise des fonds), la jurisprudence a établi que le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, c’est-à-dire valablement formé dès l’échange des consentements. La remise des fonds n’est plus une condition de formation mais la première obligation d’exécution du prêteur.
Les preuves du contrat et de la remise des fonds
La charge de la preuve pèse sur celui qui se prétend créancier. La simple remise d’une somme d’argent ne suffit pas à prouver l’existence d’un prêt ; le prêteur doit démontrer qu’il s’agissait bien d’un contrat de prêt et non d’une donation, par exemple. De plus, il doit également être en mesure de prouver qu’il a effectivement versé les fonds promis à l’emprunteur.
L’obligation et les modes de remboursement
La contrepartie de la mise à disposition des fonds est l’obligation pour l’emprunteur de les rembourser. Sans cette obligation de restitution, il ne s’agit pas d’un prêt. Les modalités de remboursement (échéances, durée, lieu du paiement) sont fixées par la convention. En pratique, le paiement s’effectue le plus souvent par prélèvement sur le compte bancaire de l’emprunteur, domicilié chez le créancier.
Le remboursement de crédit pour le couple non marié
Le cas du concubinage : absence de solidarité légale et recours conventionnel
Le concubinage est une union de fait qui ne crée aucune obligation légale de solidarité entre les partenaires pour les dettes contractées. Le principe est simple : chacun est seul responsable des crédits qu’il a personnellement souscrits. Un créancier ne peut pas se retourner contre un concubin pour recouvrer la dette de l’autre, même si les fonds ont servi aux besoins du ménage. La seule exception est la solidarité conventionnelle, c’est-à-dire lorsque les deux concubins se sont engagés en tant que co-emprunteurs dans le contrat de prêt. Dans ce cas, leur signature conjointe les oblige solidairement au remboursement.
Le régime du pacte civil de solidarité (PACS) : solidarité légale et gestion des biens
Le PACS instaure un régime intermédiaire. Depuis la loi du 23 juin 2006, le régime par défaut est celui de la séparation de biens, où chaque partenaire reste propriétaire des biens qu’il acquiert et seul tenu de ses dettes personnelles. Toutefois, l’article 515-4 du Code civil instaure une solidarité pour les dettes contractées pour les « besoins de la vie courante ». Cette solidarité connaît des exceptions notables pour les emprunts, qui ne sont solidaires que s’ils portent sur des sommes modestes nécessaires à ces besoins, ou s’ils ont été conclus avec le consentement des deux partenaires. Les partenaires peuvent aussi opter pour le régime de l’indivision, où les biens acquis pendant le pacte sont réputés leur appartenir pour moitié.
Le remboursement de crédit et le couple marié : un régime complexe
Les solutions découlant du régime primaire : la solidarité des dettes ménagères (article 220)
Quel que soit leur régime matrimonial, tous les couples mariés sont soumis à un socle de règles communes appelé « régime primaire ». L’article 220 du Code civil en est une pièce maîtresse. Il prévoit que les dettes contractées par un seul époux pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants obligent solidairement l’autre. Cependant, pour les emprunts, cette solidarité est écartée, sauf dans deux cas : si le prêt a reçu le consentement des deux conjoints, ou s’il porte sur des « sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ». Cette règle vise à protéger le ménage contre un endettement excessif décidé par un seul conjoint.
L’impact du régime légal de communauté réduite aux acquêts sur les dettes du couple
Il s’agit du régime appliqué par défaut en l’absence de contrat de mariage. Une règle fondamentale, édictée par l’article 1415 du Code civil, protège le patrimoine commun. Lorsqu’un époux contracte seul un emprunt, il n’engage que ses biens propres et ses revenus. Les biens communs ne sont pas engagés, à moins que le conjoint n’ait donné son « consentement exprès » à l’opération. Cette disposition est un rempart pour le patrimoine familial et une information essentielle pour les créanciers, qui doivent s’assurer d’obtenir l’accord des deux époux pour pouvoir saisir les biens communs. Pour en apprendre davantage sur les implications de cette règle, notamment en matière de cautionnement, vous pouvez consulter notre article sur la protection spécifique des cautions.
Le régime de communauté universelle et le remboursement de crédit
Dans ce régime, la quasi-totalité des biens des époux, présents et à venir, est mise en commun. On pourrait penser que toutes les dettes sont également communes. Pourtant, la jurisprudence a confirmé que la protection de l’article 1415 du Code civil s’applique aussi à ce régime. Un emprunt souscrit par un seul époux sans le consentement de l’autre n’engage donc pas la communauté. Cette solution est particulièrement protectrice pour le conjoint, car la masse des biens propres saisissables par le créancier est souvent très réduite, voire inexistante.
Le régime de séparation de biens : indépendance patrimoniale et créances entre époux
Ce régime consacre une indépendance totale des patrimoines. Chaque époux reste seul propriétaire de ses biens et seul tenu de ses dettes. Le créancier d’un époux ne peut donc pas poursuivre l’autre. Toutefois, ce principe connaît une exception de taille : la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 s’applique. Ainsi, même en séparation de biens, un époux peut être tenu de rembourser un crédit modeste souscrit par son conjoint pour les besoins de la vie courante. Si un époux finance l’acquisition d’un bien pour l’autre, il dispose d’une créance contre son conjoint, qui sera réglée au moment de la dissolution du mariage.
La problématique spécifique de la saisie sur compte joint en fonction du régime matrimonial
La saisie d’un compte joint par le créancier d’un seul époux est une question pratique complexe. La solution dépend à la fois du régime matrimonial et de la nature de la dette. Sous un régime de communauté, si la dette est commune (par exemple, une dette ménagère ou un emprunt consenti par les deux époux), le solde du compte joint, présumé commun, est saisissable. En revanche, s’il s’agit d’une dette propre à un époux (comme un emprunt souscrit seul), le créancier ne peut saisir que la part des fonds appartenant personnellement à son débiteur sur le compte joint, une preuve souvent très difficile à rapporter. La mise en oeuvre de cette mesure est détaillée dans notre article consacré à la saisie-attribution sur un compte bancaire.
La gestion des dettes contractées en couple exige une compréhension claire des règles applicables à chaque situation. Le choix d’un statut marital ou d’un régime matrimonial n’est jamais sans conséquence sur le patrimoine du ménage. Pour une analyse approfondie de votre situation et un conseil adapté, prenez contact avec notre équipe d’avocats.
Foire aux questions
En concubinage, suis-je responsable du crédit de mon conjoint ?
Non, sauf si vous avez signé le contrat de prêt en tant que co-emprunteur. En l’absence de signature conjointe, chaque concubin n’est responsable que de ses propres dettes, sans solidarité légale.
Le PACS protège-t-il des dettes de son partenaire ?
Le PACS instaure une solidarité pour les dettes liées aux besoins de la vie courante. Cependant, pour les emprunts, cette solidarité est limitée aux sommes modestes ou aux prêts signés par les deux partenaires, offrant une protection supérieure au concubinage.
Sous le régime de la communauté, un crédit signé seul engage-t-il les biens communs ?
Non, en principe. L’article 1415 du Code civil protège le patrimoine commun en stipulant qu’un emprunt souscrit par un seul époux n’engage que ses biens propres et ses revenus, sauf si le conjoint a donné son consentement exprès.
Le régime de la séparation de biens protège-t-il totalement des dettes de son époux ?
Majoritairement, oui. Cependant, la solidarité pour les dettes ménagères (article 220 du Code civil) s’applique, ce qui signifie qu’un époux peut être tenu de rembourser un emprunt modeste contracté par son conjoint pour les besoins courants du ménage.
Un créancier peut-il saisir notre compte joint pour la dette d’un seul époux ?
Cela dépend de la nature de la dette et du régime matrimonial. Si la dette est considérée comme commune (par exemple, une dette ménagère), la saisie est possible. Si la dette est propre à un seul époux, le créancier devra prouver que les fonds sur le compte appartiennent au débiteur, ce qui est souvent impossible.
Quel est le régime matrimonial le plus protecteur contre les dettes d’un conjoint ?
Le régime de la séparation de biens offre la plus grande protection, car il établit une indépendance patrimoniale. Cependant, aucun régime ne protège totalement de la solidarité légale pour les dettes ménagères modestes nécessaires à la vie courante.