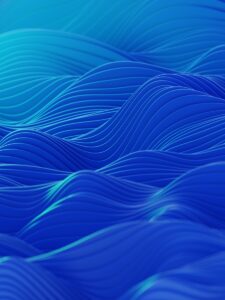La saisie-attribution constitue un outil puissant pour recouvrer des créances. Mais certaines configurations atypiques peuvent compliquer sa mise en œuvre. Un praticien averti doit connaître ces situations particulières pour éviter les écueils procéduraux et pleinement maîtriser le fonctionnement général de la saisie-attribution.
1. La saisie sur soi-même : un mécanisme méconnu
Un outil stratégique dans certaines situations
La saisie sur soi-même permet à un créancier de saisir entre ses propres mains une créance dont il est lui-même débiteur envers son débiteur. Cette technique, validée par la Cour de cassation, répond à des besoins spécifiques.
La situation typique concerne les créances à exécution successive. Prenons l’exemple d’un locataire créancier de son bailleur qui craint que d’autres créanciers ne saisissent les loyers. En saisissant sa propre dette de loyers, il peut sécuriser sa position.
Comme l’a confirmé la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 2014 : « un créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut pratiquer une saisie-attribution entre ses propres mains, l’effet attributif d’une telle saisie lorsqu’elle porte sur une créance à exécution successive s’étendant aux sommes échues en vertu de cette créance depuis la signification de l’acte de saisie » (Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 12-25.511).
L’extinction par confusion
Techniquement, cette procédure entraîne une extinction par confusion. Le mécanisme est doublement extinctif : la créance saisie disparaît par confusion (article 1349 du Code civil) et elle éteint proportionnellement la créance cause de la saisie.
Cette particularité fait de la saisie sur soi-même une procédure qui se résout sans paiement effectif – un cas rare dans notre droit.
Conditions strictes de mise en œuvre
Pour être valable, cette saisie requiert:
- Un titre exécutoire
- Une créance liquide et exigible
- Une créance du saisissant sur le débiteur
- Une dette du saisissant envers ce même débiteur
La jurisprudence s’est montrée assez stricte sur les conditions d’exercice de cette voie d’exécution particulière.
2. Les complications liées à la pluralité d’acteurs
Concours entre créanciers saisissants
Lorsque plusieurs créanciers pratiquent une saisie-attribution le même jour, une situation de concours se crée. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que « les actes de saisie signifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours« .
Il importe peu que l’un des créanciers soit privilégié. La mention de l’heure sur l’acte, bien que requise par l’article R. 211-1, n’influe pas sur le rang des saisissants du même jour. Cette situation peut frustrer le créancier qui a saisi en premier dans la journée.
Pluralité de tiers saisis
Quand un créancier souhaite saisir les créances de son débiteur chez plusieurs tiers, il doit signifier autant d’actes de saisie qu’il y a de tiers saisis. Chaque acte représente une saisie distincte avec ses propres effets.
Notons cette subtilité technique : dans le cas d’une dette contractée pour l’entretien du ménage au sens de l’article 220 du Code civil, l’acte de saisie doit être adressé à chacun des époux.
Les difficultés des comptes à pluralité de titulaires
Les comptes joints posent des problèmes particuliers. L’article R. 211-22 du Code prévoit que « lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte« .
Mais un arrêt important de la Cour de cassation du 7 juillet 2011 (n° 10-20.923) a précisé que le défaut de dénonciation au cotitulaire n’entraîne pas la caducité de la saisie. Cette décision préserve les droits du créancier tout en créant une situation ambiguë pour le cotitulaire non informé.
Pour les comptes indivis ou en usufruit, le Code reste silencieux. La prudence commande pourtant une dénonciation à tous les titulaires de droits sur le compte.
3. Les défis de la signification
La signification de l’acte de saisie est une étape critique, dont les pièges soulignent l’impératif de maîtriser la procédure de saisie-attribution et son formalisme.
L’identification du bon interlocuteur
Un problème courant concerne l’identification du tiers saisi compétent. Pour les établissements bancaires, la Cour de cassation a tranché : « la saisie entre les mains d’un établissement de crédit n’est régulièrement effectuée qu’au siège social de cet établissement ou auprès de la succursale qui tient les comptes du débiteur saisi » (Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 05-12.569).
Pour les comptables publics, l’article R. 143-3 du Code exige que l’acte soit signifié au comptable assignataire de la dépense. Une erreur d’identification rend la saisie nulle.
Le créancier peut solliciter des informations sur l’identité du comptable compétent en vertu de l’article L. 143-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Mais attention : une information erronée ne valide pas une saisie irrégulière.
Signification électronique : facilité et pièges
Depuis 2021, la signification par voie électronique est devenue obligatoire pour les saisies-attributions pratiquées auprès des établissements bancaires (article L. 211-1-1 du Code).
Cette modalité simplifie la procédure mais augmente les risques d’erreurs techniques. La date et l’heure de l’envoi électronique déterminent le moment de l’attribution de la créance au saisissant, rendant crucial le bon fonctionnement des systèmes informatiques.
Territoires ultramarins : délais et modalités spécifiques
Pour les tiers saisis domiciliés dans les collectivités d’outre-mer (Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Nouvelle-Calédonie), l’article 660 du Code de procédure civile prévoit un régime particulier de signification.
Cette procédure pose des difficultés pratiques pour déterminer la date d’expiration du délai de contestation, puisque l’huissier ignore quand l’acte sera porté à la connaissance du destinataire.
4. Écueils liés au comportement des acteurs
Défaut de renseignement du tiers saisi
Le tiers saisi doit fournir à l’huissier les renseignements sur sa dette envers le débiteur saisi. L’article R. 211-5 du Code prévoit que « le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier« .
Cette sanction sévère est toutefois limitée par la jurisprudence: le tiers non débiteur ne peut être condamné qu’à des dom mages-intérêts.
Un motif légitime – comme la signification à une personne sans pouvoir ou la nécessité d’effectuer des recherches complexes – peut exonérer le tiers de cette obligation immédiate.
Le refus de paiement
Le refus de paiement par un tiers saisi qui a reconnu sa dette ouvre au créancier la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire contre le tiers (article R. 211-9 du Code).
La jurisprudence a précisé que pour être condamné, le tiers doit s’être reconnu débiteur ou avoir été jugé comme tel (Cass. 2e civ., 10 janvier 2019, n° 17-21.313).
Saisies successives et procédure collective
L’impact des procédures collectives sur les saisies-attributions constitue un piège juridique majeur, dont les délais de dénonciation et les effets du jugement d’ouverture doivent être maîtrisés avec précision.
L’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur saisi après la signification de la saisie ne remet pas en cause l’attribution de la créance au saisissant.
Mais la dénonciation de la saisie doit être faite aux organes de la procédure selon leurs pouvoirs. Un arrêt important de la Cour de cassation (4 mars 2003, n° 00-13.020) a précisé que « la saisie doit être dénoncée dans le délai de huit jours, à peine de caducité… dès la liquidation judiciaire, à son liquidateur ».
La caducité qui frapperait une saisie non dénoncée dans ce délai de huit jours au liquidateur est particulièrement sévère pour le créancier, surtout quand le jugement d’ouverture intervient pendant ce bref délai.
Un point technique capital : l’acte de dénonciation doit contenir, à peine de nullité, l’indication que les contestations doivent être soulevées dans un délai d’un mois, avec la date précise d’expiration (article R. 211-3 du Code). Une erreur sur cette date entraîne la nullité de l’acte.
En pratique, il vaut mieux prévoir une marge de sécurité dans le calcul de ce délai, les tribunaux sanctionnant sévèrement les erreurs sur ce point.
Au-delà des pièges liés aux comportements des acteurs et aux procédures collectives, d’autres situations particulières de saisie-attribution peuvent également complexifier la mise en œuvre de cette voie d’exécution.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L. 211-1 à L. 211-5, R. 211-1 à R. 211-23
- Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 12-25.511, Bull. civ. 2014, I, n° 84
- Cass. 2e civ., 7 juill. 2011, n° 10-20.923, JurisData n° 2011-013625
- Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 05-12.569, JurisData n° 2006-032798
- Cass. com., 4 mars 2003, n° 00-13.020, JurisData n° 2003-018032
- Cass. 2e civ., 2 déc. 2004, n° 02-20.622, JurisData n° 2004-025912
- Cass. 2e civ., 10 janv. 2019, n° 17-21.313, JurisData n° 2019-000084
Face à la complexité et aux nombreux pièges de la saisie-attribution, l’accompagnement d’un avocat spécialisé en saisie-attribution est souvent indispensable pour sécuriser vos procédures et défendre vos intérêts.