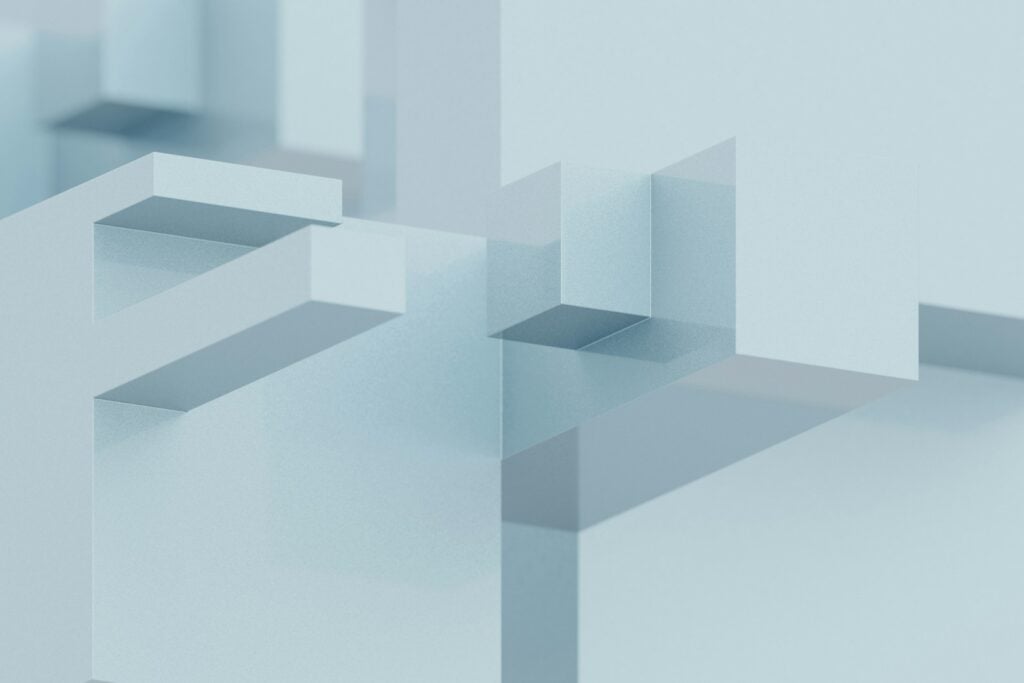Le droit de la concurrence vise à garantir un jeu équilibré et loyal entre les acteurs économiques. Au cœur de ce dispositif, l’article L. 420-1 du code de commerce pose le principe de l’interdiction des ententes anticoncurrentielles. Si ce texte donne quelques exemples de pratiques prohibées, la liste n’est pas limitative. En réalité, toute concertation entre entreprises, quelle que soit sa forme, qui a pour objet ou peut avoir pour effet de restreindre la concurrence sur un marché est susceptible d’être sanctionnée. Comprendre les grandes catégories d’ententes interdites est donc essentiel pour toute entreprise soucieuse de sécuriser ses pratiques commerciales. Pour une vue d’ensemble des mécanismes et des enjeux, vous pouvez consulter notre article introductif sur les ententes anticoncurrentielles : comprendre les règles et les risques pour votre entreprise. Cet article détaille plus spécifiquement les formes les plus courantes que peuvent prendre ces accords illicites.
Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence
Une première catégorie d’ententes vise à fermer l’accès au marché à de nouveaux entrants ou à restreindre la liberté d’action des entreprises déjà présentes. Cela peut passer par différentes clauses ou accords.
Les clauses d’exclusivité, par exemple, bien que parfois nécessaires au bon fonctionnement d’un réseau de distribution, peuvent poser problème si elles ne sont pas justifiées ou proportionnées. Une exclusivité territoriale accordée à un distributeur peut être légitime, mais si elle s’accompagne d’une interdiction absolue de ventes passives (répondre à des demandes non sollicitées de clients hors zone), elle devient suspecte.
Les clauses de non-concurrence sont également scrutées avec attention. Fréquentes lors de la cession d’une entreprise ou dans certains contrats de distribution ou de franchise, elles visent à protéger un savoir-faire ou une clientèle. Cependant, pour être valides, elles doivent être limitées dans le temps, dans l’espace et quant à l’activité concernée, et être proportionnées aux intérêts légitimes à protéger. Une clause de non-concurrence excessivement large ou longue pourrait être considérée comme une restriction injustifiée de la concurrence. Par exemple, une interdiction de démarchage entre coopératives membres d’un même groupement a été jugée disproportionnée car elle cloisonnait artificiellement leurs parts de marché. La jurisprudence distingue ces clauses des clauses de non-réaffiliation, qui interdisent simplement à un ancien membre d’un réseau de rejoindre un réseau concurrent direct pendant une certaine durée, mais les soumet souvent à des conditions de validité similaires. Naturellement, la question de savoir si une restriction est nécessaire peut être complexe, et certaines situations peuvent ouvrir droit à une justification, comme expliqué dans notre article sur les exemptions possibles.
Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché
C’est sans doute la catégorie d’ententes la plus connue et la plus sévèrement réprimée. Toute pratique visant à manipuler les prix de manière concertée, plutôt que de les laisser se former naturellement par l’offre et la demande, est prohibée.
L’exemple le plus classique est l’accord direct sur les prix de vente entre concurrents. Se mettre d’accord pour augmenter les tarifs simultanément, fixer des prix planchers ou coordonner des remises constitue une infraction caractérisée, souvent qualifiée de restriction « par objet », c’est-à-dire dont la nature même est considérée comme nuisible à la concurrence. Vous trouverez plus de détails sur cette notion dans notre article dédié à la différence entre entente par objet et par effet anticoncurrentiel.
L’interdiction vise aussi des pratiques plus indirectes. La diffusion de barèmes indicatifs par des organisations professionnelles peut être sanctionnée si ces barèmes agissent comme une référence tarifaire de fait, incitant les membres à aligner leurs prix. De même, l’imposition d’un prix de revente minimal par un fournisseur à ses distributeurs est une pratique prohibée, bien que sa preuve puisse nécessiter de démontrer une véritable « police des prix » allant au-delà de simples prix conseillés.
Les échanges d’informations stratégiques entre concurrents sont également dans le viseur des autorités. S’il est normal de connaître son marché, échanger des informations confidentielles et récentes sur les prix futurs, les coûts, les volumes de vente ou les stratégies commerciales peut faciliter une collusion. L’analyse se fait au cas par cas, en tenant compte de la nature des informations échangées, de leur caractère secret ou public, de leur ancienneté et de la structure du marché. Un échange d’informations très précises et non publiques sur un marché concentré sera jugé plus risqué.
Le cas particulier des marchés publics
Les marchés publics font l’objet d’une surveillance particulière en matière d’ententes, car les mécanismes d’appels d’offres sont censés garantir une mise en concurrence optimale au bénéfice des deniers publics. Toute concertation entre entreprises soumissionnaires visant à fausser ce processus est sévèrement réprimée.
Cela inclut évidemment les accords directs sur les prix à proposer ou sur la répartition des lots. Mais l’interdiction va plus loin : le simple échange d’informations avant le dépôt des offres sur l’intention de soumissionner, le niveau de prix envisagé, ou même la disponibilité en personnel ou matériel peut suffire à caractériser une entente. L’objectif est de préserver l’indépendance réelle des offres présentées.
Une pratique courante dans ce contexte est celle des « offres de couverture » : une entreprise accepte de déposer une offre volontairement non compétitive pour permettre à un concurrent désigné d’emporter le marché. La communication d’un chiffrage à un concurrent dans ce but est une infraction par objet. La preuve de ces manœuvres, souvent dissimulées, repose fréquemment sur un faisceau d’indices concordants : similitudes inexplicables dans les offres, écarts de prix anormaux, stabilité suspecte dans l’attribution des lots, etc..
Il faut toutefois noter que la constitution d’un groupement momentané d’entreprises (GME) pour répondre conjointement à un appel d’offres n’est pas interdite en soi. Elle peut même être bénéfique à la concurrence si elle permet à des entreprises, notamment des PME, de soumissionner alors qu’elles n’auraient pu le faire seules, par manque de taille, de moyens ou de compétences complémentaires. Cependant, un groupement devient illicite s’il n’est pas économiquement justifié (par exemple, si chaque membre pouvait répondre seul) et qu’il sert en réalité à masquer une entente de prix ou une répartition de marché. Si des entreprises échangent des informations confidentielles en vue d’un groupement ou d’une sous-traitance, elles ne peuvent ensuite plus soumissionner individuellement au même appel d’offres.
Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique
Moins fréquentes dans la pratique décisionnelle, mais tout aussi prohibées, sont les ententes qui visent à contrôler les quantités mises sur le marché ou à freiner l’innovation. Se mettre d’accord pour limiter la production afin de maintenir des prix élevés (quotas de production) est un exemple classique.
Les autorités peuvent aussi sanctionner des accords visant à bloquer le développement ou la commercialisation de produits ou technologies concurrents, par exemple en dénigrant une innovation ou en s’entendant pour ne pas adopter un matériau moins cher ou plus performant. Récemment, des entreprises ont été condamnées pour s’être interdites mutuellement de communiquer sur leurs performances environnementales individuelles, renonçant ainsi à se concurrencer sur ce critère. Des pratiques de boycott organisées pour limiter l’entrée de nouveaux modèles économiques ou technologiques sur un marché ont également été sanctionnées.
Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement
Cette catégorie d’ententes, souvent qualifiée d' »injustifiable », consiste pour des concurrents à se partager le « gâteau » plutôt que de se le disputer. L’objectif est de geler les positions acquises et d’éviter la confrontation commerciale directe.
La répartition peut être géographique : chaque entreprise s’engage à ne pas opérer sur le territoire réservé aux autres. Elle peut aussi concerner la clientèle : les concurrents se partagent les clients existants ou potentiels selon certains critères (type de client, historique, etc.).
Ces accords de partage sont souvent très organisés et peuvent être renforcés par des mécanismes de contrôle et de compensation. Par exemple, les membres de l’entente peuvent mettre en place un système d’échange d’informations sur les ventes pour vérifier que chacun respecte les quotas ou les zones attribuées. Si un membre dépasse sa part convenue, un mécanisme de compensation peut être prévu : paiement financier aux autres, restitution de clientèle, attribution forcée de travaux en sous-traitance, etc.. Ces pratiques sont considérées comme particulièrement graves car elles éliminent directement la concurrence entre les participants.
Le cas spécifique des droits exclusifs d’importation outre-mer
Enfin, une disposition spécifique au droit français concerne les départements et régions d’outre-mer. L’article L. 420-2-1 du code de commerce, issu de la loi « Lurel » de 2012, interdit les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation à une entreprise ou à un groupe d’entreprises. Cette interdiction vise à lutter contre les situations où un nombre restreint d’importateurs contrôle l’approvisionnement d’un territoire, limitant la concurrence intra-marque et favorisant des prix potentiellement plus élevés. Cette interdiction a une portée générale et ne se limite pas aux produits de grande consommation.
Cette typologie n’est pas exhaustive, l’imagination des entreprises pour restreindre la concurrence pouvant être fertile. Il est donc essentiel d’analyser attentivement toute pratique commerciale concertée au regard de son objet et de ses effets potentiels sur le marché.
La complexité des règles et la sévérité des sanctions encourues rendent indispensable une vigilance constante. Si vous avez un doute sur la conformité de vos pratiques ou si vous suspectez une entente de la part de vos concurrents ou fournisseurs, un conseil juridique adapté est primordial. Notre équipe se tient à votre disposition pour analyser votre situation spécifique et vous accompagner.
Sources
- Code de commerce, notamment les articles L. 420-1, L. 420-2-1, L. 420-4.
- Jurisprudence de l’Autorité de la concurrence et des tribunaux français et européens.