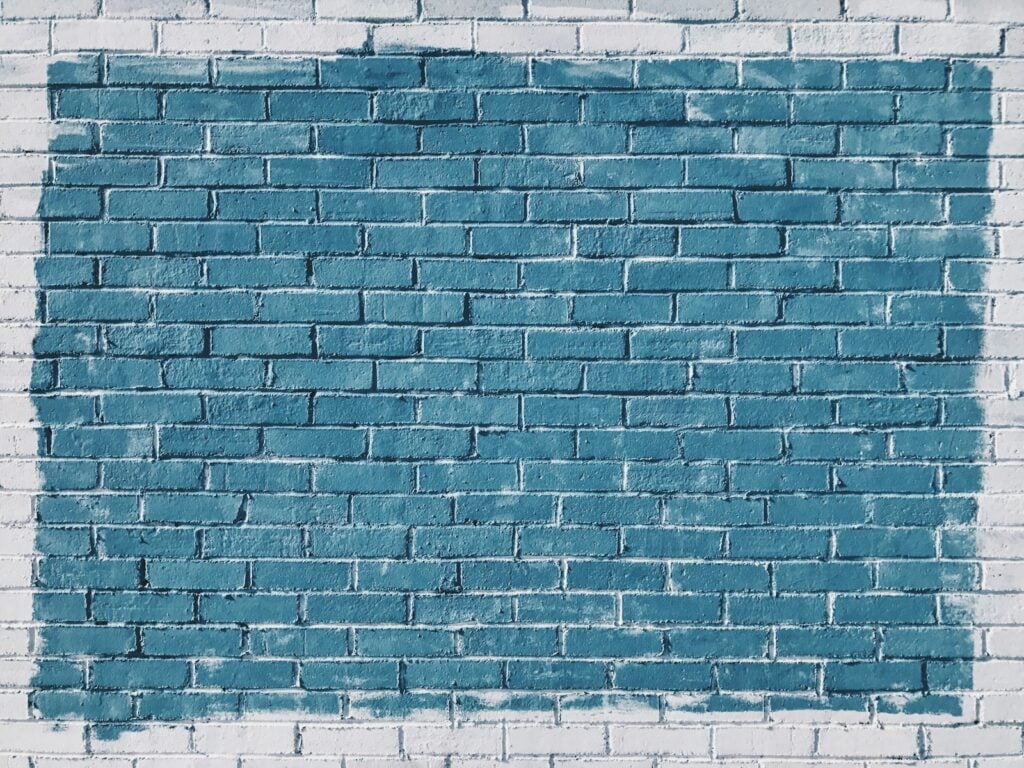L’affacturage constitue un levier financier stratégique pour de nombreuses entreprises. Pour une compréhension complète du concept, y compris ses limites et litiges potentiels, consultez notre guide sur l’affacturage général. Ce procédé repose sur des fondements juridiques complexes qui déterminent les droits et obligations des parties. La sécurité de cette opération dépend largement du mécanisme de transfert de créances choisi. Cet article analyse les deux principaux supports juridiques de l’affacturage, leurs caractéristiques et leurs implications pratiques.
La subrogation personnelle comme support juridique principal
Fondement et mécanisme de la subrogation
La subrogation personnelle constitue historiquement le premier et principal mécanisme juridique utilisé en matière d’affacturage. Fondée sur les articles 1346 et suivants du Code civil (anciennement 1249 et suivants), cette technique permet à l’affactureur de se substituer au créancier initial dans ses droits.
Le mécanisme est simple dans son principe : l’affactureur paie l’adhérent (créancier subrogeant) qui lui transmet en pleine propriété sa créance sur le client (débiteur cédé). Ce paiement s’effectue généralement par inscription immédiate au crédit du compte courant de l’adhérent. Cette inscription vaut paiement selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation.
Conditions de validité de la subrogation
Pour que la subrogation soit valable, plusieurs conditions doivent être réunies :
- La créance doit exister au moment du paiement et de la subrogation. L’affactureur ne pourrait se prévaloir d’une créance artificielle ou fictive.
- La volonté du subrogeant doit s’exprimer de façon univoque. La stipulation doit être expresse et ne laisser aucun doute sur la volonté de subroger, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 13 mars 2001.
- Les formalités doivent être concomitantes au paiement. Le code civil interdit les subrogations différées. Il serait trop tard et la créance serait définitivement éteinte par un règlement sans réserves.
En pratique, le terme de subrogation figure sur les quittances remises à l’affactureur chaque fois qu’il paie une facture à son adhérent. La dématérialisation de ces quittances subrogatives est aujourd’hui courante et légalement admise depuis la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000.
Effets juridiques de la subrogation
La subrogation produit des effets puissants tant entre les parties qu’à l’égard des tiers.
Entre les parties, l’affactureur devient propriétaire de la créance à la date de l’inscription en compte du paiement effectué au profit de l’adhérent. Il acquiert non seulement le principal de la créance, mais également toutes les actions et sûretés qui peuvent la garantir (effets de commerce, gage, police d’assurance-crédit, clause de réserve de propriété).
À l’égard des tiers, la subrogation opère le transfert de la créance sans autre formalité, le rendant opposable notamment aux créanciers de l’adhérent. Un créancier de l’adhérent ne pourrait plus, après la subrogation, saisir la créance transmise à l’affactureur, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 janvier 2005.
Comme nous l’expliquons dans notre article sur l’opposabilité des exceptions en matière d’affacturage, cette technique comporte toutefois des limites importantes concernant les exceptions que peut soulever le débiteur.
La cession de créances professionnelles (loi Dailly)
Principe et cadre légal de la cession Dailly
La cession de créances professionnelles, instituée par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 (dite loi Dailly), constitue une alternative à la subrogation. Ce mécanisme, désormais codifié aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, permet de transférer en propriété une série de créances professionnelles regroupées dans un bordereau.
Ce support législatif est particulièrement recommandé pour l’affacturage international, où le procédé de la subrogation peut être moins convaincant pour les factors étrangers. C’est aussi le moyen le plus sûr de transférer des créances futures sans en payer le montant immédiatement.
Formalisme et validité de la cession
Le bordereau Dailly est soumis à des règles de forme strictes :
- Mentions obligatoires listées dans le Code monétaire et financier
- Caractère professionnel des créances et des relations entre les protagonistes
- Date apposée par le cessionnaire fixant la prise d’effet
L’avantage majeur de ce procédé est qu’il permet officiellement de recourir à des procédés informatiques pour individualiser les créances transmises en masse, comme le précise l’article L. 313-23 du Code monétaire et financier.
Effets juridiques de la cession Dailly
La remise du bordereau à l’affactureur l’investit, sans autre formalité, de toutes les créances visées, avec les sûretés, garanties et accessoires correspondants, sans stipulation particulière. Ce transfert produit ses effets entre l’affactureur et l’adhérent et est opposable aux tiers.
Pour renforcer sa sécurité, l’affactureur peut notifier au débiteur cédé la cession intervenue (article L. 313-28 du Code monétaire et financier). Cette notification interdit au débiteur de payer à un autre que l’affactureur cessionnaire.
Une protection supplémentaire résulterait d’une acceptation donnée par le débiteur cédé (article L. 313-29), qui aurait alors des conséquences rigoureuses analogues à l’acceptation d’une lettre de change par le tiré : le débiteur ne pourrait plus opposer au cessionnaire les exceptions qu’il pouvait opposer au cédant.
Pour approfondir les différentes formules contractuelles, consultez notre analyse détaillée des conventions-cadres d’affacturage.
Enjeux pratiques du choix du mécanisme de transfert
Avantages comparatifs des deux mécanismes
Le choix entre subrogation et cession Dailly dépend de plusieurs facteurs :
- Simplicité opérationnelle : La subrogation est généralement plus souple dans sa mise en œuvre quotidienne et mieux connue des acteurs économiques.
- Créances futures : La cession Dailly est plus adaptée pour les créances futures car elle produit effet dès la date du bordereau, même sans stipulation de prix et sans attendre la certitude et l’échéance de la créance cédée.
- Contexte international : Dans l’affacturage international, la cession Dailly peut être privilégiée, notamment lorsque les parties étrangères sont peu familières avec le mécanisme de subrogation français.
- Opposabilité aux tiers : Les deux mécanismes offrent une bonne opposabilité aux tiers, mais avec des nuances procédurales importantes en cas de procédure collective.
Protection en cas de procédure collective
Le choix du mécanisme de transfert a des implications significatives en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de l’adhérent.
Comme détaillé dans notre article sur les conflits entre l’affactureur et les tiers, la cession Dailly peut présenter certains avantages en termes de sécurité juridique dans ces situations de crise.
Les transferts effectués régulièrement avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective sont généralement considérés comme valides. La jurisprudence considère que les opérations qui ne sont que l’application d’un contrat-cadre conclu avant la période suspecte ne devraient pas être remises en cause.
Notification et information du débiteur
Quel que soit le mécanisme choisi, la notification au débiteur revêt une importance capitale.
Dans le cadre de la subrogation, elle n’est pas une condition de l’opposabilité aux tiers, mais elle vise à interdire au débiteur de payer un autre que l’affactureur. Après notification, un paiement du débiteur à l’adhérent ne serait plus libératoire selon l’article 1342-3 du Code civil.
Pour la cession Dailly, la notification revêt un caractère plus formel et suit des prescriptions précises (article R. 313-15 et suivants du Code monétaire et financier).
Notre cabinet accompagne régulièrement les entreprises dans la mise en place des solutions d’affacturage adaptées à leurs besoins, en évaluant avec précision les avantages et inconvénients de chaque mécanisme juridique.
Conclusion
Le choix entre subrogation et cession Dailly n’est pas anodin. Il doit être effectué en tenant compte des spécificités de l’entreprise, de la nature de ses créances et des objectifs poursuivis. La sécurité juridique de l’opération d’affacturage dépend largement de la maîtrise technique des mécanismes de transfert et du respect scrupuleux des formalités associées. Pour sécuriser vos opérations d’affacturage et optimiser leur structure juridique, notre cabinet se tient à votre disposition.
Sources
- Code civil, articles 1346 à 1348-2 (anciennement 1249 à 1252)
- Code monétaire et financier, articles L. 313-23 à L. 313-35
- Loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 dite Dailly
- Loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 relative à la preuve électronique