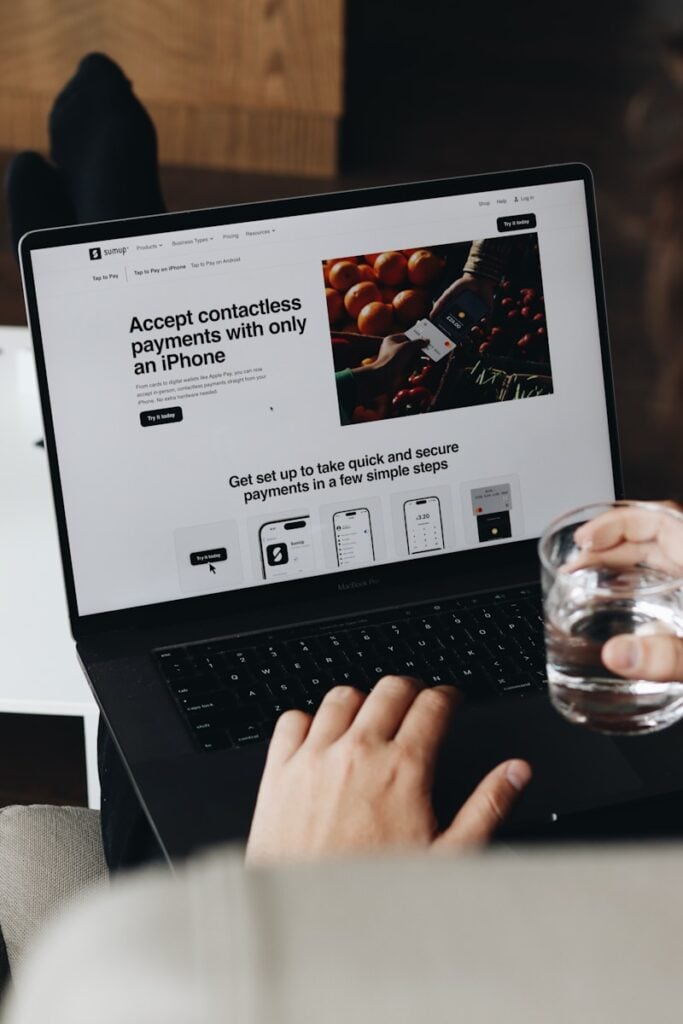Longtemps associée au monde de la bourse et des offres publiques d’acquisition, l’action de concert a progressivement investi le droit commun des sociétés. Cette évolution, bien que discrète, modifie en profondeur la manière d’analyser les rapports de force au sein des entreprises, cotées ou non. La clé de cette transformation réside dans la notion de « contrôle conjoint », qui permet d’appréhender la réalité du pouvoir exercé par un groupe d’actionnaires coordonnés. Ce mécanisme a des conséquences directes sur les obligations et les droits de chacun, notamment en matière de conflits d’intérêts. Comprendre cette extension est devenu indispensable pour tout dirigeant ou associé.
Le passage de l’action de concert du droit boursier au droit commun des sociétés
Historiquement, la notion générale d’action de concert a été développée pour répondre aux besoins spécifiques de la réglementation boursière, principalement pour assurer la transparence des prises de participation et encadrer les offres publiques. Cependant, une loi majeure est venue brouiller les frontières, faisant de ce concept un outil pertinent pour l’ensemble des sociétés commerciales.
L’introduction de la notion de « contrôle conjoint » par la loi du 15 mai 2001 (Art. L. 233-3 C.com)
Le véritable tournant a été opéré par la loi du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques. En modifiant la définition du contrôle dans le Code de commerce, le législateur a introduit un concept nouveau : le contrôle conjoint. Cette innovation a permis de sortir l’action de concert de son origine boursière pour l’intégrer au droit commun.
L’article L. 233-3, III du Code de commerce dispose désormais que « deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu’elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale ». Cette formulation, en apparence technique, a une portée considérable. Elle reconnaît qu’un groupe d’actionnaires, même s’ils ne détiennent pas individuellement la majorité, peuvent collectivement exercer un contrôle de fait sur une société s’ils agissent de manière coordonnée.
La référence explicite aux « personnes agissant de concert »
En visant expressément les « personnes agissant de concert », le Code de commerce établit un lien direct et indissociable entre le contrôle conjoint et la définition légale du concert. Dès lors, pour déterminer si un contrôle conjoint existe, il faut analyser si les actionnaires concernés ont conclu un accord « en vue de mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ».
Cette extension signifie que la notion de concert n’est plus l’apanage des sociétés cotées. Toute société commerciale, quelle que soit sa taille ou sa forme, peut voir une partie de son actionnariat qualifiée de concertiste si les conditions du contrôle conjoint sont réunies. Cette qualification emporte avec elle son corollaire le plus important : la solidarité.
La solidarité des concertistes face aux obligations du droit des sociétés
La principale conséquence juridique de la qualification d’action de concert est d’établir une responsabilité solidaire entre ses membres. Ce principe, fondamental, s’applique désormais aux obligations qui naissent du droit commun des sociétés, et pas uniquement de la réglementation financière.
Le principe de solidarité de l’article L. 233-10, III
L’article L. 233-10, III du Code de commerce énonce clairement que « les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements ». La solidarité signifie que chaque membre du concert peut être tenu pour responsable de la totalité de l’obligation qui pèse sur le groupe. Si un des concertistes manque à une obligation, les autres peuvent être poursuivis pour l’ensemble.
Cette règle a pour effet de traiter le groupe de concertistes comme une entité unique et homogène, même en l’absence de personnalité morale propre. L’objectif est d’empêcher que la division des participations au sein d’un groupe ne serve à diluer les responsabilités et à contourner la loi.
Application aux situations de conflits d’intérêts
C’est en matière de conflits d’intérêts que cette solidarité trouve un champ d’application particulièrement pertinent en droit commun. De nombreuses dispositions du Code de commerce prévoient des interdictions de vote pour un actionnaire personnellement « intéressé » à une opération. La question qui se pose est de savoir si cette interdiction, visant un individu, peut être étendue à l’ensemble des personnes agissant de concert avec lui.
La jurisprudence, d’abord réticente, évolue vers une reconnaissance de cette dimension collective. L’idée est que la communauté d’intérêts qui lie les concertistes justifie qu’ils soient tous considérés comme « intéressés » lorsque l’un d’entre eux l’est. L’intérêt personnel de l’un devient l’intérêt partagé du groupe.
Exemples d’application de la solidarité en droit commun
Plusieurs situations illustrent comment le mécanisme de l’action de concert et du contrôle conjoint étend les interdictions de vote prévues par la loi. Ces exemples diffèrent des implications en matière d’OPA et montrent la portée de cette notion dans la vie courante des sociétés.
Les conventions réglementées (interdiction de vote)
La procédure des conventions réglementées (articles L. 225-38 et suivants pour les SA) vise à prévenir les conflits d’intérêts en soumettant certaines conventions passées entre la société et l’un de ses dirigeants ou actionnaires significatifs à une autorisation et une ratification. L’associé ou l’actionnaire intéressé ne peut pas prendre part au vote sur la ratification.
Grâce à la notion de contrôle conjoint, cette interdiction de vote peut être étendue à tous les membres du concert agissant avec l’actionnaire intéressé. Si un groupe familial contrôle une société et que l’un de ses membres conclut une convention réglementée, il est logique que l’ensemble du groupe, partageant la même politique et les mêmes intérêts, soit privé de son droit de vote sur ce point.
L’interdiction de vote pour l’apporteur en nature
De la même manière, l’article L. 225-147 du Code de commerce interdit à l’apporteur en nature et à son conjoint, partenaire de PACS ou concubin de participer au vote sur l’évaluation de son apport. Cette règle vise à garantir l’objectivité de l’évaluation des biens apportés au capital.
La jurisprudence récente tend à étendre cette interdiction aux sociétés ou personnes qui agissent de concert avec l’apporteur. Si l’apporteur fait partie d’un groupe d’actionnaires qui contrôle la société, il est juste que l’ensemble du groupe soit exclu du vote. L’objectif est d’éviter un contournement de la loi par le biais de structures sociétaires ou d’accords occultes.
L’autocontrôle et l’interdiction de vote des filiales
L’autocontrôle est la situation dans laquelle une société détient ses propres actions par l’intermédiaire d’une ou plusieurs de ses filiales. L’article L. 233-31 du Code de commerce prévoit que les droits de vote attachés à ces actions sont suspendus pour éviter que la direction ne puisse artificiellement conforter son pouvoir.
La notion de contrôle conjoint a permis de renforcer ce dispositif. La Cour de cassation a ainsi validé la privation des droits de vote d’une société qui, bien que n’étant pas directement une filiale de l’émetteur, agissait de concert avec un tiers pour exercer un contrôle conjoint sur cette dernière. La participation est alors regardée comme de l’autocontrôle, et les droits de vote sont neutralisés. Cette analyse complexe requiert souvent l’assistance d’un avocat en droit des sociétés pour en démêler les implications.
Les nouveaux moyens d’identification des concertistes pour toutes les sociétés
L’un des défis de l’action de concert est sa preuve. Comment identifier un groupe d’actionnaires qui agissent de manière coordonnée, surtout si leur accord n’est pas formalisé par écrit ? Le législateur a progressivement mis en place des outils de transparence qui, bien qu’ayant des finalités propres, facilitent grandement cette identification.
L’information sur les participations significatives (Art. L. 233-6 C.com)
Applicable à toutes les sociétés par actions, l’article L. 233-6 du Code de commerce impose à une société de mentionner dans son rapport de gestion les prises de participation significatives (au-delà de certains seuils comme 5%, 10%, etc.) dans d’autres entreprises.
Plus encore, l’article L. 233-13 impose à la société de mentionner l’identité des personnes détenant des fractions importantes de son propre capital. Ces informations, qui concernent toutes les sociétés et pas seulement celles qui sont cotées, permettent de cartographier l’actionnariat et de repérer les liens capitalistiques qui peuvent sous-tendre une action de concert.
L’identification des bénéficiaires effectifs
Un outil encore plus puissant a été introduit dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : l’obligation pour la plupart des sociétés d’identifier et de déclarer leurs « bénéficiaires effectifs » dans un registre dédié. Le bénéficiaire effectif est la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent la société.
Cette obligation de transparence radicale force les sociétés à remonter les chaînes de détention, même les plus complexes, pour identifier les individus qui sont aux commandes. Ce faisant, elle met en lumière les groupes de personnes physiques qui exercent un contrôle conjoint, fournissant ainsi une preuve quasi-irréfutable de l’existence d’une communauté d’intérêts et, potentiellement, d’une action de concert.
L’extension de l’action de concert au droit commun des sociétés, via le concept de contrôle conjoint, représente une avancée majeure pour la transparence et la moralisation de la vie des affaires. Elle offre aux juges et aux associés minoritaires des outils efficaces pour faire respecter les règles de conflits d’intérêts et garantir que les décisions sont prises dans l’intérêt de la société, et non dans celui d’un groupe d’actionnaires dissimulé.
Pour analyser la structure de votre actionnariat ou faire valoir vos droits face à un groupe d’associés, notre cabinet peut vous accompagner pour évaluer la pertinence de qualifier une situation d’action de concert.
Sources
- Code de commerce : articles L. 233-3, L. 233-6, L. 233-10, L. 225-38, L. 225-147, L. 233-31
- Loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques