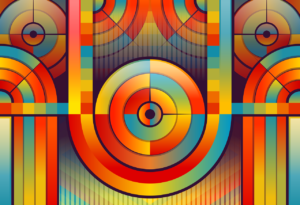Coincé avec un client qui refuse de payer? L’injonction de payer pourrait être votre solution. Cette procédure, méconnue du grand public, constitue pourtant un outil efficace pour récupérer les sommes dues sans s’engager dans un procès interminable.
Définition et objectifs de l’injonction de payer
L’injonction de payer est une procédure judiciaire simplifiée permettant à un créancier d’obtenir rapidement un titre exécutoire contre un débiteur récalcitrant. Elle représente une réponse juridique à l’inertie d’un débiteur qui se soustrait à ses obligations de paiement.
Sa nature juridique est double : dans sa première phase, elle constitue une procédure non contradictoire, puis dans sa seconde phase, elle devient pleinement contradictoire si le débiteur forme opposition.
Sa finalité principale réside dans l’obtention accélérée d’un titre exécutoire permettant de contraindre le débiteur au paiement. Comme le souligne l’article 1405 du Code de procédure civile, cette procédure vise à obtenir le recouvrement d’une créance déterminée tout en préservant les droits de la défense.
L’équilibre entre protection du créancier et respect des droits du débiteur se manifeste par la possibilité, pour ce dernier, de former opposition après la signification de l’ordonnance.
Évolution historique de l’injonction de payer
Inspirée par la Mahnverfahren allemande, l’injonction de payer française trouve son origine dans le décret-loi du 25 août 1937 qui la désignait comme « procédure simplifiée pour le recouvrement des petites créances commerciales ».
La loi n°57-756 du 4 juillet 1957 a élargi son champ d’application aux créances civiles, améliorant ainsi son utilité pratique. Le décret n°72-790 du 28 août 1972 a ensuite supprimé toute limitation de quantum pour les créances concernées.
La codification actuelle résulte du décret n°81-500 du 12 mai 1981 qui a modernisé la procédure en supprimant notamment le visa préalable du juge pour l’apposition de la formule exécutoire.
Plus récemment, la loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 a remanié partiellement la procédure, notamment concernant les règles de compétence. Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a introduit la communication au débiteur par voie électronique des pièces justificatives.
Types de créances concernées
L’article 1405 du Code de procédure civile énonce limitativement les créances pouvant faire l’objet d’une injonction de payer:
- Les créances ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation statutaire et s’élevant à un montant déterminé.
La jurisprudence a interprété largement cette notion pour y inclure « toutes les sommes stipulées dans le contrat, déterminables en vertu des seules dispositions contractuelles » (Civ. 2e, 8 févr. 1989, Bull. civ. II, n°34).
Sont ainsi concernées les pénalités de retard prévues aux conditions générales, les indemnités dues en application d’une clause pénale, ou les dommages-intérêts prévus contractuellement.
- Les engagements résultant de l’acceptation ou du tirage d’une lettre de change, de la souscription d’un billet à ordre, ou de l’endossement de ces titres.
Certaines créances sont en revanche exclues de cette procédure:
- Les créances délictuelles ou quasi-délictuelles
- Les créances issues d’un quasi-contrat
- Les chèques impayés, qui relèvent d’une procédure spécifique
Particularités de l’injonction de payer
La première phase de l’injonction de payer est non contradictoire. Le juge rend sa décision sur la seule base des documents fournis par le créancier, sans entendre le débiteur. Cette caractéristique, qui pourrait sembler contraire aux principes fondamentaux du procès, se justifie par la volonté d’accélérer le recouvrement des créances incontestables.
La simplicité procédurale constitue un atout majeur: la demande est formée par simple requête remise au greffe. Selon l’article 1407 du Code de procédure civile, elle peut être présentée par le créancier lui-même ou par tout mandataire.
Le coût reste limité pour le créancier. Devant le tribunal de commerce, il devra avancer les frais de l’ordonnance, consignés au greffe, mais ces frais peuvent être mis à la charge du débiteur en cas de succès.
L’efficacité de cette procédure explique son succès croissant. En 2000, on comptait près de 675 000 requêtes devant les tribunaux d’instance, démontrant son utilité pratique pour les entreprises confrontées à des impayés.
Les récentes évolutions législatives, comme le décret n°2022-245 du 25 février 2022, ont renforcé la dématérialisation de la procédure, notamment en instituant la communication électronique des pièces justificatives au débiteur.
Confronté à une créance impayée d’origine contractuelle? Évaluez si l’injonction de payer correspond à votre situation. Notre cabinet peut analyser votre dossier et déterminer la stratégie de recouvrement optimale. N’attendez pas que votre créance devienne irrécouvrable.
Pour les créances ayant une dimension internationale, notamment au sein de l’Union Européenne, il est également pertinent d’explorer les spécificités de l’injonction de payer européenne.
Sources
- Code de procédure civile, articles 1405 à 1425
- Décret n°81-500 du 12 mai 1981 instituant les dispositions des livres III et IV du code de procédure civile
- Loi n°2011-1862 du 13 décembre 2011 relative à la répartition des contentieux
- Décret n°2022-245 du 25 février 2022 favorisant le recours à la médiation
- Civ. 2e, 8 février 1989, Bull. civ. II, n°34
- Com. 26 mai 1983, Gaz. Pal. 1983. 2. Pan. 290