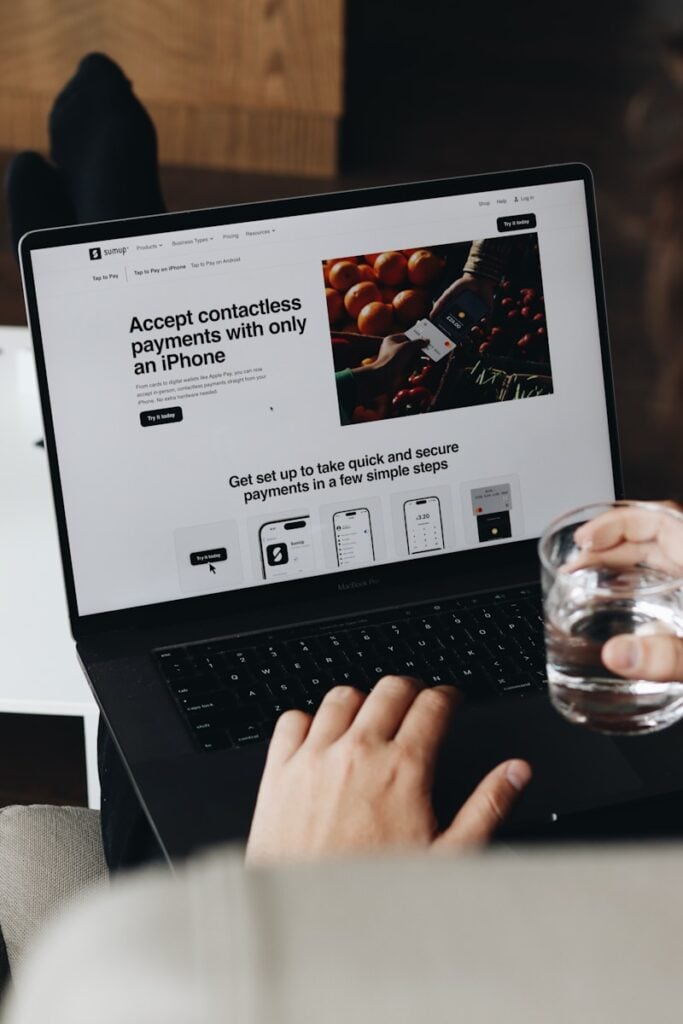Les établissements bancaires opèrent souvent avec plusieurs casquettes : prêteur, actionnaire, placeur de titres, conseiller… Cette polyvalence inhérente à leurs activités crée un terrain fertile pour l’émergence de conflits d’intérêts. Des affaires retentissantes, comme le scandale Enron aux États-Unis ou le litige LVMH contre Morgan Stanley en France, ont douloureusement mis en lumière les risques considérables liés à des dispositifs de prévention et de gestion inadéquats de ces situations. Comprendre la nature de ces conflits et les mécanismes mis en place pour les encadrer est essentiel pour les clients comme pour les établissements eux-mêmes.
Notion et enjeux des conflits d’intérêts
Définition juridique et cadre réglementaire
Un conflit d’intérêts survient lorsqu’une personne ou une entité est confrontée à des exigences contradictoires entre ses propres intérêts et les devoirs qu’elle a envers autrui, ou entre les intérêts divergents de plusieurs parties auxquelles elle doit loyauté. Dans le secteur bancaire, cela se manifeste typiquement lorsque l’intérêt propre de la banque entre en opposition avec celui d’un client, ou lorsque les intérêts de deux clients différents sont antagonistes et que la banque est impliquée avec les deux. Comme le souligne P.-F. Cuif, il s’agit d’une « situation dans laquelle les intérêts personnels d’une personne sont en opposition avec ses devoirs », situation qui appelle en principe à faire prévaloir les devoirs sur les intérêts personnels (RTD com. 2005, p. 1).
La prise de conscience de ces enjeux s’est accentuée au début des années 2000, catalysée par des scandales financiers majeurs. La réaction réglementaire a été significative. Aux États-Unis, le Sarbanes-Oxley Act de 2002 a instauré des règles plus strictes. En Europe, la directive « abus de marché » (2003/6/CE) a été un premier pas, imposant notamment aux producteurs d’analyses financières de mentionner leurs intérêts et conflits potentiels.
La directive concernant les marchés d’instruments financiers (MIF), initialement adoptée en 2004 (2004/39/CE) et refondue depuis (MIF 2 – 2014/65/UE), a considérablement renforcé le dispositif. Son article 23 (reprenant l’esprit de l’article 18 de MIF 1) exige des entreprises d’investissement qu’elles prennent « toutes les mesures raisonnables pour détecter les conflits d’intérêts » et, si les mesures organisationnelles ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, qu’elles informent « clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts ».
Transposition en droit français
Le droit français a intégré ces exigences, principalement dans le Code monétaire et financier. L’article L. 533-10 de ce code impose aux prestataires de services d’investissement (PSI), catégorie incluant de nombreuses banques, de maintenir « des dispositions organisationnelles et administratives efficaces » et de prendre « toutes les mesures appropriées pour détecter et éviter ou gérer les conflits d’intérêts ». Cette obligation vise à protéger les clients contre les atteintes potentielles à leurs intérêts dues à ces conflits. La compréhension de la responsabilité bancaire en qualité de prestataire de services d’investissement est donc essentielle dans ce contexte, car les manquements en matière de gestion des conflits et PSI peuvent engager lourdement l’établissement.
L’affaire LVMH c/ Morgan Stanley a marqué un tournant jurisprudentiel en France. La condamnation de la banque pour avoir diffusé des analyses financières défavorables sur LVMH tout en conseillant un concurrent (Gucci) a souligné l’importance d’une gestion rigoureuse des conflits, même en l’absence de réglementation spécifique aussi détaillée qu’aujourd’hui. La cour d’appel de Paris (30 juin 2006) a confirmé la condamnation sur le terrain de la responsabilité civile (anciens articles 1382 et 1383 du Code civil, aujourd’hui 1240 et 1241), démontrant que les manquements déontologiques peuvent avoir des conséquences financières importantes.
Typologie des conflits d’intérêts bancaires
Les situations de conflits d’intérêts dans le secteur bancaire peuvent être classées en deux grandes catégories.
Conflits entre la banque et son client
Ces conflits émergent lorsque la banque est susceptible de privilégier ses propres intérêts (commerciaux, financiers) au détriment de ceux de son client. Plusieurs scénarios illustrent cette tension :
- Financement et conseil antagonistes : Une banque qui finance une entreprise pourrait être tentée de moduler ses conseils en investissement ou en restructuration pour préserver sa propre créance, même si cela ne correspond pas à l’intérêt optimal du client.
- Produits « maison » : La promotion active de produits financiers (OPCVM, produits structurés, assurance-vie en unités de compte) conçus ou gérés par la banque ou ses filiales peut créer un conflit si ces produits sont moins performants ou plus risqués que des alternatives externes, mais génèrent plus de revenus pour l’établissement.
- Rôle d’actionnaire et de prêteur : Lorsqu’une banque détient une participation significative dans une entreprise cliente, ses décisions de crédit peuvent être influencées par ses intérêts d’actionnaire, brouillant les lignes entre les deux rôles.
- Information asymétrique : La banque détient souvent plus d’informations que son client sur les marchés ou sur des produits spécifiques. Elle pourrait être tentée d’utiliser cette asymétrie à son avantage, par exemple en ne divulguant pas tous les risques d’un placement. Le conflit entre banque et client est une réalité complexe à gérer.
Conflits entre plusieurs clients de la banque
La banque peut également se trouver prise entre les intérêts divergents de deux ou plusieurs de ses clients. Sa position centrale et l’accès à des informations confidentielles sur chacun d’eux rendent ces situations particulièrement délicates :
- Opérations de marché (M&A) : Une banque conseillant une entreprise cible dans une opération de fusion-acquisition tout en finançant l’acquéreur potentiel, ou en conseillant les deux parties, est en situation de conflit manifeste.
- Financement de concurrents : Financer deux entreprises directement concurrentes sur un même marché peut poser problème si la banque utilise des informations obtenues d’un client au profit de l’autre, ou si ses décisions de financement favorisent l’un au détriment de l’autre.
- Intermédiation : Conseiller un client pour l’acquisition d’un actif (immobilier, entreprise) appartenant à un autre client de la banque exige une gestion prudente pour éviter de favoriser l’une des parties.
- Gestion d’actifs et analyse financière : Une banque dont le département de gestion d’actifs détient des positions importantes dans une société peut voir son département d’analyse financière incité à publier des recommandations favorables sur cette société, au détriment de l’objectivité due aux autres clients investisseurs.
La complexité organisationnelle des grands groupes bancaires, avec leurs multiples filiales et départements spécialisés, rend la détection et la gestion de ces conflits inter-clients particulièrement ardue, comme l’a souligné J. Stoufflet.
Solutions et dispositifs de prévention et de gestion
Face à ces risques, la réglementation et les pratiques professionnelles ont développé plusieurs mécanismes de prévention et de gestion.
Les « murailles de Chine » (Chinese Walls)
Le cloisonnement organisationnel est la mesure préventive la plus fondamentale. Les « murailles de Chine » désignent l’ensemble des procédures visant à établir une séparation étanche entre les différents départements ou activités d’un établissement financier pour empêcher la circulation inappropriée d’informations confidentielles ou privilégiées. Par exemple, le service de conseil en fusions-acquisitions doit être isolé du service de financement ou de l’analyse financière.
Le code de conduite AFEI/FBF (Association Française des Entreprises d’Investissement / Fédération Bancaire Française) sur l’analyse financière énonce clairement ce principe : « Afin de prévenir la circulation indue d’informations confidentielles et/ou privilégiées […] le prestataire de services d’investissement doit mettre en place […] des procédures connues sous le nom de ‘Murailles de Chine’. »
Ce cloisonnement physique et informationnel repose sur le principe du « besoin d’en connaître » (need to know) : une information sensible n’est communiquée qu’aux collaborateurs dont la fonction l’exige impérativement. L’efficacité de ces murailles dépend de la rigueur de leur mise en œuvre et du contrôle interne.
L’information et le consentement du client
Lorsque les mesures organisationnelles ne peuvent suffire à écarter tout risque de conflit, l’information transparente du client devient une obligation légale. L’article L. 533-10 du Code monétaire et financier impose aux PSI d’informer « clairement » les clients « de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts » avant d’agir pour leur compte.
Cette information doit être :
- Préalable : Avant que l’opération concernée ne soit réalisée.
- Claire et précise : Permettant au client de comprendre la nature du conflit.
- Sur support durable : Pour laisser une trace et permettre une consultation ultérieure.
- Suffisamment détaillée : Compte tenu de la nature du client (professionnel ou non professionnel), pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause.
Dans certains cas, un consentement explicite du client peut être requis pour que la banque puisse agir malgré le conflit identifié.
Règles spécifiques pour certaines activités
Des règles plus spécifiques s’appliquent à certaines activités particulièrement exposées :
- Analyse financière : Pour garantir l’objectivité des recommandations, des règles strictes encadrent l’indépendance des analystes (séparation avec la banque d’investissement, règles sur la rémunération, contrôle des communications avec les émetteurs).
- Conseil en investissement : Les PSI doivent évaluer l’adéquation des produits proposés au profil du client (connaissances, expérience, situation financière, objectifs), et le cas échéant, le mettre en garde.
- Gestion pour compte de tiers : Des obligations renforcées s’appliquent pour éviter que le gérant ne privilégie les intérêts de la banque ou d’autres clients au détriment du mandant.
Le rôle du déontologue et du contrôle interne
La fonction de déontologue (ou de responsable de la conformité) est devenue centrale dans les établissements financiers. Il est chargé de :
- Mettre en place et superviser les procédures de gestion des conflits.
- Détecter les situations à risque.
- Conseiller et former les collaborateurs.
- Assurer le respect des « murailles de Chine ».
Le dispositif de contrôle interne doit intégrer la surveillance active des conflits d’intérêts potentiels et vérifier l’efficacité des mesures mises en place.
Il est à noter que l’article L. 511-34, 4° du Code monétaire et financier prévoit une exception encadrée, autorisant la transmission d’informations confidentielles entre entités d’un même groupe si cela est strictement nécessaire à la gestion des conflits d’intérêts au niveau du groupe. La question de la responsabilité et des conflits d’intérêts est complexe et nécessite une vigilance constante.
La gestion des conflits d’intérêts est un défi permanent pour le secteur bancaire. Si vous êtes confronté à une situation où vous suspectez un conflit d’intérêts ayant porté atteinte à vos droits, l’assistance d’un avocat en droit bancaire peut être déterminante pour analyser la situation et défendre vos intérêts. N’hésitez pas à contacter notre cabinet pour une évaluation de votre dossier.
Sources
- Code monétaire et financier, notamment articles L. 511-33, L. 511-34, L. 533-10.
- Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers (MIF 2).
- Règlement (UE) n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.
- P.-F. Cuif, « Le conflit d’intérêts, Essai sur la détermination d’un principe juridique en droit privé », RTD com. 2005, p. 1.
- J. Stoufflet, « Conflits d’intérêts dans l’activité bancaire », Estudios juridicos en memoria del professor Rodolfo Mezzema Alvarez, Ed. Fondacion de Cultura universatoria, Montevideo, Uruguay, 1999.
- Cour d’appel de Paris, 30 juin 2006, Morgan Stanley c/ LVMH.
- Recommandation ACPR n°2011-R-03 du 6 mai 2011.
- Code de conduite AFEI/FBF sur la gestion des conflits d’intérêts en matière d’analyse financière.