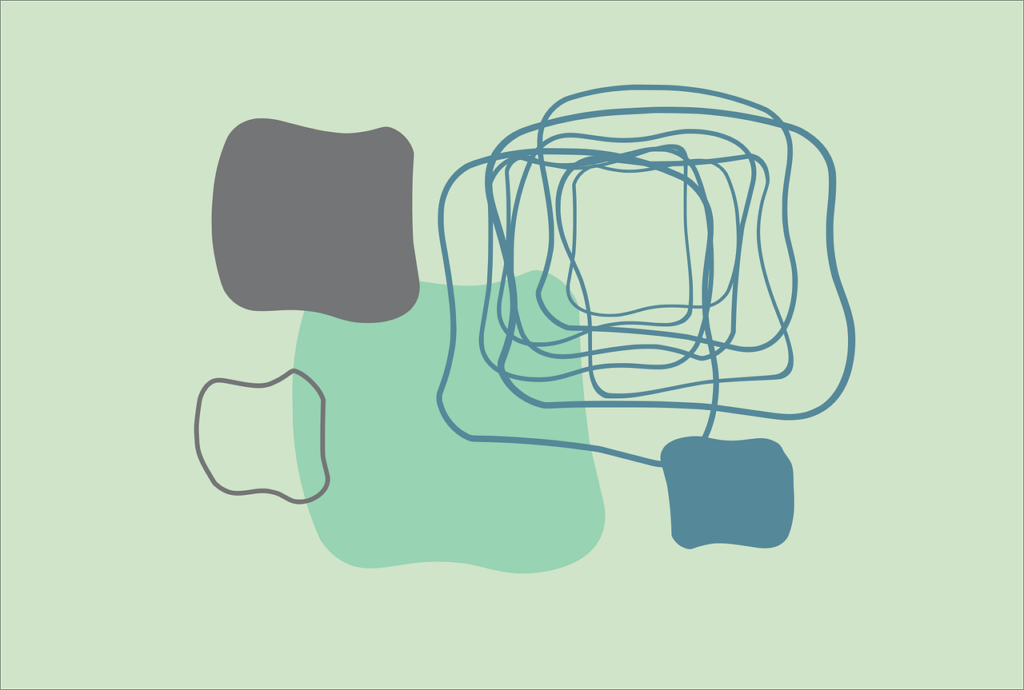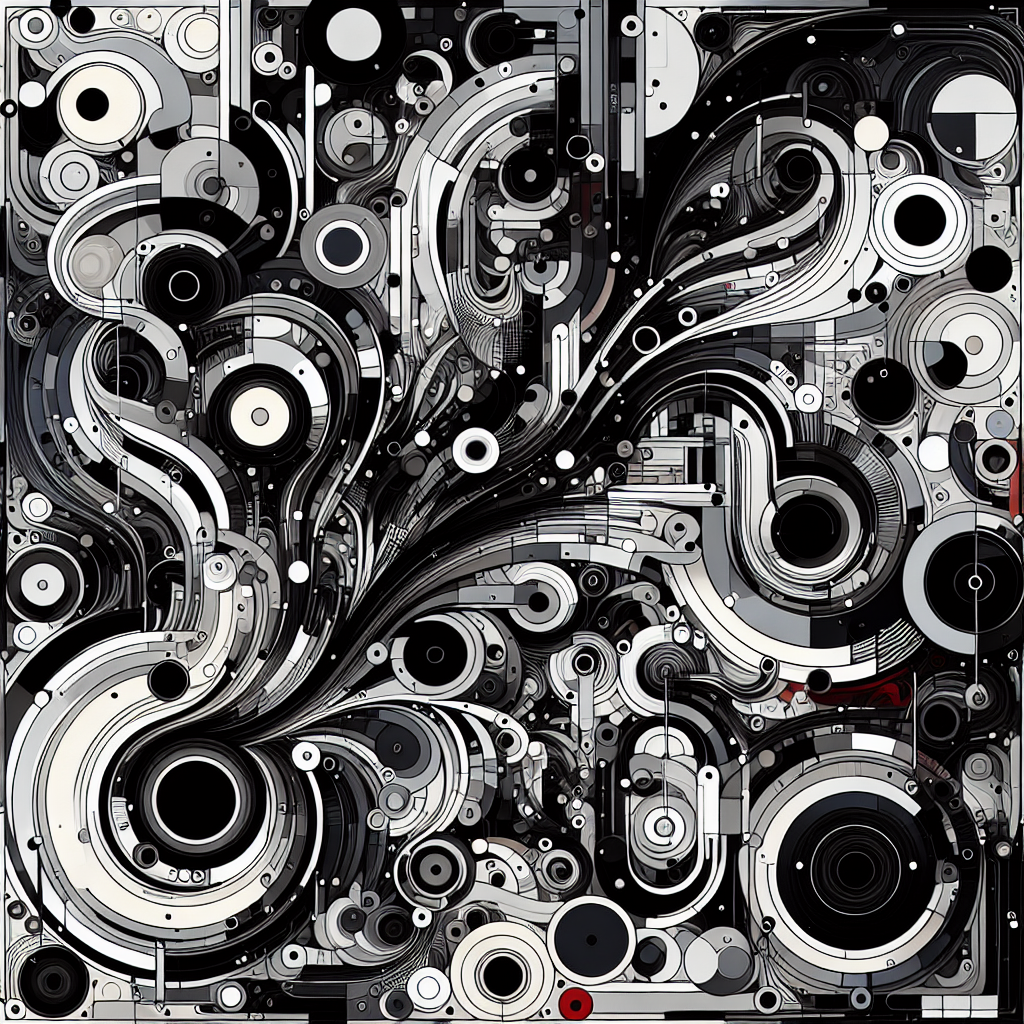Le cautionnement constitue l’une des sûretés personnelles les plus utilisées dans notre droit. Il permet à un créancier de sécuriser sa créance en obtenant l’engagement d’un tiers à payer la dette si le débiteur principal ne le fait pas. Cette garantie se décline en plusieurs variétés, chacune avec ses spécificités et avantages. Pour une compréhension plus large des sûretés personnelles, incluant la différence entre cautionnement et garantie autonome, consultez nos analyses.
I. Cautionnement simple ou solidaire
La distinction entre cautionnement simple et solidaire touche à l’étendue des droits du créancier face à la caution.
Dans le cautionnement simple, la caution bénéficie du « bénéfice de discussion ». Ce droit lui permet d’exiger que le créancier poursuive d’abord le débiteur principal avant de lui réclamer paiement. La caution peut ainsi dire : « Allez d’abord saisir les biens du débiteur, je ne paierai que s’il ne reste rien à récupérer. »
Le cautionnement solidaire, lui, prive la caution de ce bénéfice. Le créancier peut agir directement contre elle sans avoir à poursuivre le débiteur principal. Cette forme domine en pratique car elle renforce l’efficacité de la garantie.
On distingue trois degrés de solidarité :
- La solidarité entre cautions et avec le débiteur
- La solidarité horizontale (entre cautions seulement)
- La solidarité verticale (entre chaque caution et le débiteur)
II. Cautionnement civil ou commercial
Le cautionnement est par principe un contrat civil. Il devient commercial selon trois critères.
La commercialité par nature s’applique au cautionnement bancaire. Ces engagements sont des opérations de crédit, commerciales par essence.
La commercialité par la forme concerne l’aval d’un effet de commerce, bien que la jurisprudence tende désormais à mieux distinguer aval et cautionnement.
La commercialité par accessoire, nouveauté de l’ordonnance du 15 septembre 2021, qualifie d’acte de commerce tout cautionnement de dettes commerciales. Cette règle simplifie le traitement juridique : le contrat principal et son cautionnement relèvent du même droit et de la même juridiction.
Cette qualification emporte des conséquences majeures : présomption de solidarité en matière commerciale, compétence des tribunaux de commerce, liberté de preuve si toutes les parties sont commerçantes.
III. Cautionnement conventionnel, légal ou judiciaire
Le cautionnement conventionnel résulte de la volonté des parties. C’est la forme la plus courante.
Le cautionnement légal est imposé par la loi dans certaines situations. Par exemple, l’article 601 du Code civil oblige l’usufruitier à fournir une caution au nu-propriétaire. D’autres cas existent dans le Code civil et le Code de commerce.
Le cautionnement judiciaire est ordonné par un juge. Ainsi, selon l’article 815-6 du Code civil, le président du tribunal judiciaire peut contraindre l’indivisaire nommé administrateur à fournir une caution.
Malgré leur origine différente, ces trois formes restent des contrats. La loi ou le juge imposent au débiteur de fournir une caution, mais ils ne peuvent forcer personne à devenir caution contre son gré. C’est une différence majeure avec les sûretés réelles légales ou judiciaires.
Des règles spécifiques s’appliquent aux cautionnements légaux et judiciaires. La caution doit présenter une solvabilité « suffisante pour répondre de l’obligation ». Si elle perd cette solvabilité après son engagement, le débiteur doit en fournir une autre ou substituer une sûreté réelle « suffisante ».
IV. Modèles complexes de cautionnement
Deux mécanismes complexes ajoutent un quatrième acteur au trio classique (créancier/débiteur/caution).
La certification de caution crée un cautionnement au second degré. Le certificateur garantit au créancier la solvabilité de la caution, non celle du débiteur principal. Si la caution ne paie pas, le créancier pourra se tourner vers le certificateur.
Le sous-cautionnement protège la caution elle-même. La sous-caution s’engage envers la caution (non envers le créancier) à lui rembourser ce qu’elle aura payé pour le débiteur principal. Ce mécanisme reproduit le schéma triangulaire du cautionnement, mais en déplaçant les rôles : la caution devient « créancier » et la sous-caution devient « garant ».
Ces deux techniques diffèrent par leur usage pratique. La certification de caution, ancienne mais peu utilisée, subit la concurrence de la pluralité de cofidéjusseurs solidaires. Le sous-cautionnement, longtemps ignoré par le législateur mais intégré au Code civil en 2021, connaît un succès pratique, notamment quand les banques se portent caution de leurs clients.
La réforme du 15 septembre 2021 a modernisé le droit du cautionnement. Elle a supprimé certaines dispositions désuètes tout en intégrant au Code civil des règles qui figuraient auparavant dans des textes épars, comme le Code de la consommation. Cette évolution poursuit un double objectif : assurer la sécurité juridique des créanciers tout en protégeant les cautions contre les engagements excessifs.
Pour le créancier, le choix de la forme de cautionnement dépend de l’équilibre recherché entre efficacité de la garantie et facilité d’obtention. Un cautionnement solidaire offre une meilleure protection mais peut effrayer certaines cautions. Un cautionnement simple sera plus facilement accepté mais moins efficace en cas de défaillance du débiteur. Pour un accompagnement sur mesure ou une analyse de vos engagements, nos avocats spécialisés en cautionnement sont à votre disposition.
Sources
- Code civil, articles 601, 815-6, 2288 à 2320
- Code de commerce, article L. 110-1
- Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés
- Répertoire de droit civil, Cautionnement, par Gaël PIETTE (février 2022)