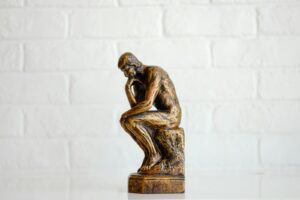L’ouverture d’une procédure de sauvegarde marque une étape décisive pour une entreprise confrontée à des difficultés qu’elle n’est pas en mesure de surmonter seule, sans être pour autant en état de cessation des paiements. Loin d’être une fin en soi, cette procédure vise avant tout la réorganisation de l’entreprise pour permettre la poursuite de son activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement de son passif. Au cœur de ce processus se trouve le plan de sauvegarde, dont l’élaboration et la négociation constituent des phases déterminantes pour l’avenir de l’entreprise. Réussir cet exercice demande anticipation, rigueur et une stratégie de négociation bien définie avec les créanciers. Cet article détaille les étapes fondamentales pour préparer et négocier ce plan dans les meilleures conditions. Pour une présentation complète de la procédure de sauvegarde, et une vue d’ensemble, vous pouvez consulter notre guide global des procédures.
L’importance de l’anticipation : préparer le terrain avant la procédure
La réussite d’un plan de sauvegarde repose en grande partie sur la qualité du travail préparatoire effectué avant même l’ouverture formelle de la procédure, ou tout au début de la période d’observation. Cette phase d’anticipation est essentielle pour poser un diagnostic précis et identifier les solutions viables.
Le travail préalable d’analyse et d’investigation interne
Avant toute chose, le dirigeant, souvent avec l’aide de ses conseils, doit mener une analyse approfondie de la situation de l’entreprise. Il s’agit de comprendre les origines des difficultés : sont-elles conjoncturelles, structurelles ? Liées au marché, à l’organisation interne, à des facteurs financiers ? Cette investigation doit être lucide et exhaustive.
Cela implique de rassembler et d’analyser toutes les données pertinentes : comptables (bilans, comptes de résultat prévisionnels), financières (endettement, trésorerie), commerciales (carnet de commandes, positionnement marché), sociales (effectifs, climat social) et opérationnelles (processus de production, chaîne logistique). L’objectif est d’obtenir une photographie fidèle de la situation et d’identifier les forces et faiblesses de l’entreprise. Un diagnostic précis est la condition sine qua non pour construire un projet de plan réaliste et crédible.
Identifier les leviers de réorganisation potentiels
Sur la base de ce diagnostic, l’étape suivante consiste à identifier les leviers d’action pour redresser la situation. Ces leviers peuvent être de différentes natures :
- Économiques : Recentrage sur les activités rentables, abandon des branches déficitaires, développement de nouveaux produits ou marchés, optimisation des coûts d’achat, amélioration de la marge.
- Financiers : Recherche de nouveaux financements, renégociation de la dette existante, augmentation de capital, cession d’actifs non stratégiques.
- Organisationnels : Révision des processus internes, réorganisation des services, optimisation de la chaîne logistique, amélioration de la productivité.
- Socaux : Adaptation des effectifs aux besoins réels de l’entreprise, réorganisation du temps de travail, plan de formation. Bien que souvent sensible, cet aspect doit être abordé avec objectivité dans le cadre des dispositions légales.
Cette identification précoce des axes de redressement permettra d’alimenter le projet de plan et de démontrer la capacité de l’entreprise à se réformer et à retrouver une trajectoire pérenne. C’est également sur cette base que les négociations avec les créanciers pourront s’engager de manière constructive.
L’élaboration du projet de plan de sauvegarde
Une fois la procédure ouverte et la période d’observation commencée, l’élaboration formelle du projet de plan peut débuter, sous l’égide de l’administrateur judiciaire s’il en a été désigné un, et avec la participation active du débiteur. Ce projet est le document central qui synthétise la stratégie de redressement.
Le bilan économique, social et environnemental
L’administrateur judiciaire (ou le débiteur s’il n’y en a pas) est chargé d’établir un bilan économique, social et, le cas échéant, environnemental de l’entreprise. Ce document, prévu par l’article L. 626-8 du Code de commerce, dresse un état des lieux complet à un instant T. Il analyse les causes des difficultés, détaille la situation financière, les perspectives de marché, les moyens de financement disponibles, et les conditions sociales au sein de l’entreprise.
Ce bilan constitue le fondement objectif sur lequel le projet de plan va s’appuyer. Il permet au tribunal et aux créanciers d’avoir une vision claire et partagée de la situation, préalable indispensable à l’évaluation des propositions de redressement. Il doit être précis, documenté et refléter sans complaisance la réalité de l’entreprise.
Définir les perspectives de redressement
Le cœur du projet de plan réside dans la définition des perspectives de redressement. Il s’agit de traduire les leviers identifiés précédemment en mesures concrètes et chiffrées. Le projet doit exposer de manière détaillée :
- Les modalités de règlement du passif : C’est un point central. Le projet propose des délais de paiement, et éventuellement des remises de dettes, pour les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture. Ces propositions doivent être réalistes et soutenables pour l’entreprise au regard de sa capacité de remboursement future.
- Le niveau et les perspectives d’emploi : Le plan doit préciser l’impact des mesures de réorganisation sur l’emploi et justifier les éventuelles mesures de licenciement économique envisagées.
- Les mesures de réorganisation de l’entreprise : Il détaille les actions concrètes qui seront mises en œuvre (restructuration, cession d’actifs, réorganisation interne, etc.). Vous trouverez plus d’informations sur le contenu du plan de sauvegarde.
- Le financement du plan : Le projet doit démontrer comment l’entreprise financera son activité pendant l’exécution du plan et comment elle assurera le remboursement des créanciers (fonds propres, capacité d’autofinancement, nouveaux crédits, etc.).
Ce projet de plan est ensuite soumis aux organes de la procédure (mandataire judiciaire, ministère public) et, surtout, aux créanciers, dont l’adhésion est souvent déterminante.
La négociation du passif : une étape clé
L’apurement du passif est l’un des objectifs majeurs de la sauvegarde. Le projet de plan contient des propositions de délais et/ou de remises, mais celles-ci doivent être acceptées par les créanciers. La loi organise deux modalités principales de consultation : individuelle ou collective via des comités.
La consultation individuelle des créanciers : quand et comment ?
Lorsque la constitution de comités de créanciers n’est pas obligatoire (ce qui est le cas le plus fréquent pour les PME), le projet de plan est soumis à la consultation individuelle de chaque créancier concerné par les propositions de règlement du passif. Cette consultation est organisée par le mandataire judiciaire.
Concrètement, le mandataire judiciaire transmet à chaque créancier (dont la créance a été admise ou provisionnée) les propositions du débiteur le concernant. Ces propositions peuvent prévoir des délais de paiement (ne pouvant excéder la durée du plan, soit 10 ans maximum, ou 15 ans pour les agriculteurs) et/ou des remises de dettes. Les créanciers disposent alors d’un délai (fixé par la loi, généralement 30 jours) pour faire connaître leur réponse.
L’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation des propositions. En cas de refus explicite d’un créancier, les délais légaux maximums s’appliquent (les 10 ou 15 ans), sans possibilité de remise forcée sur la part non échue de sa créance. Cette consultation individuelle demande une gestion rigoureuse des échanges et des délais.
L’information à fournir aux créanciers consultés
Pour que les créanciers puissent se prononcer en connaissance de cause, une information claire et complète doit leur être fournie avec les propositions de règlement. Cette information comprend généralement :
- Un état de la situation de l’entreprise (souvent basé sur le bilan économique et social).
- Le projet de plan détaillé (mesures de redressement, perspectives financières).
- Les propositions spécifiques de délais et/ou remises pour le créancier consulté.
- Les conséquences d’une acceptation ou d’un refus.
La transparence est un gage de confiance. Mieux les créanciers comprennent la situation et la logique du plan proposé, plus ils sont susceptibles d’accepter les efforts demandés. Un accompagnement par un avocat peut s’avérer précieux dans cette phase pour structurer la communication et la négociation.
La consultation collective via les comités de créanciers
Pour les entreprises d’une certaine taille ou complexité financière, la loi impose ou permet la constitution de comités de créanciers. Cette approche vise à faciliter la négociation avec les principaux groupes de créanciers.
Cas de constitution obligatoire ou facultative des comités
La constitution des comités de créanciers est obligatoire dans les cas suivants (selon l’article L. 626-29 du Code de commerce) :
- Entreprises employant au moins 150 salariés ou réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 20 millions d’euros HT.
- Sociétés détenant ou contrôlant une autre société remplissant l’une des conditions ci-dessus.
En dehors de ces cas, la constitution de comités peut être demandée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire si l’entreprise dépasse certains seuils moins élevés (20 salariés et 3 millions d’euros de CA HT, ou détention d’une participation majoritaire dans une telle société), ou si elle est volontaire. Le tribunal statue sur cette demande.
Composition des comités (établissements de crédit, principaux fournisseurs)
Lorsque des comités sont constitués, la loi prévoit généralement la mise en place de deux comités distincts:
- Le comité des établissements de crédit et assimilés : Regroupe les banques, sociétés de financement, et autres entités fournissant des financements à l’entreprise.
- Le comité des principaux fournisseurs de biens ou de services : Rassemble les fournisseurs dont les créances représentent une part significative du passif fournisseurs. La liste est arrêtée par l’administrateur.
Les créanciers publics (Trésor public, organismes sociaux) ne participent pas aux comités mais sont consultés individuellement. Un comité des obligataires peut également être réuni si l’entreprise a émis des obligations.
Le rôle des comités dans la validation du projet de plan
Le projet de plan de sauvegarde est soumis pour approbation à chacun des comités constitués. L’objectif est d’obtenir un accord collectif sur les propositions de traitement du passif et les mesures de redressement affectant les membres du comité.
Chaque comité délibère séparément sur le projet. L’adoption du plan par un comité requiert une double majorité :
- La majorité des membres présents ou représentés ayant exprimé un vote.
- Ces membres doivent détenir au moins deux tiers du montant total des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote.
Un accord au sein de chaque comité facilite grandement l’adoption du plan par le tribunal. L’absence d’accord dans un comité n’empêche pas systématiquement l’adoption du plan, mais la rend plus complexe, le tribunal devant alors vérifier si les intérêts des créanciers dissidents sont suffisamment protégés.
Les délais et modalités de vote
L’administrateur judiciaire convoque les membres de chaque comité et leur soumet le projet de plan. Un délai de réflexion et de vote est fixé, généralement compris entre 20 et 30 jours à compter de la transmission du projet.
Le vote s’exprime sur l’ensemble du projet de plan. Les membres peuvent mandater un représentant pour voter en leur nom. Le résultat du vote de chaque comité est ensuite communiqué au tribunal. Cette procédure structurée permet d’obtenir une position collective des principaux groupes de créanciers dans un délai encadré.
Finalisation et présentation du projet de plan au tribunal
Que la consultation ait été individuelle ou collective via les comités, l’étape finale consiste à présenter le projet de plan (éventuellement amendé suite aux négociations) au tribunal. C’est le tribunal qui a le pouvoir d’arrêter le plan de sauvegarde.
Le tribunal examine le projet au regard de plusieurs critères :
- La viabilité économique et financière du plan.
- La capacité de l’entreprise à respecter les engagements pris (notamment le remboursement du passif).
- Le respect des intérêts des différentes parties prenantes (entreprise, salariés, créanciers).
- La régularité de la procédure de consultation des créanciers.
Le tribunal entend le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les représentants du personnel et peut entendre toute personne utile. S’il estime le plan sérieux et apte à assurer la sauvegarde de l’entreprise, il l’arrête par jugement. Ce jugement rend le plan opposable à tous, y compris aux créanciers ayant refusé les propositions ou n’ayant pas participé à la consultation. Il marque le début de la phase d’exécution du plan.
La préparation et la négociation d’un plan de sauvegarde sont des processus complexes qui exigent une vision stratégique, une analyse rigoureuse et une capacité à dialoguer avec l’ensemble des parties prenantes. L’anticipation et une approche structurée sont les meilleures garanties de succès pour permettre à l’entreprise de surmonter ses difficultés et de repartir sur des bases assainies.
Si vous anticipez des difficultés pour votre entreprise ou si vous êtes déjà engagé dans une procédure, n’hésitez pas à contacter notre cabinet pour un accompagnement juridique sur mesure, afin de discuter de votre situation spécifique et d’envisager les stratégies adaptées.
Sources
- Code de commerce, notamment les articles L. 626-1 à L. 626-34 (relatifs au plan de sauvegarde)