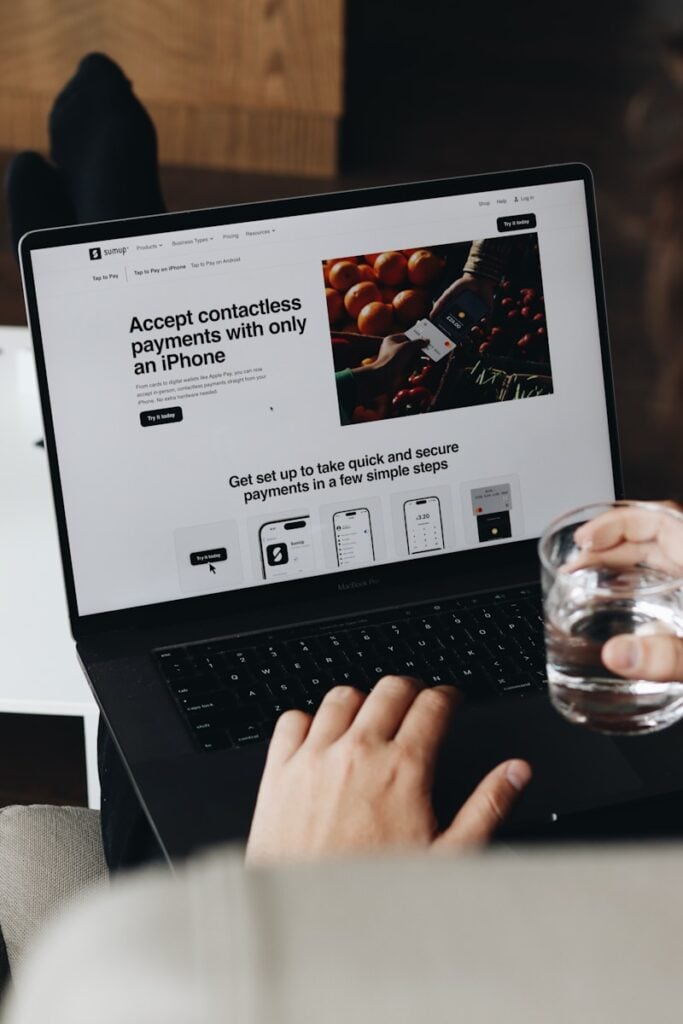L’introduction d’une action en justice par voie de requête est un acte fondamental de la procédure civile, marquant le point de départ du processus judiciaire. Contrairement à l’assignation, qui est un acte signifié par un commissaire de justice informant directement l’adversaire, la requête saisit d’abord le juge. Cependant, sa validité est subordonnée à un ensemble de règles strictes, tant sur le fond que sur la forme, édictées principalement par les articles 54 et 57 du Code de procédure civile. Une simple omission ou une imprécision peut entraîner des conséquences sévères, allant de la nullité de l’acte, source de dommage processuel, à l’irrecevabilité de la demande. La maîtrise de ce formalisme est donc essentielle pour préserver ses droits et garantir une information complète des parties. La rédaction d’une requête conforme aux exigences légales et la gestion des sanctions potentielles sont des actes complexes qui requièrent souvent l’assistance d’un avocat expert en procédure civile pour sécuriser vos droits et éviter tout vice de procédure.
I. Les conditions de fond impératives de la requête civile
Avant d’aborder la rédaction même de l’acte, il est primordial de s’assurer que les conditions de fond, relatives aux parties elles-mêmes, sont remplies. Ces exigences, si elles ne sont pas respectées, constituent des irrégularités de fond susceptibles de vicier la procédure dès son origine et d’entraîner une nullité de l’acte, soulevable en tout état de cause.
A. La capacité d’ester en justice des parties : personnes physiques et morales
La première condition pour agir en justice est la capacité d’ester, c’est-à-dire l’aptitude à être titulaire de droits (capacité de jouissance) et à les exercer soi-même (capacité d’exercice). Si la capacité de jouissance est reconnue à toute personne physique, elle est limitée pour les personnes morales par leur spécialité statutaire. La capacité d’exercice, principe pour les majeurs, est en revanche absente chez les mineurs non émancipés et les majeurs sous tutelle, qui doivent être représentés pour agir.
Un défaut de capacité est sanctionné par la nullité de fond de l’acte. Par exemple, une requête introduite au nom d’une personne décédée ou pour le compte d’une entité sans personnalité juridique, comme une société en participation, est nulle. La jurisprudence de la Cour de cassation a précisé que cette nullité pour irrégularité de fond ne peut être couverte par une régularisation ultérieure, par exemple par l’intervention des héritiers (Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.829). Avant d’analyser en détail ces conditions de validité, il est essentiel de comprendre la nature même de la requête et de la distinguer d’autres actes introductifs comme l’assignation, en explorant les différents types de requêtes prévus par le code de procédure civile.
B. Le pouvoir et la représentation à l’instance (Ad Litem)
Lorsqu’une partie n’a pas la capacité d’exercice ou choisit de ne pas agir personnelnellement, elle doit être représentée. Il faut distinguer la représentation à l’action (ad agendum), qui est le pouvoir d’engager le procès au nom d’autrui, de la représentation à l’instance (ad litem), qui est le mandat donné à un professionnel pour accomplir les actes de la procédure.
Dans de nombreuses procédures, notamment devant le tribunal judiciaire lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat doit respecter des règles de postulation limitant sa compétence à un ressort territorial défini. Le non-respect de ce principe est sanctionné par une nullité de fond. Le mandat de représentation confié à l’avocat, dit mandat ad litem, est présumé : il n’a pas à justifier d’un pouvoir écrit de son client pour les actes courants, mais son rôle de conseil demeure essentiel. Cependant, pour les actes les plus graves, comme un désistement d’action, un pouvoir spécial est requis.
II. Les exigences formelles de la requête : support et mentions obligatoires
Au-delà des conditions de fond, la validité d’une requête dépend du respect d’un formalisme précis. Ces exigences, qui concernent son support, son contenu et sa transmission au greffe, visent à garantir une information claire pour le juge et la partie adverse. Leur méconnaissance est généralement sanctionnée par une nullité pour vice de forme.
A. Le support de la requête : papier, numérique et signature électronique
La requête peut être rédigée sur papier libre ou au moyen de formulaires Cerfa, dont chaque modèle officiel est disponible en ligne. De plus en plus, la procédure se dématérialise, permettant de saisir certaines juridictions par voie électronique via le « Portail du justiciable » sur Justice.fr, un service public en ligne. Cette démarche implique l’utilisation d’une signature électronique dont la fiabilité est essentielle.
La loi confère à la signature électronique la même valeur qu’une signature manuscrite, à condition qu’elle repose sur un procédé fiable d’identification. Une signature électronique qualifiée, conforme au règlement européen eIDAS, bénéficie d’une présomption de fiabilité. Si la signature n’est pas conforme, la nullité n’est pas automatique. Une jurisprudence notable de la Cour de cassation a jugé qu’une irrégularité de signature électronique constitue un vice de forme : la nullité n’est encourue que si la partie adverse prouve que cette irrégularité lui a causé un préjudice, ce qui est rare si le demandeur est bien identifié (Civ. 1re, 23 sept. 2020, n° 19-12.829).
B. Les mentions obligatoires générales (Articles 54 et 57 CPC)
Le cœur du formalisme de la requête réside dans les mentions imposées par les articles 54 et 57 du Code de procédure civile, sous peine de nullité. La requête doit impérativement indiquer :
- La juridiction saisie : sa nature et son siège.
- L’identification complète des parties : pour une personne physique (nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance) et pour une personne morale (forme, dénomination, siège social et organe de représentation légale), afin que leur identité soit sans équivoque.
- L’objet de la demande : un exposé, même sommaire, des prétentions.
- Les pièces justificatives : une liste utile des pièces sur lesquelles la demande est fondée, souvent sous forme de bordereau.
- La tentative de résolution amiable : pour les contentieux n’excédant pas 5 000 euros ou certains conflits de voisinage relevant du juge des contentieux de la protection (JCP), il est obligatoire, à peine d’irrecevabilité, de mentionner les diligences amiables (médiation, conciliation) entreprises avant de saisir le juge.
- La date et la signature : la requête doit être datée et signée par le demandeur ou son mandataire.
L’omission d’une de ces mentions peut entraîner la nullité de l’acte, mais seulement si l’adversaire démontre que cette erreur lui cause un grief. Le respect de ces mentions obligatoires est la première étape pour obtenir un titre exécutoire, qui permettra ensuite d’engager des mesures d’exécution forcée ; il est donc crucial de maîtriser en amont les principes fondamentaux de la saisie.
C. Les mentions spécifiques selon le caractère de la requête (unilatérale ou conjointe)
La procédure civile distingue la requête unilatérale, mode de saisine le plus courant où le demandeur agit sans en informer au préalable son adversaire, de la requête conjointe. Dans le cas unilatéral, qui se distingue de l’assignation par l’absence d’information préalable de l’adversaire, l’identification précise du défendeur est une mention obligatoire pour permettre au greffe de le convoquer.
La requête est dite conjointe lorsqu’elle est présentée d’un commun accord par les parties. Celles-ci s’accordent pour soumettre leur différend à un juge mais sont en désaccord sur la solution. L’acte doit alors exposer leurs prétentions respectives, les points de désaccord et leurs moyens. Il peut également contenir des clauses spécifiques, comme une convention de renonciation à l’appel ou l’accord pour que le juge statue en amiable compositeur (en équité) et limite le débat.
D. La transmission de la requête au greffe
La transmission de la requête au greffe de la juridiction compétente peut s’effectuer par remise en main propre, par courrier postal (la requête est alors adressée au greffe) ou par voie électronique. C’est la date de réception par le greffe qui marque juridiquement la saisine de la juridiction. À partir de ce moment, le juge est officiellement chargé de l’affaire. Le greffe procède à l’inscription de l’affaire au répertoire général, ouvrant ainsi le dossier, et, dans le cas d’une requête unilatérale, adresse la convocation au défendeur à l’audience.
III. Les sanctions des irrégularités de la requête et les possibilités de régularisation
Le non-respect des conditions de validité d’une requête n’est pas toujours fatal. Le Code de procédure civile organise un système de sanctions graduées et offre des possibilités de « sauvetage » de l’acte, afin d’éviter de pénaliser excessivement le justiciable pour une simple erreur formelle.
A. Distinction entre nullité pour vice de forme et irrégularité de fond
Le droit procédural opère une distinction capitale. La nullité pour vice de forme sanctionne la méconnaissance d’une règle de présentation de l’acte. Pour être prononcée, elle suppose qu’un texte la prévoie, que l’adversaire prouve un préjudice (un « grief »), et qu’elle soit soulevée avant toute défense au fond. Cette exigence de grief, éclairée par une abondante jurisprudence, limite considérablement les annulations pour des erreurs mineures. La distinction entre vice de forme et irrégularité de fond n’est pas qu’une simple subtilité juridique ; elle constitue un élément fondamental de la protection du débiteur, notamment en matière de crédit à la consommation, qui peut ainsi soulever des nullités pour se défendre contre une demande mal formulée.
L’irrégularité de fond est bien plus grave, car elle touche aux conditions essentielles de l’action (défaut de capacité ou de pouvoir). Son régime est plus sévère : elle peut être soulevée à tout moment de la procédure et ne nécessite pas la preuve d’un grief. Une nullité pour vice de forme ou une irrégularité de fond peut avoir des conséquences graves, non seulement sur l’instance en cours mais aussi sur la capacité à engager ultérieurement une saisie immobilière, où les conséquences d’un vice de procédure peuvent être tout aussi dirimantes.
B. La régularisation des requêtes viciées et ses limites
Le principe directeur de la procédure est que la nullité doit être évitée. L’article 121 du Code de procédure civile prévoit ainsi que la nullité n’est pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Un acte initialement vicié peut donc être « régularisé ». Par exemple, l’oubli d’une mention obligatoire dans la requête peut être corrigé dans des écritures ultérieures.
Cependant, cette faculté a des limites. Certaines irrégularités de fond, comme l’action au nom d’une personne morale inexistante, sont insusceptibles de régularisation. De plus, depuis la réforme de la prescription de 2008, la régularisation d’un vice de forme est largement facilitée. En effet, ce texte, dans sa version en vigueur, et notamment l’article 2241 du Code civil, dispose que la demande en justice interrompt la prescription même en cas d’annulation de l’acte de saisine pour un vice de procédure. Cela signifie que le délai pour agir ne continue pas à courir, laissant le temps au demandeur de corriger son acte sans risquer la forclusion. Attention, une sanction plus radicale comme l’irrecevabilité (par exemple pour défaut de tentative de règlement amiable) ne peut généralement pas être régularisée et fait perdre le bénéfice de l’interruption de la prescription.
IV. Les effets procéduraux et substantiels du dépôt d’une requête
Le dépôt d’une requête valide au greffe déclenche une série d’effets juridiques importants, qui modifient à la fois le déroulement de la procédure et les droits des parties sur le fond.
A. L’introduction de l’instance et la saisine de la juridiction
Le premier effet de la requête est d’introduire l’instance, créant ainsi le « lien juridique d’instance » entre les parties et le juge. Simultanément, la remise de la requête au greffe marque la saisine de la juridiction compétente, qui peut être, selon la matière et le stade du contentieux, le juge du fond, le Juge de l’exécution dont il est crucial de comprendre les pouvoirs, voire le président du tribunal dans des cas spécifiques comme l’ordonnance sur requête. Le juge est alors investi de la mission de trancher le litige.
B. L’interruption des délais de prescription et de forclusion
C’est l’un des effets majeurs de la demande en justice, à distinguer d’une simple assignation en référé qui peut avoir des effets différents. Selon l’article 2241 du Code civil, la saisine d’une juridiction interrompt le délai de prescription de l’action. L’un des effets majeurs de la requête est l’interruption des délais de prescription, un mécanisme clé qui remet les compteurs à zéro et préserve les droits du demandeur pour toute la durée de l’instance. Cet effet se produit même si la juridiction saisie est incompétente ou si l’acte est annulé ultérieurement pour un vice de procédure, une solution maintes fois confirmée par la jurisprudence. Il faut cependant noter que certaines requêtes, comme celle visant à obtenir une mesure d’instruction avant tout procès (art. 145 CPC) ou la requête en injonction de payer, n’ont pas cet effet interruptif.
C. Les autres effets sur le fond du droit
La requête produit également des effets sur le droit substantiel. Elle vaut mise en demeure pour le défendeur, faisant courir les intérêts moratoires sur une somme d’argent. Dans le cadre d’une obligation de délivrer un corps certain, elle opère le transfert des risques de la chose au débiteur. Enfin, pour une personne détenant un bien de bonne foi et condamnée à le restituer, l’obligation de rendre les fruits (par exemple, les loyers d’un immeuble issu d’un bail) ne court qu’à compter de la date de la demande en justice.
La validité d’une requête en procédure civile est un enjeu qui conditionne l’accès au juge et l’efficacité des droits. Entre les exigences de fond et le formalisme pratique des articles 54 et 57 du Code de procédure civile, la rédaction de cet acte ne laisse aucune place à l’improvisation. Pour sécuriser votre démarche, l’assistance d’un avocat expert en procédure civile est souvent déterminante. Notre cabinet se tient à votre disposition pour analyser votre situation et vous accompagner.
Sources
- Code de procédure civile, notamment les articles 54, 57, 112 à 121
- Code civil, notamment les articles 1344, 2241 et 2243
- Jurisprudence de la Cour de cassation (notamment Civ. 2e, 4 mars 2021, n° 19-22.829 ; Civ. 1re, 23 sept. 2020, n° 19-12.894)
- Décrets et textes réglementaires publiés au Journal Officiel (JO)