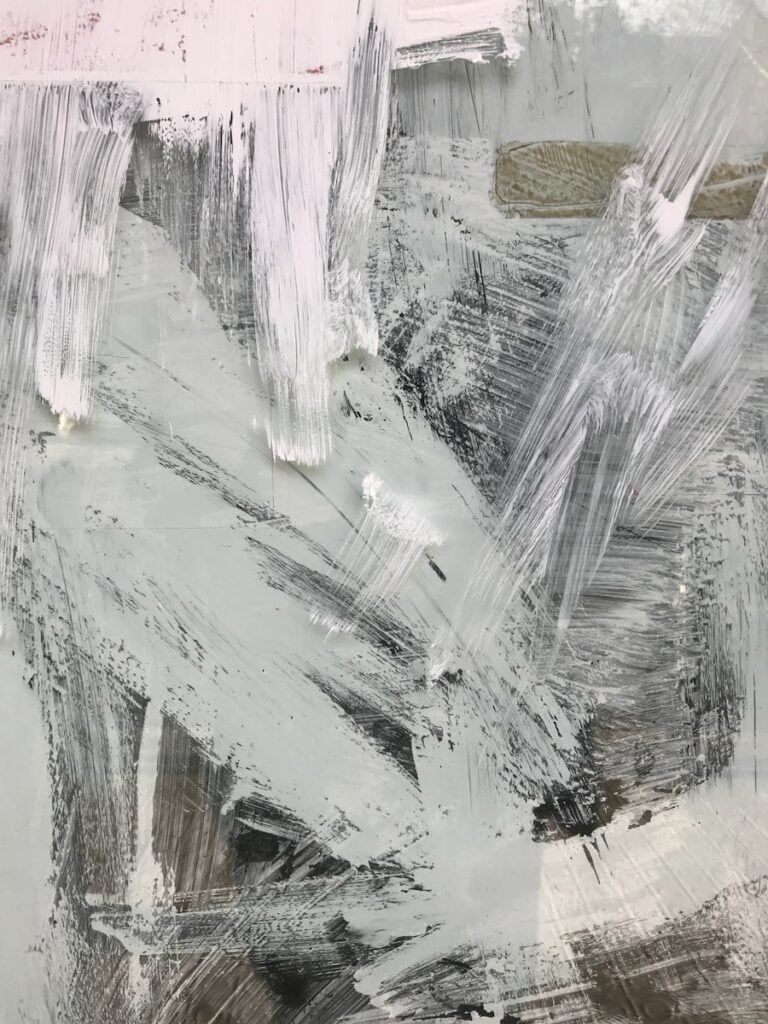Le recouvrement de créances contre un État étranger est une procédure semée d’embûches, où l’assistance d’un avocat expert en recouvrement de créances internationales est déterminante. Loin des procédures d’exécution classiques, la poursuite d’une dette détenue par une entité souveraine se heurte à un principe fondamental du droit international : l’immunité d’exécution. Ce mécanisme protège les biens d’un État contre toute mesure de contrainte sur le territoire d’un autre. Toutefois, ce principe n’est pas absolu. La loi française, notamment depuis l’intervention de la loi Sapin 2, a dessiné un cadre juridique complexe qui tente de concilier le respect de la souveraineté étatique et le droit des créanciers à obtenir l’exécution des décisions de justice, suivant une procédure civile adaptée. Comprendre les contours de ce régime est indispensable pour tout créancier, personne physique ou morale, qui envisage d’agir contre un débiteur étatique.
I. Le régime général des immunités d’exécution des états étrangers
L’immunité d’exécution constitue une exception notable au droit commun du recouvrement. Bien que l’immunité d’exécution constitue une exception notable, elle s’inscrit dans le cadre plus large du régime général des mesures conservatoires, dont la compréhension est essentielle pour saisir la portée de ces protections spécifiques. Ce principe, profondément ancré dans le droit international, a fait l’objet d’un encadrement législatif précis en France, visant à clarifier les conditions de sa mise en œuvre et de ses exceptions.
A. Définition et fondements des immunités d’exécution
L’immunité d’exécution est le corollaire de la souveraineté des États. Elle interdit qu’un État puisse faire l’objet de mesures de contrainte sur ses biens par les juridictions d’un autre État. Ce principe trouve son fondement dans le droit international coutumier, qui postule l’égalité et l’indépendance des nations entre elles. En pratique, cela signifie qu’un créancier, même muni d’une décision de justice définitive, ne peut pas, par principe, faire pratiquer une saisie sur les biens d’un État étranger situés en France.
Ce régime protecteur fait l’objet de critiques doctrinales. Des auteurs comme R. Bismuth (voir notamment sa note sous Cass. 1re civ., JDI 2018. 446), S. Bollée (Rev. crit. DIP 2015. 652) ou J. Heymann ont souligné les tensions qu’il engendre avec le droit à l’exécution, qui est une composante du droit d’accès au juge. C’est pour répondre à ces tensions que le législateur est intervenu pour aménager ce principe sans le renier.
B. L’encadrement des mesures contre les états étrangers par la loi Sapin 2 (art. L. 111-1-1 et L. 111-1-2 CPCE)
La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dite « Sapin 2 », a profondément réformé le droit des immunités en France en l’inscrivant dans le Code des procédures civiles d’exécution (CPCE), via les art. L. 111-1-1 et suivants. Elle a instauré un mécanisme de contrôle judiciaire préalable strict pour toute mesure d’exécution ou conservatoire à l’encontre d’un État étranger.
L’article L. 111-1-1 du CPCE impose désormais l’obtention d’une autorisation préalable du juge de l’exécution, rendue sur requête. Cette exigence met fin à la possibilité pour un créancier, même détenteur d’un titre exécutoire, de procéder directement à une saisie. Le juge ne peut accorder cette autorisation que si l’une des trois conditions alternatives prévues par cette disposition est remplie :
- L’État a expressément consenti à la mesure d’exécution.
- L’État a spécifiquement affecté ou réservé le bien en question à la satisfaction de la créance.
- Un titre – décision de justice ou sentence arbitrale – a été rendu, et le bien visé est utilisé à des fins autres que de service public non commercial, tout en présentant un lien avec l’entité débitrice.
La notion de « fins de service public non commerciales » est centrale. La loi elle-même énumère une liste non exhaustive de biens présumés servir de telles fins, comme les biens militaires ou ceux faisant partie du patrimoine culturel. La jurisprudence vient préciser au cas par cas cette distinction, qui demeure un point de contentieux majeur, chaque jour un peu plus précisée par la pratique.
II. Portée des mesures conservatoires et d’exécution forcée sur les biens des états étrangers
La possibilité de pratiquer une saisie sur un bien appartenant à un État étranger dépend fondamentalement de sa nature et de son usage. Le législateur a établi une hiérarchie claire, accordant une protection quasi absolue à certains biens tout en permettant, sous conditions, des mesures sur d’autres. La distinction entre les biens diplomatiques et les autres actifs est à cet égard déterminante.
A. Distinction des biens : biens diplomatiques et biens à fins non commerciales
L’art. L. 111-1-3 du CPCE renforce la protection des biens liés à la souveraineté. Il dispose que les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés pour les missions diplomatiques, consulaires ou auprès d’organisations internationales, sont insaisissables. La seule exception est une renonciation de l’État qui doit être non seulement « expresse », mais aussi « spéciale », c’est-à-dire qu’elle doit viser précisément ces biens spécifiques.
Pour les autres biens, la distinction entre les biens utilisés à des fins de service public non commerciales et les autres est cruciale, avec des applications particulièrement complexes pour certains actifs comme les navires d’État. Un bien utilisé pour une activité économique ou commerciale pourra potentiellement faire l’objet d’une saisie si les conditions de l’article L. 111-1-2 du CPCE sont réunies. En revanche, un bien affecté à une mission régalienne (sécurité, santé publique, éducation) sera protégé par l’immunité, sauf renonciation.
B. Spécificités de la saisie sur comptes bancaires d’états étrangers
La saisie des comptes bancaires d’États étrangers est soumise à des règles particulièrement strictes, qui dérogent à la procédure de droit commun souvent mise en œuvre par surprise, via un huissier de justice, pour les débiteurs classiques. Les comptes des missions diplomatiques bénéficient d’une présomption d’affectation à des fins de service public. Le créancier qui souhaiterait renverser cette présomption devrait apporter la preuve que les fonds sont en réalité utilisés pour des activités commerciales, une démonstration en pratique très difficile, qui exigerait de fournir un document probant sur les flux financiers de la société ou de l’entité concernée.
La jurisprudence récente a également dû se pencher sur les subtilités techniques liées aux opérations bancaires. Par exemple, une décision de 2022 a mis en lumière la distinction à opérer entre les fonds déjà crédités sur un compte et les virements en cours de traitement au moment de la saisie. Cette jurisprudence souligne que l’application des règles de saisie peut varier selon l’instrument de paiement, ajoutant une couche de complexité à des procédures déjà très encadrées et illustrant une distorsion de traitement entre différents flux financiers.
III. Le rôle de la jurisprudence et l’évolution du droit face aux immunités
Depuis l’adoption de la loi Sapin 2, les tribunaux, et en particulier la Cour de cassation, ont joué un rôle essentiel dans l’interprétation et l’application de ce nouveau cadre légal. Leurs décisions dessinent progressivement les contours pratiques des immunités d’exécution et des pouvoirs du juge compétent en la matière, le Juge de l’Exécution (JEX).
A. Analyse des décisions jurisprudentielles clés post-loi Sapin 2
La jurisprudence postérieure à 2016 a confirmé la volonté du législateur de renforcer la protection des États. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2018 (Cass. 1re civ., 10 janv. 2018, n° 16-22.494, Rev. crit. DIP 2018. 315) a marqué un revirement important en appliquant immédiatement les nouvelles exigences de la loi Sapin 2, notamment la nécessité d’une renonciation « expresse et spéciale » pour les biens diplomatiques, y compris à des situations antérieures à la loi.
Plus récemment, une décision du 13 mars 2024 a apporté des précisions sur la distinction entre les fonctions d’une mission diplomatique et l’activité d’un chef d’État. La Cour a jugé qu’un aéronef affecté à la présidence de la République d’un État, n’étant pas directement utilisé pour une mission diplomatique au sens strict, ne nécessitait pas une renonciation « spéciale ». Une renonciation « expresse » suffisait. Ces décisions montrent une interprétation stricte mais pragmatique de la nouvelle version des textes, où chaque mot compte et où la finalité de l’utilisation du bien est analysée avec précision.
B. La compétence du juge de l’exécution (JEX) et les délais de contestation post-loi Sapin 2
La compétence du JEX est ici centrale, car c’est lui qui autorise les mesures et tranche les contestations soulevées par les États étrangers, un rôle qui s’ajoute à ses attributions générales en matière d’exécution forcée. Depuis la loi Sapin 2, le juge de l’exécution du tribunal de première instance de Paris (le tribunal judiciaire) détient une compétence juridictionnelle exclusive pour autoriser les mesures d’exécution sur les biens des États étrangers situés en France.
Lorsqu’une mesure est autorisée, l’État débiteur dispose de voies de recours pour la contester. La procédure se déroule initialement sur requête, donc de manière non contradictoire, et le non-respect des formes prescrites est sanctionné à peine de nullité afin de préserver l’effet de surprise. Une fois la mesure exécutée et notifiée, l’État peut former une contestation, puis un appel. Le délai pour agir est généralement d’un mois à compter de la dénonciation de l’acte de saisie – à ne pas confondre avec le délai de huit jours pour dénoncer certaines mesures au débiteur saisi en droit commun – un délai bref qui impose une grande réactivité. Les arguments soulevés par les États reposent quasi systématiquement sur la nature des biens saisis, en invoquant leur affectation à un service public non commercial ou leur lien avec une mission diplomatique.
IV. Stratégies et recours alternatifs pour les créanciers face aux immunités d’exécution
Face à l’obstacle de l’immunité, les créanciers doivent envisager des stratégies de recouvrement alternatives, car les procédures classiques comme la saisie-attribution ou la saisie immobilière peuvent s’avérer inopérantes. Le législateur a lui-même prévu des dispositifs spécifiques, notamment pour contrer certaines pratiques spéculatives, et la jurisprudence a ouvert une voie, certes étroite, pour engager la responsabilité de l’État français en cas de déni de justice.
A. La législation anti-fonds vautours (loi Sapin 2, article 60) et son impact
La loi Sapin 2 a introduit une disposition innovante pour lutter contre les « fonds vautours ». Ces fonds spéculatifs rachètent à bas prix des dettes d’États en difficulté financière pour ensuite engager des poursuites judiciaires et obtenir le remboursement de l’intégralité de la valeur nominale de la créance. L’art. 60 de la loi vise à mettre un frein à ces pratiques.
Ce mécanisme interdit à un créancier d’obtenir en France une mesure d’exécution forcée, ou autrement dit une saisie, s’il remplit plusieurs conditions cumulatives : la dette a été acquise alors que l’État était en défaut ou avait proposé une restructuration, l’acquisition a été faite à un prix manifestement disproportionné, et le créancier a refusé de participer aux efforts de restructuration de la dette. En pratique, ce texte rend très difficile, voire impossible, l’exécution en France de créances détenues par de tels fonds, protégeant ainsi les États en restructuration contre des poursuites agressives. Pour les créanciers ordinaires, ce dispositif n’a pas d’impact direct, mais il illustre la volonté de l’État français de réguler le marché de la dette souveraine.
B. La responsabilité de l’état français en cas d’impossibilité de recouvrement des créances
Lorsqu’un créancier, titulaire d’une décision de justice définitive, se trouve dans l’impossibilité absolue de la faire exécuter en France, par une vente forcée par exemple, en raison de l’immunité d’exécution d’un État étranger, une dernière voie de recours peut être envisagée : engager la responsabilité de l’État français. Ce recours se fonde sur la rupture de l’égalité devant les charges publiques.
La jurisprudence administrative admet que si l’application d’une coutume internationale (comme l’immunité d’exécution) cause à un particulier un préjudice « grave et spécial », celui-ci peut obtenir une indemnisation de l’État français. Les conditions sont strictes. Le préjudice doit excéder les aléas que tout créancier doit normalement supporter. Le droit français en la matière, notamment depuis des décisions du Conseil d’État de 2011, a montré une ouverture plus grande à l’indemnisation, mais chaque cas est examiné au regard de sa spécificité. Cette action en responsabilité complexe constitue une stratégie de dernier recours pour le créancier qui se trouve face à un déni de justice effectif.
La navigation dans le labyrinthe des immunités d’exécution des États étrangers requiert une expertise pointue et une analyse stratégique de chaque situation, que ce soit pour obtenir une ordonnance d’autorisation, gérer la relation avec un tiers saisi, ou contester une demande de mainlevée. Pour évaluer vos options et maximiser vos chances de recouvrement, notre cabinet d’avocats met à votre disposition son expertise en voies d’exécution internationales.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution (notamment les art. L. 111-1-1 à L. 111-1-3)
- Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite « Loi Sapin 2 »)
- Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961
- Convention des Nations Unies sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens du 2 décembre 2004
- Code civil (dispositions relatives à l’exécution des obligations)
- Code pénal (sanctions en cas de détournement d’objet saisi, art. 314-6)