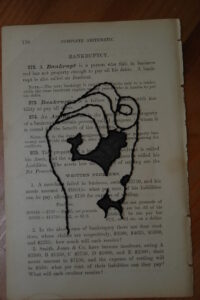Lorsqu’une entreprise traverse des difficultés financières menant à un redressement ou une liquidation judiciaire, une période critique s’ouvre : la période suspecte. Comme nous l’avons vu dans notre article d’introduction sur la période suspecte, certains actes passés pendant cette période sont si anormaux qu’ils sont automatiquement annulés par la loi (nullités de droit). Cependant, d’autres actes, tout à fait courants et valables en temps normal, peuvent eux aussi être remis en cause.
Il s’agit des nullités dites « facultatives ». Contrairement aux nullités de droit qui sanctionnent l’acte lui-même, ces nullités dépendent d’un élément subjectif : l’état d’esprit du partenaire de l’entreprise en difficulté au moment de l’opération. Si ce partenaire (créancier, fournisseur, client…) savait que l’entreprise était en état de cessation des paiements lorsqu’il a traité avec elle, l’acte peut être annulé par le tribunal. Cette possibilité d’annulation vise à protéger l’égalité entre les créanciers et à éviter que certains, mieux informés, ne profitent de la situation au détriment des autres. Explorer ces situations est essentiel pour comprendre les risques encourus par ceux qui continuent de faire affaire avec une entreprise dont la situation financière se dégrade.
La condition essentielle : la connaissance de la cessation des paiements
Le pivot des nullités facultatives réside dans la connaissance, par le cocontractant, de l’état de cessation des paiements du débiteur au moment précis où l’acte contesté a été accompli. Pourquoi cette connaissance est-elle si déterminante ? Parce qu’elle transforme un acte potentiellement anodin en une opération suspecte. Traiter avec une entreprise que l’on sait incapable de régler ses dettes exigibles avec son actif disponible peut laisser supposer une volonté de profiter de sa vulnérabilité ou de s’assurer un avantage indu avant l’ouverture d’une procédure collective.
Qu’entend-on exactement par « connaissance » ? Il ne s’agit pas d’une simple inquiétude ou d’une vague conscience des difficultés de l’entreprise. Les tribunaux exigent une connaissance effective de la situation de cessation des paiements elle-même. Une simple rumeur ou même la notoriété publique des problèmes financiers ne suffisent pas toujours à établir cette connaissance personnelle. Il faut que le partenaire ait eu une information suffisamment claire lui permettant de comprendre que l’entreprise ne pouvait plus faire face à ses échéances.
Cette connaissance doit exister au moment de la conclusion de l’acte (par exemple, la signature d’un contrat de vente) ou de son exécution (par exemple, la réception d’un paiement). Si le partenaire apprend la cessation des paiements seulement après avoir traité avec le débiteur, l’acte ne pourra, en principe, pas être annulé sur ce fondement.
La charge de la preuve repose sur celui qui demande l’annulation : généralement l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur. Comment prouver cet élément psychologique ? La preuve peut être apportée par tous moyens. Il s’agira souvent de rassembler un faisceau d’indices concordants. Par exemple :
- Des incidents de paiement répétés et non régularisés avant l’acte litigieux.
- Des lettres de relance insistantes ou des mises en demeure restées sans effet.
- Des négociations difficiles où la situation financière a été explicitement abordée.
- Des informations comptables précises communiquées au partenaire (bilans négatifs, etc.).
- Pour un banquier, la dénonciation d’un découvert, des refus de crédit répétés, le suivi attentif d’un compte ne fonctionnant plus normalement peuvent être des indicateurs.
- Pour un fournisseur principal, le fait de s’être renseigné activement sur la capacité de paiement de l’entreprise auprès d’autres créanciers peut jouer.
Attention cependant, certaines situations ne suffisent pas, à elles seules, à prouver la connaissance. La simple qualité d’associé ou même de dirigeant de la société cocontractante n’entraîne pas automatiquement une présomption de connaissance de la cessation des paiements de l’entreprise partenaire, même si cela peut constituer un indice parmi d’autres. Chaque situation est appréciée au cas par cas par les juges.
Les paiements de dettes échues par des moyens normaux
C’est sans doute le cas le plus fréquent de nullité facultative. En temps normal, recevoir le paiement d’une facture arrivée à échéance est parfaitement légitime. Cependant, si ce paiement intervient pendant la période suspecte et que le créancier qui le reçoit savait que son débiteur était en état de cessation des paiements, ce paiement, même effectué par un moyen usuel (virement, chèque encaissé, paiement en espèces dans les limites légales), peut être annulé par le tribunal.
La logique est toujours la même : le créancier informé n’aurait pas dû accepter ce paiement qui le favorise par rapport aux autres créanciers qui, eux, ne seront probablement pas payés ou seulement partiellement dans le cadre de la procédure collective. Peu importe la nature de la dette payée : il peut s’agir du remboursement d’un prêt, du paiement de loyers, de factures de fournitures, du remboursement d’un compte courant d’associé, ou même du paiement de salaires ou de cotisations sociales. Le fait que la créance ait été admise ultérieurement au passif de la procédure n’empêche pas l’annulation du paiement antérieur.
Une situation particulière concerne les effets de commerce (lettres de change, billets à ordre). Le paiement d’un effet de commerce à son échéance, même en période suspecte, échappe en principe à l’annulation directe pour protéger la sécurité des transactions cambiaires. Cependant, la loi prévoit un mécanisme spécifique : l’action en rapport (article L. 632-3 du Code de commerce). Si le tireur de la lettre de change (celui qui a donné l’ordre de payer), ou le premier endosseur du billet à ordre (celui qui l’a transmis en premier), ou le bénéficiaire du chèque (celui au nom duquel il est établi) avait connaissance de la cessation des paiements au moment de l’émission ou de la transmission de l’effet, l’administrateur ou le mandataire judiciaire peut lui réclamer de « rapporter » la somme perçue par le porteur final. L’action n’est pas dirigée contre celui qui a reçu le paiement final (le porteur), mais contre celui qui a initié l’opération en connaissance de cause. La preuve de la connaissance de la cessation des paiements s’apprécie de la même manière que pour les autres nullités facultatives.
Les autres actes à titre onéreux
Au-delà des paiements, tout acte conclu à titre onéreux pendant la période suspecte peut potentiellement être annulé si le cocontractant connaissait la cessation des paiements. Un acte « à titre onéreux » est un acte où chaque partie reçoit ou est censée recevoir une contrepartie de l’autre. Cela couvre une très large gamme d’opérations commerciales courantes :
- Une vente de matériel ou de marchandises (même si le prix est juste).
- Un contrat de prestation de services.
- La conclusion d’un bail commercial ou professionnel.
- Une transaction mettant fin à un litige.
- La constitution d’une garantie (hypothèque, nantissement…) pour une dette née en même temps que la garantie (contrairement aux garanties pour dettes anciennes qui relèvent des nullités de droit).
Ici encore, l’acte en lui-même n’est pas forcément anormal. C’est la connaissance de la situation précaire du débiteur par son partenaire qui rend l’opération suspecte aux yeux de la loi. Le tribunal dispose d’un pouvoir d’appréciation important. Il examinera les circonstances de l’opération pour déterminer si l’annulation se justifie, en tenant compte des intérêts en présence et de l’objectif de reconstitution de l’actif de l’entreprise débitrice. L’annulation, si elle est prononcée, entraînera des conséquences potentiellement lourdes pour le cocontractant, comme nous l’expliquons dans notre article sur la procédure et les effets des nullités.
Les mesures d’exécution forcée (saisies, etc.)
Avant la loi de sauvegarde des entreprises de 2005, les mesures d’exécution forcée pratiquées par un créancier pendant la période suspecte (comme une saisie sur compte bancaire) échappaient largement aux nullités. Cette situation était critiquée car elle permettait à un créancier diligent, et souvent informé de la situation, de se payer « par la force » au détriment des autres, rompant ainsi l’égalité.
Pour une analyse approfondie de l’impact des procédures collectives sur les saisies et sûretés spécifiques, notamment en ce qui concerne la nullité facultative de certaines mesures d’exécution forcée, nous vous invitons à consulter notre article dédié. La loi a corrigé cela en introduisant une nullité facultative spécifique pour certaines de ces mesures (article L. 632-2, alinéa 2 du Code de commerce). Désormais, peuvent être annulés :
- La saisie-attribution : C’est une procédure permettant à un créancier muni d’un titre exécutoire de saisir entre les mains d’un tiers (souvent une banque) les sommes dues à son débiteur. L’acte de saisie lui attribue immédiatement la somme. Si cette saisie est pratiquée pendant la période suspecte par un créancier qui connaissait la cessation des paiements, elle peut être annulée.
- L’avis à tiers détenteur (ATD ou SATD) : C’est une procédure similaire à la saisie-attribution, mais réservée principalement aux créanciers publics (Trésor public, organismes sociaux) pour le recouvrement de leurs créances (impôts, cotisations…). Il est soumis à la même règle d’annulation facultative si l’administration connaissait la cessation des paiements lors de sa notification.
- L’opposition : Ce terme est plus ambigu. Il ne s’agit pas de l’opposition en tant que voie de recours. Il pourrait viser certaines procédures spécifiques où un créancier forme opposition au paiement d’une somme par un tiers à son débiteur, comme l’opposition au paiement du prix de vente d’un fonds de commerce (article L. 141-14 du Code de commerce) ou les oppositions formées par les créanciers sociaux ou fiscaux (proches de l’ATD). L’idée générale reste la même : empêcher une mesure qui bloquerait ou détournerait des fonds au profit d’un créancier informé pendant la période suspecte.
Pour toutes ces mesures, l’annulation n’est pas automatique. Elle est laissée à l’appréciation du tribunal, qui devra vérifier si le créancier poursuivant avait effectivement connaissance de la cessation des paiements au moment où la mesure a été pratiquée.
Cas particulier : les actes juste avant la période suspecte
Le législateur a une méfiance particulière envers certains actes qui appauvrissent l’entreprise, même s’ils sont réalisés alors que celle-ci n’est pas encore, techniquement, en cessation des paiements. C’est pourquoi il a prévu une possibilité d’annulation facultative pour deux types d’actes s’ils sont accomplis dans les six mois précédant la date qui sera finalement retenue comme étant celle de la cessation des paiements (article L. 632-1, II du Code de commerce).
Il s’agit :
- Des actes à titre gratuit : Les mêmes actes gratuits (donations, etc.) qui seraient automatiquement nuls s’ils étaient faits pendant la période suspecte peuvent être annulés facultativement s’ils sont faits dans les six mois avant. L’idée est de pouvoir rattraper des libéralités excessives faites peu de temps avant la défaillance avérée.
- De la déclaration notariée d’insaisissabilité (DNI) : La possibilité pour un entrepreneur individuel de déclarer insaisissables ses biens immobiliers personnels non affectés à l’activité professionnelle est un outil de protection. Cependant, si cette déclaration est faite dans les six mois précédant la cessation des paiements, elle peut aussi être annulée par le tribunal. (Note : Depuis la loi Macron de 2015, la résidence principale est insaisissable de droit, rendant la DNI moins fréquente pour ce bien précis).
Pour ces actes antérieurs de moins de six mois, la condition de connaissance de la cessation des paiements par le bénéficiaire (donataire ou entrepreneur déclarant) n’est logiquement pas requise, puisque par définition, la cessation des paiements n’était pas encore survenue. Cependant, le caractère « facultatif » de la nullité signifie que le tribunal conserve une marge d’appréciation. Il tiendra compte des circonstances : la proximité de la date de cessation des paiements, l’importance de l’acte, la bonne ou mauvaise foi apparente des parties (le bénéficiaire pouvait-il soupçonner les difficultés imminentes ?).
Naviguer dans les méandres des nullités de la période suspecte demande une analyse attentive des faits et du droit. Si vous avez contracté avec une entreprise dont vous craignez la défaillance, ou si votre propre entreprise rencontre des difficultés, l’anticipation et le conseil juridique sont essentiels.
Pour une analyse personnalisée de votre situation et des risques liés à la période suspecte, notre équipe se tient à votre disposition.
Sources
- Code de commerce, article L. 632-1, II
- Code de commerce, article L. 632-2
- Code de commerce, article L. 632-3