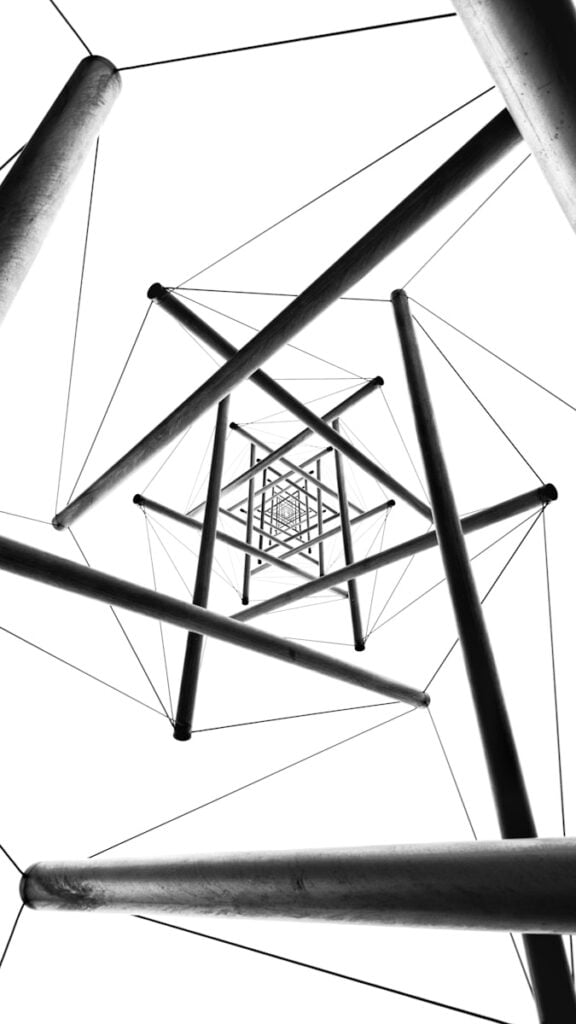L’engagement de caution pour le compte courant d’une entreprise est une garantie courante, souvent perçue comme une simple formalité par les dirigeants ou les proches qui la souscrivent. Cependant, lorsque l’entreprise rencontre des difficultés financières et fait l’objet d’une procédure collective, la situation de la caution devient subitement précaire. Loin d’être un simple engagement moral, cet acte déploie des effets juridiques rigoureux, souvent méconnus. Cet article a pour but de détailler les incidences spécifiques d’une procédure collective sur le cautionnement de compte courant, un mécanisme technique au cœur de nombreuses situations complexes. Pour une vision d’ensemble, vous pouvez consulter le guide complet du cautionnement de compte courant, qui pose les bases de cet engagement. Nous aborderons ici les interactions complexes entre le droit des sûretés et les règles générales encadrant le cautionnement en procédure d’insolvabilité.
Introduction : les incidences du régime des procédures collectives sur le cautionnement de compte courant
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire au bénéfice du débiteur principal bouleverse l’équilibre contractuel. La question centrale est de savoir dans quelle mesure la caution, garante de la dette de l’entreprise, est affectée par ce régime dérogatoire destiné à protéger et réorganiser le patrimoine du débiteur. Le principe de l’accessoire, qui veut que le sort de la caution soit lié à celui de la dette principale, se trouve confronté aux finalités propres du droit des entreprises en difficulté.
Le principe de non-décharge de la caution malgré la procédure collective du débiteur
Le principe fondamental est clair : le jugement d’ouverture d’une procédure collective ne libère pas la caution de son engagement. Cette solution est logique, car la finalité même du cautionnement est de garantir le créancier contre la défaillance du débiteur. Priver la garantie de ses effets au moment précis où elle devient utile la viderait de toute sa substance. La loi considère la protection accordée au débiteur (suspension des poursuites, arrêt du cours des intérêts, remises de dettes) comme une exception personnelle qui ne profite pas de plein droit à la caution. La procédure collective est un droit exorbitant du droit commun, favorable au seul débiteur principal. Par conséquent, sauf disposition légale expresse, le créancier conserve son droit d’agir contre la caution pour obtenir le paiement de la dette garantie.
La réforme de 2021 et ses clarifications pour la situation des cautions personnes physiques
L’ordonnance du 15 septembre 2021, portant sur la réforme de 2021 sur les sûretés et les procédures collectives, a apporté des clarifications importantes. Le nouvel article 2298, alinéa 2, du Code civil inverse la logique antérieure. Il dispose désormais que la caution ne peut pas se prévaloir des mesures légales ou judiciaires accordées au débiteur du fait de sa défaillance, sauf si une disposition spéciale en décide autrement. Cette nouvelle règle renforce la position du créancier. Cependant, une dérogation majeure existe précisément en droit des entreprises en difficulté. L’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit une suspension des poursuites à l’encontre des cautions personnes physiques, et ce, jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Cette protection spécifique, maintenue et confirmée, constitue une exception essentielle au principe de rigueur posé par la réforme.
La continuation du compte courant après l’ouverture de la procédure collective
L’ouverture d’une procédure collective n’entraîne pas automatiquement la clôture du compte courant. En vertu de l’article L. 622-13 du Code de commerce, les contrats en cours sont maintenus. La convention de compte courant, étant un contrat à exécution successive, se poursuit donc. Cette continuation a des conséquences directes sur l’engagement de la caution.
L’absence de révocation automatique du cautionnement et la liberté de résiliation
Puisque le compte courant est continué, le cautionnement qui en garantit le solde l’est également. L’ouverture de la procédure n’a aucun effet extinctif sur la garantie. La caution reste donc tenue des dettes nées après le jugement d’ouverture, dans la limite de son engagement. Toutefois, cette continuation ne prive pas la caution de ses droits. Si son engagement a été souscrit pour une durée indéterminée, elle conserve la faculté de le révoquer à tout moment. Cette révocation ne la libère pas des dettes nées antérieurement, mais met fin à son obligation de couverture pour l’avenir. La caution doit être vigilante et, si elle souhaite se désengager pour le futur, doit notifier sa décision au créancier sans tarder, en respectant les formes prévues par son contrat.
Le sort des intérêts : une exception de traitement entre débiteur et caution
C’est un point technique mais aux conséquences financières importantes. L’article L. 622-28 du Code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels à l’égard du débiteur. Cette mesure vise à geler le passif pour faciliter le redressement. Cependant, ce même article précise explicitement que cette suspension ne profite pas à la caution. Par conséquent, alors que le principal de la dette est gelé pour l’entreprise, les intérêts continuent de courir à l’encontre du garant. Cette différence de traitement illustre parfaitement la rupture du principe de l’accessoire au profit de la finalité du droit des procédures collectives. La caution peut ainsi se retrouver à devoir payer une somme supérieure à celle qui serait finalement due par le débiteur principal.
Les cas de révocation implicite du cautionnement : déviationnisme de l’imputation et changement d’identité
En dehors d’une révocation explicite, le cautionnement peut prendre fin de manière implicite dans certaines situations. L’une d’elles concerne ce que la doctrine nomme le « déviationnisme de l’imputation des remises ». Normalement, les sommes créditées sur le compte après le jugement d’ouverture devraient venir en déduction du solde antérieur, allégeant ainsi la dette de la caution. Cependant, la pratique et certaines décisions de justice ont admis que ces remises pouvaient être affectées en priorité au paiement des nouvelles dettes nées pour les besoins de la poursuite de l’activité. Un tel mécanisme, bien que favorisant le maintien de l’exploitation, a pour effet de figer l’engagement de la caution sur le solde au jour du jugement, la privant du bénéfice des remises. Un autre cas de cessation implicite est le changement substantiel dans l’identité du débiteur ou du créancier, comme une cession d’entreprise non prévue. L’engagement de caution étant consenti *intuitu personae*, une modification fondamentale de la personne du débiteur ou du créancier met fin à l’obligation de couverture pour l’avenir.
La cessation du compte courant dans le cadre des procédures collectives
Si la continuation du compte est le principe, sa cessation intervient fréquemment, notamment en cas de liquidation judiciaire. Cette cessation déclenche le processus de détermination de la dette finale de la caution.
L’arrêté d’un solde provisoire et le mécanisme du différé du compte
Au jour du jugement d’ouverture, la banque doit déclarer sa créance au passif de la procédure. Pour un compte courant, cette créance correspond au solde débiteur à cette date. Ce solde est toutefois « provisoire », car le compte n’est pas encore clôturé. Tant que le compte fonctionne, ce solde peut évoluer. Il faut également tenir compte du « différé » du compte, c’est-à-dire des opérations en cours qui n’ont pas encore été comptabilisées (chèques non encore débités, effets à l’encaissement). Ces opérations, bien qu’initiées avant le jugement, affecteront le solde et, par conséquent, l’obligation de la caution, même si leur traitement comptable est postérieur. La caution a donc tout intérêt à s’assurer que l’ensemble de ces opérations est correctement pris en compte pour la détermination de sa dette.
L’incidence de la contre-passation sur l’obligation de la caution
La contre-passation est l’opération par laquelle une banque inscrit au débit du compte de son client le montant d’un effet de commerce (traite, billet à ordre) qui a été crédité « sauf bonne fin » mais qui est revenu impayé. Si cette opération a lieu après la cessation de l’obligation de couverture de la caution mais avant la clôture du compte, elle peut augmenter le solde débiteur et donc l’engagement du garant. La jurisprudence admet cette possibilité, considérant que la contre-passation est la régularisation d’une opération antérieure. La caution doit donc savoir que son exposition n’est pas figée et que des impayés sur des effets remis avant la fin de sa garantie peuvent venir alourdir son obligation finale.
L’application de la théorie des coobligés et les singularités du droit des procédures collectives
La caution est un coobligé aux côtés du débiteur principal. Le droit des procédures collectives contient des règles spécifiques qui affectent sa situation. L’une des plus notables est la forclusion quinquennale introduite par l’article 2319 du Code civil. Ce texte prévoit que la caution d’un solde de compte courant ne peut plus être poursuivie cinq ans après la « fin du cautionnement ». Cette disposition vise à limiter dans le temps le risque pesant sur la caution, dont l’obligation de règlement pourrait autrement rester en suspens jusqu’à une clôture très tardive du compte. L’articulation de ce délai avec les règles de suspension des poursuites et d’interruption de la prescription en procédure collective est complexe. Elle nécessite une analyse attentive de chaque situation pour déterminer si l’action du créancier est encore recevable. Ces singularités montrent que le sort de la caution dépend d’une interaction entre plusieurs branches du droit, ce qui rend une expertise juridique indispensable.
La situation de la caution d’un compte courant face à une procédure collective est semée d’embûches et de subtilités techniques. Entre la continuation du compte, le sort des intérêts, les mécanismes de contre-passation et les délais de prescription spécifiques, les risques d’une aggravation inattendue de son engagement sont réels. Une analyse précise de l’acte de cautionnement et une compréhension fine des règles applicables sont indispensables pour défendre efficacement ses droits. Pour obtenir l’accompagnement par un avocat spécialisé en cautionnement et évaluer votre situation, contactez notre cabinet.
Sources
- Code de commerce
- Code civil