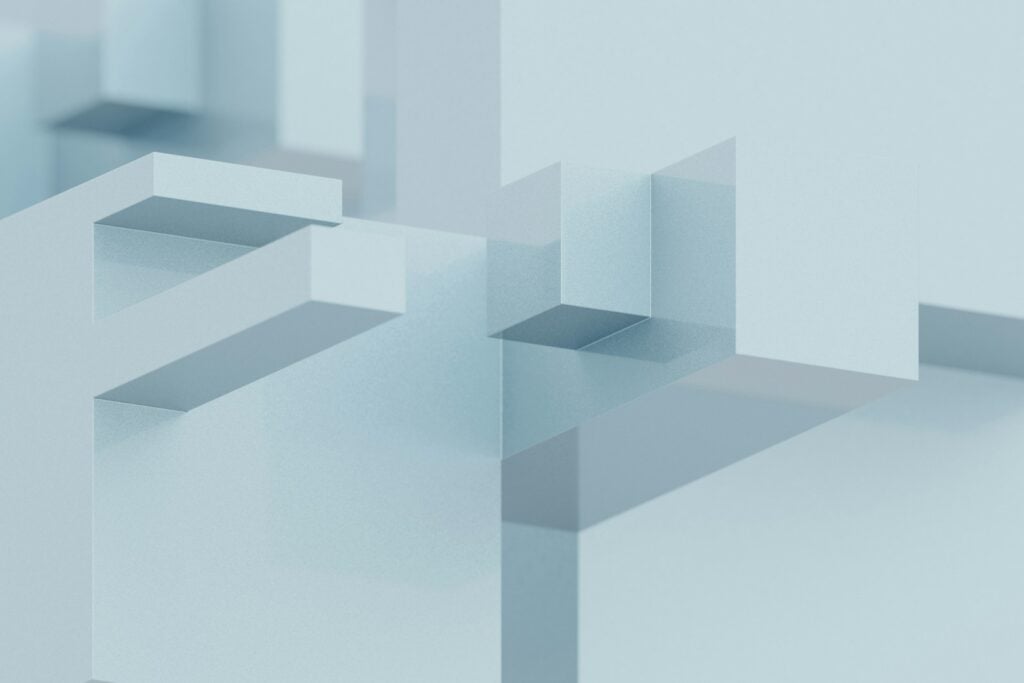Le terme « entente » évoque souvent des images de réunions secrètes où des concurrents s’accordent pour manipuler le marché. Si cette image n’est pas entièrement fausse, la réalité juridique est plus nuancée. Comprendre précisément ce que recouvre la notion d’entente anticoncurrentielle est essentiel pour toute entreprise souhaitant opérer en conformité avec le droit et éviter des sanctions potentiellement lourdes. L’article L. 420-1 du code de commerce pose le principe : sont prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Mais qu’implique réellement cette définition ? Quels sont les éléments constitutifs d’une entente au regard du droit français ? Cet article décrypte pour vous les composantes fondamentales de cette notion.
La nécessité d’un accord de volontés
Au cœur de la notion d’entente se trouve l’idée d’un concours de volontés entre plusieurs acteurs économiques. Il ne s’agit pas d’une décision unilatérale prise par une entreprise isolée, mais bien d’une forme de coordination, même minimale, entre au moins deux entités distinctes. Cet « accord » peut prendre des formes extrêmement variées. Il peut s’agir d’un contrat formel, écrit et signé, mais aussi d’arrangements beaucoup moins officiels : un accord verbal, une « pratique concertée » découlant d’échanges d’informations ou de réunions, voire une simple acceptation tacite d’une politique commerciale proposée par un partenaire.
La jurisprudence, tant française qu’européenne, a une conception large de cet accord de volontés. Il suffit que des entreprises substituent sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence. Peu importe la forme juridique ou le degré de formalisation, c’est la manifestation d’une volonté commune de ne pas agir de manière totalement indépendante sur le marché qui est recherchée. Cette approche large permet d’appréhender des comportements variés, allant du cartel structuré à des formes plus diffuses de coordination. Vous trouverez plus de détails sur la manière dont ces accords sont mis au jour dans notre article dédié à la preuve des ententes et les indices utilisés par les autorités.
Il est donc fondamental pour les entreprises de comprendre que même des discussions informelles avec des concurrents, si elles mènent à un alignement des comportements sur le marché (par exemple, sur les prix ou les stratégies commerciales), peuvent potentiellement être qualifiées d’entente. La simple participation passive à une réunion où des informations anticoncurrentielles sont échangées peut suffire à engager la responsabilité d’une entreprise, sauf si elle s’en distancie publiquement.
Qui peut conclure une entente ? La notion d’entreprise
L’article L. 420-1 du code de commerce s’applique aux accords conclus entre entreprises. La qualification d’entreprise est donc une condition préalable. Si pendant un temps la question a pu se poser, il est aujourd’hui admis que seules les entités ayant cette qualité peuvent participer à une entente. Mais qu’entend-on par « entreprise » en droit de la concurrence ?
La définition est fonctionnelle et très large, s’inspirant largement du droit de l’Union européenne : est considérée comme une entreprise toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique ou de son mode de financement. L’activité économique, quant à elle, s’entend de toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché donné.
Cela signifie que le droit des ententes ne se limite pas aux sociétés commerciales classiques (SA, SARL, SAS…). Peuvent également être qualifiées d’entreprises et donc être parties à une entente :
- Les personnes physiques : un entrepreneur individuel, un artisan, un professionnel libéral (médecin, architecte, géomètre-expert ) peuvent être considérés comme des entreprises pour leurs activités économiques.
- Les personnes publiques : l’article L. 410-1 du code de commerce précise que les règles s’appliquent aux activités de production, de distribution et de services, « y compris celles qui sont le fait de personnes publiques ». Des entreprises publiques comme la SNCF ou France Télécom (aujourd’hui Orange) ont ainsi pu être sanctionnées par le passé. Le fait qu’une entité poursuive une mission de service public ne l’exclut pas automatiquement du champ du droit de la concurrence pour ses activités économiques.
- Les organismes à but non lucratif : les associations, les syndicats professionnels, les ordres professionnels, les mutuelles ou encore les sociétés coopératives peuvent être qualifiés d’entreprises lorsqu’ils exercent une activité économique. Le caractère social ou non lucratif d’une partie de leur activité n’est pas un obstacle, dès lors qu’ils interviennent sur un marché concurrentiel (par exemple, les mutuelles sur le marché de l’assurance complémentaire santé ). Seules les activités relevant de la solidarité nationale pure, comme les régimes de base de sécurité sociale, échappent en principe à cette qualification.
- Les groupements d’intérêt économique (GIE) : un GIE peut être considéré comme une entreprise, mais aussi comme le vecteur d’une entente entre ses membres.
Cette conception très large de la notion d’entreprise montre la volonté des autorités d’appliquer les règles de concurrence à tous les acteurs participant à la vie économique, quelle que soit leur forme juridique ou leur objet social affiché.
L’exigence d’indépendance entre les entreprises
Pour qu’il y ait entente, il faut un accord entre des entités qui devraient être concurrentes, c’est-à-dire qui sont économiquement indépendantes l’une de l’autre. La question de l’autonomie est donc centrale.
Le droit des ententes n’a pas vocation à s’appliquer aux relations internes à un même groupe économique, lorsque les différentes sociétés qui le composent ne disposent pas d’une réelle autonomie de décision. Ainsi, un accord conclu entre une société mère et sa filiale détenue à 100% et qui ne fait qu’exécuter les instructions de la mère, n’est généralement pas considéré comme une entente. La filiale n’est pas vue comme une entité économique distincte et autonome, mais comme une partie de l’ensemble économique que constitue le groupe. La Cour de justice de l’Union européenne comme les autorités françaises considèrent que dans une telle situation, il n’y a qu’une seule volonté économique à l’œuvre.
La situation est identique pour des accords entre sociétés sœurs appartenant au même groupe et contrôlées par la même société mère, si elles ne disposent pas d’autonomie stratégique l’une par rapport à l’autre ou par rapport à la mère.
Cependant, cette immunité « intragroupe » n’est pas absolue. Elle cesse dès lors que la filiale dispose d’une autonomie réelle pour déterminer sa politique commerciale sur le marché. Comment apprécier cette autonomie ? Les autorités examinent au cas par cas plusieurs critères:
- Le pourcentage de détention du capital par la société mère (une détention de 100% crée une présomption forte de non-autonomie, mais elle n’est pas irréfragable).
- La capacité de la filiale à définir sa propre stratégie industrielle, financière et commerciale.
- Le degré de contrôle exercé par la mère sur les organes de direction de la filiale.
- L’existence d’instructions précises données par la mère à la filiale sur son comportement sur le marché.
Le simple fait qu’un directeur de filiale ait une délégation de pouvoir pour signer des contrats ou gérer le personnel n’est pas suffisant pour établir l’autonomie stratégique requise. C’est la capacité à agir indépendamment sur le marché qui compte. La distinction peut être subtile, mais elle est fondamentale car elle détermine si un accord relève du fonctionnement interne d’un groupe ou d’une potentielle entente anticoncurrentielle. Comprendre cette nuance est d’autant plus important lorsqu’on analyse la différence entre une entente par objet et une entente par effet.
Le cas spécifique des accords intragroupe dans les marchés publics
Pendant longtemps, une exception notable à l’immunité intragroupe existait en matière de marchés publics en France. L’ancien Conseil de la concurrence et la cour d’appel de Paris considéraient que même des entreprises non autonomes d’un même groupe pouvaient être sanctionnées pour entente si elles déposaient des offres distinctes et apparemment indépendantes lors d’un appel d’offres, sans informer l’acheteur public de leurs liens. L’idée était que cette pratique trompait l’acheteur sur l’intensité réelle de la concurrence. Présenter volontairement des offres séparées créait une « légitime croyance » dans leur indépendance.
Cette position française était isolée, car la jurisprudence européenne n’avait pas formellement consacré cette exception. Finalement, un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne de 2018 (« Écoservice projektai ») a clarifié la situation en jugeant que l’interdiction des ententes (article 101 TFUE) ne s’applique pas aux pratiques consistant, pour des entreprises liées d’un même groupe, à soumettre de façon coordonnée des offres distinctes en réponse à un appel d’offres, même si elles apparaissent indépendantes.
Suite à cet arrêt, l’Autorité de la concurrence française a aligné sa pratique. Désormais, le fait pour des filiales non autonomes d’un même groupe de déposer des offres coordonnées, même si elles semblent distinctes, lors d’un appel d’offres public, n’est plus considéré en soi comme une entente illicite, même si l’acheteur n’est pas informé des liens. Cela ne signifie pas pour autant que toute pratique d’un groupe dans un marché public est licite, mais la simple soumission coordonnée d’offres par des entités liées n’est plus automatiquement sanctionnable au titre des ententes.
La liberté du consentement
Pour qu’il y ait entente, il faut un concours de volontés libres. Une entreprise pourrait-elle échapper à la qualification d’entente si elle prouve qu’elle n’a pas librement consenti à l’accord, par exemple parce qu’elle a agi sous la contrainte ou la pression d’autres entreprises plus puissantes ?
En théorie, un consentement vicié pourrait remettre en cause l’existence même de l’accord de volontés. En pratique, cependant, les autorités de concurrence et les tribunaux se montrent extrêmement réticents à admettre de telles justifications. L’argument de la contrainte économique ou de la nécessité de « suivre le mouvement » pour survivre est très rarement accepté.
De même, invoquer le fait d’avoir participé à une entente pour se défendre contre les pratiques jugées illicites d’un concurrent (par exemple, un discounter agressif) ne constitue pas une excuse valable. La cour d’appel de Paris a ainsi jugé que le caractère potentiellement illicite des pratiques d’un opticien discounter ne justifiait pas que ses concurrents s’entendent pour l’exclure du marché.
La complicité d’un tiers, même s’il s’agit de l’acheteur public (le maître d’ouvrage) dans le cadre d’un appel d’offres truqué, n’exonère pas non plus les entreprises participant à l’entente de leur responsabilité.
En somme, pour être valide, l’accord de volontés doit exister entre des entreprises indépendantes et être le fruit d’un consentement qui, bien que pouvant être influencé par le contexte économique, n’est que très exceptionnellement considéré comme vicié au point de faire disparaître l’entente elle-même. Ces éléments constitutifs étant posés, il faut ensuite examiner si l’entente a un objet ou un effet anticoncurrentiel, et si elle ne pourrait pas, exceptionnellement, bénéficier d’une exemption légale.
La définition de l’entente repose donc sur des critères précis mais interprétés largement par les autorités. La vigilance s’impose pour toute entreprise dans ses relations avec ses concurrents, fournisseurs ou clients. Un simple échange d’informations peut parfois suffire à franchir la ligne. Connaître les contours exacts de ce qui constitue une entente est la première étape pour prévenir les risques. Pour une analyse plus globale des dangers et des mécanismes de contrôle, vous pouvez consulter notre article de synthèse sur les ententes anticoncurrentielles.
Si vous pensez être confronté à une situation qui pourrait s’apparenter à une entente, ou si vous souhaitez vérifier la conformité de vos pratiques commerciales, notre équipe se tient à votre disposition pour un accompagnement personnalisé.
Sources
- Code de commerce, notamment articles L. 410-1, L. 420-1
- Jurisprudence de l’Autorité de la concurrence, de la Cour d’appel de Paris, de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.