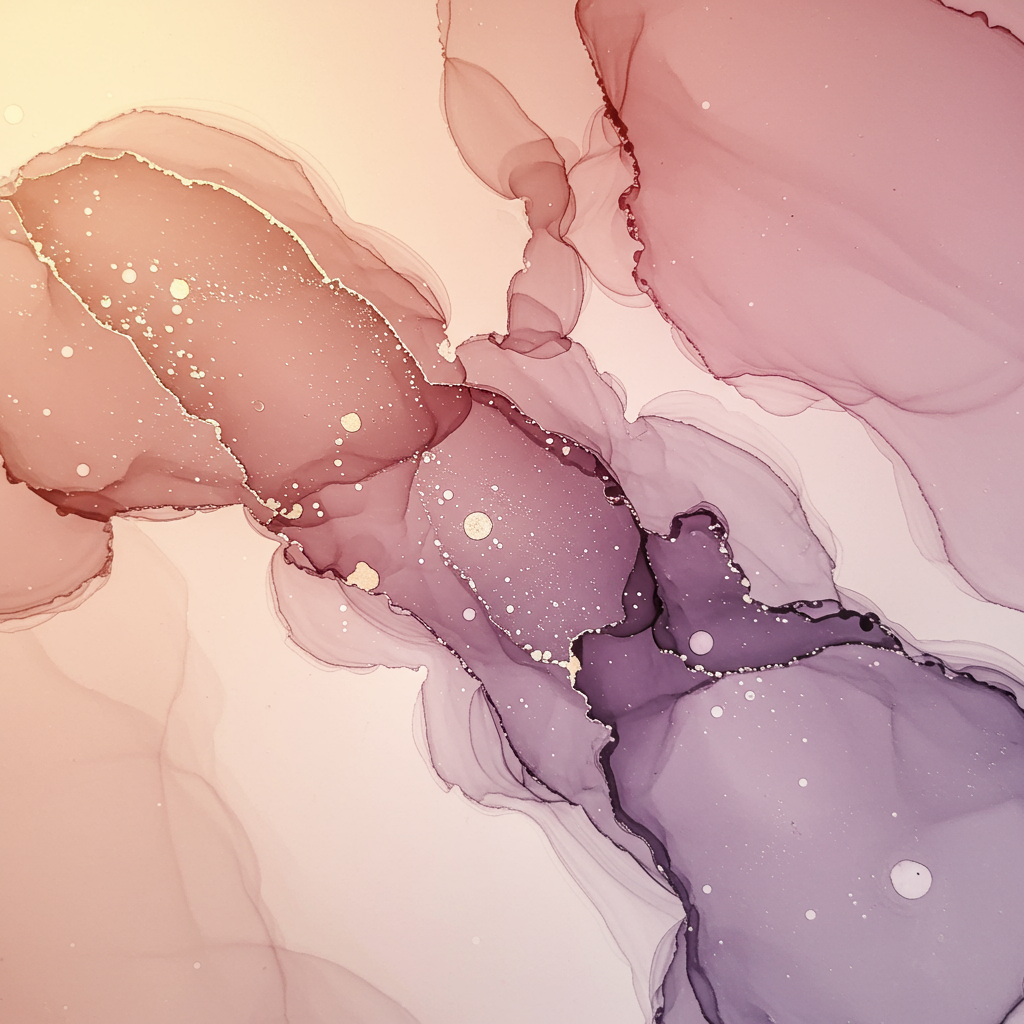La saisie-attribution constitue une procédure redoutable pour le recouvrement des créances. Ce mécanisme, instauré par la loi du 9 juillet 1991, permet au créancier muni d’un titre exécutoire d’obtenir le paiement immédiat de sa créance en saisissant les sommes dues à son débiteur par un tiers. Cet article détaille le formalisme rigoureux de la saisie-attribution ; pour une vue d’ensemble de son fonctionnement et de ses enjeux, consultez notre guide complet. Même avec un formalisme strict, la saisie-attribution peut présenter des pièges et des cas pratiques inattendus qu’il convient de maîtriser.
1. L’acte de saisie-attribution
Compétence exclusive du commissaire de justice
L’acte de saisie-attribution relève de la compétence exclusive des commissaires de justice (anciennement huissiers). Cette exclusivité découle de l’article L. 122-1 du Code des procédures civiles d’exécution (CPCE) qui réserve l’exécution forcée à ces officiers ministériels.
Un acte de saisie dressé par un clerc assermenté serait entaché de nullité, sans nécessité de prouver un grief. La Cour de cassation a confirmé cette règle dans un arrêt du 28 juin 2006 (n°04-17.514), rappelant que les procès-verbaux d’exécution sont exclus de la compétence des clercs.
La compétence territoriale du commissaire s’étend désormais au ressort de la cour d’appel de sa résidence, conformément au décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021.
Au regard de la complexité et de la rigueur exigées par cette procédure, l’accompagnement par un avocat spécialisé en saisie-attribution est souvent indispensable pour assurer la conformité et l’optimisation des chances de succès.
Contenu obligatoire de l’acte de saisie
- L’identification du débiteur (nom, domicile ou dénomination sociale)
- L’énonciation du titre exécutoire justifiant la saisie
- Le décompte détaillé des sommes réclamées (principal, frais, intérêts échus et provision)
- L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier
- La reproduction de plusieurs articles du code relatifs aux droits et obligations des parties
Une attention particulière doit être portée au décompte des sommes. Dans un arrêt du 23 février 2017 (n°16-10.338), la Cour de cassation a jugé que lorsqu’un créancier fonde sa saisie sur plusieurs titres exécutoires, il doit présenter un décompte distinct pour chacun.
La jurisprudence est stricte sur ce point, alors qu’elle fait preuve de plus d’indulgence concernant les erreurs de calcul, considérant qu’elles n’affectent pas la validité de l’acte.
Signification au tiers saisi
L’acte doit être signifié au tiers. Pour les établissements bancaires, la signification doit être faite au siège social ou à la succursale qui tient les comptes du débiteur (Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n°05-12.569).
Depuis le 1er avril 2021, l’article L. 211-1-1 du CPCE impose la transmission par voie électronique lorsque le tiers saisi est un établissement habilité à tenir des comptes de dépôt.
Dans le cas particulier d’une administration publique, l’acte doit être signifié au comptable public assignataire de la dépense (art. R. 143-3 CPCE). Une signification adressée à un autre service administratif serait frappée de nullité.
2. L’obligation de renseignement du tiers saisi
Étendue de l’obligation
Le tiers saisi doit fournir une déclaration complète et précise sur :
- L’étendue de ses obligations envers le débiteur
- Les modalités affectant ces obligations
- Les éventuelles cessions, délégations ou saisies antérieures
Cette obligation vise à permettre au créancier de connaître l’assiette exacte de sa saisie. En cas de compte bancaire, le tiers doit préciser la nature des comptes et leur solde au jour de la saisie.
Délai pour répondre
L’article R. 211-4 du CPCE exige une réponse « sur-le-champ ». Cette immédiateté a été interprétée strictement par certains tribunaux. Le TGI de Roanne (6 mai 1993) a jugé que cette expression « suppose une réponse immédiate et exclut tout délai si raisonnable soit-il ».
Une exception existe pour les comptables publics qui disposent d’un délai de 24 heures (art. R. 211-4, al. 3).
Motifs légitimes de non-réponse
- La signification à une personne dépourvue de connaissances juridiques (Cass. 2e civ., 28 janvier 1998, n°95-18.340)
- La nécessité de procéder à des vérifications complexes
- Une signification irrégulière (à domicile ou en mairie)
En revanche, ne constituent pas des motifs légitimes :
- L’absence de dirigeants lors du passage de l’huissier
- Des dysfonctionnements informatiques
- L’existence d’un litige entre le tiers et le débiteur
Sanctions en cas de manquement
- En cas d’absence de réponse sans motif légitime : le tiers peut être condamné au paiement des causes de la saisie, dans la limite de son obligation envers le débiteur.
- En cas de négligence fautive ou de déclaration inexacte/mensongère : le tiers peut être condamné à des dommages-intérêts.
Ces deux sanctions sont distinctes, comme l’a précisé la Cour de cassation dans plusieurs arrêts du 5 juillet 2000 (n°97-19.629 et n°97-22.407).
Pour que la première sanction s’applique, deux conditions cumulatives sont nécessaires : l’absence de réponse et l’existence d’une obligation du tiers envers le débiteur. Un tiers qui ne répond pas mais ne doit rien au débiteur ne peut être condamné qu’à des dommages-intérêts.
3. La dénonciation au débiteur
Délai de dénonciation
À peine de caducité, la saisie doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours (art. R. 211-3 CPCE). Ce délai commence le lendemain de la signification au tiers saisi. Pour une explication approfondie de ce processus, ses délais et mentions obligatoires, consultez notre article dédié sur la dénonciation de saisie-attribution.
S’agissant d’un délai de procédure, il expire le 8e jour à minuit, avec prorogation au premier jour ouvrable suivant si le terme tombe un samedi, dimanche ou jour férié.
La question reste ouverte concernant l’augmentation du délai à raison des distances pour les débiteurs domiciliés outre-mer ou à l’étranger. Par prudence, mieux vaut respecter le délai de huit jours.
Contenu obligatoire de l’acte de dénonciation
- Une copie du procès-verbal de saisie
- L’indication, en caractères très apparents, du délai d’un mois pour contester et de la date d’expiration de ce délai
- La désignation de la juridiction compétente
- Pour les saisies de comptes : l’indication du montant laissé à disposition du débiteur
La Cour de cassation est particulièrement vigilante sur l’indication du délai de contestation. Dans un arrêt du 2 décembre 2004 (n°02-20.622), elle a jugé qu’une erreur sur la date d’expiration faisait nécessairement grief au débiteur.
Signification de l’acte
Contrairement à l’acte de saisie, la dénonciation peut être signifiée par un clerc assermenté, car il s’agit d’un simple acte d’information et non d’un acte d’exécution (Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n°05-10.850).
La dénonciation doit être adressée au débiteur ou à son représentant légal. Dans le cas d’un majeur en curatelle, l’acte doit être signifié tant au majeur qu’à son curateur (art. 467 du Code civil).
Lorsque le débiteur fait l’objet d’une procédure collective, des règles spécifiques s’appliquent :
- En liquidation judiciaire : dénonciation au liquidateur
- En redressement judiciaire : dénonciation à l’administrateur si sa mission inclut la représentation du débiteur
- En sauvegarde : dénonciation au débiteur (sauf mission spécifique confiée à l’administrateur)
Caducité en cas de non-respect du délai
La sanction du non-respect du délai de huit jours est la caducité de la saisie. L’attribution de la créance est alors considérée comme non avenue.
Cette caducité produit un effet rétroactif total, privant le créancier saisissant de tout droit sur la créance saisie.
L’article L. 211-2, alinéa 4 du CPCE prévoit que « les saisies et prélèvements ultérieurs à la saisie […] prennent effet à leur date », permettant ainsi aux autres créanciers de bénéficier d’une saisie devenue caduque.
4. Le paiement par le tiers saisi
Au-delà des étapes formelles, la saisie-attribution produit des effets juridiques importants et ouvre des voies de contestation spécifiques.
Principe du paiement différé
Malgré l’effet attributif immédiat de la saisie, le paiement au créancier est différé pour permettre d’éventuelles contestations.
L’article R. 211-6 du CPCE prévoit que le tiers saisi procède au paiement sur présentation d’un certificat de non-contestation délivré par le greffe ou l’huissier après l’expiration du délai d’un mois suivant la dénonciation.
En cas de contestation, le paiement est suspendu jusqu’à la décision du juge.
Cas du paiement anticipé
L’article R. 211-6, alinéa 2 autorise un paiement avant l’expiration du délai si « le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie ». Cette déclaration doit être constatée par écrit.
Ce mécanisme, rappelé dans l’acte de dénonciation, présente un avantage pour le débiteur : en autorisant le paiement immédiat, il évite les intérêts qui continueraient à courir pendant le délai de contestation.
La Cour de cassation a précisé dans un avis du 11 mars 1994 que cette déclaration n’empêche pas une action ultérieure en répétition de l’indu fondée sur l’article L. 211-4 du CPCE.
Procédure en cas de refus de paiement
Si le tiers saisi refuse de payer malgré l’absence de contestation, l’article R. 211-9 du CPCE offre au créancier la possibilité de saisir le juge de l’exécution pour obtenir un titre exécutoire contre le tiers.
Cette procédure suppose une assignation devant le juge de l’exécution du lieu du domicile du débiteur, même si ce lieu est éloigné du domicile du tiers saisi.
En cas de défaut de paiement pour une autre raison, l’article R. 211-8 prévoit que le créancier conserve ses droits contre le débiteur principal, sauf si ce défaut est imputable à sa propre négligence.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution : articles L. 122-1, L. 211-1 à L. 211-5, L. 211-1-1, R. 211-1 à R. 211-23, R. 143-1 à R. 143-3
- Cass. 2e civ., 28 juin 2006, n°04-17.514
- Cass. 2e civ., 23 février 2017, n°16-10.338
- Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n°05-12.569
- Cass. 2e civ., 28 janvier 1998, n°95-18.340
- Cass. 2e civ., 5 juillet 2000, n°97-19.629, n°97-22.407
- Cass. 2e civ., 2 décembre 2004, n°02-20.622
- Cass. 2e civ., 12 octobre 2006, n°05-10.850
- TGI Roanne, 6 mai 1993
- Avis Cour de cassation, 11 mars 1994
- Décret n°2021-1625 du 10 décembre 2021
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991