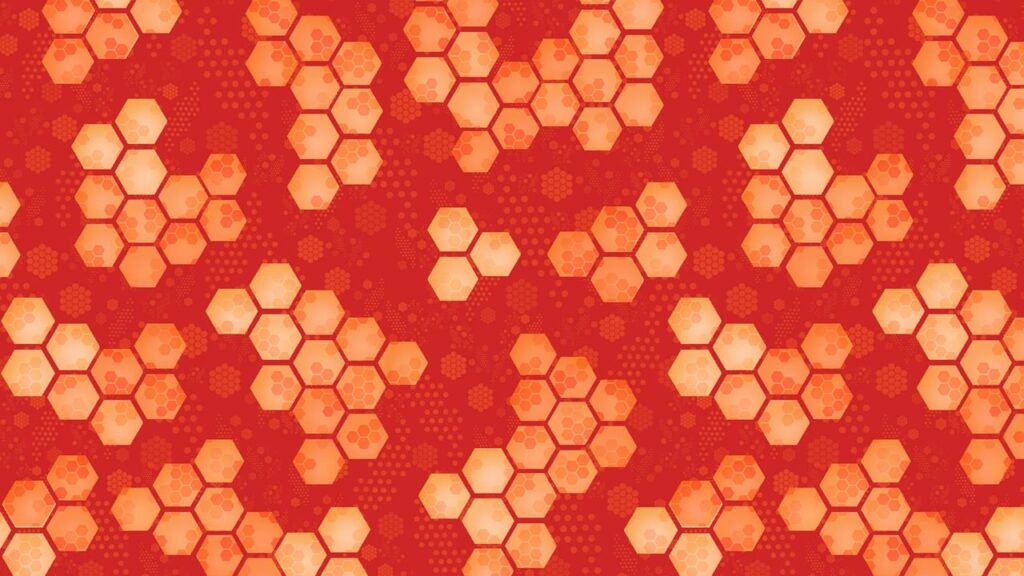La saisie-attribution, procédure d’exécution redoutable par son effet immédiat sur les créances, soulève des questions épineuses dans certaines configurations. Après avoir pris connaissance des fondements et du déroulement standard de la saisie-attribution, cet article propose un décryptage des situations qui méritent une attention particulière.
1. Saisie-attribution et procédures collectives
La relation entre saisie-attribution et procédures collectives est un domaine complexe qui fait l’objet d’une explication détaillée dans un article dédié.
Saisie antérieure au jugement d’ouverture
Une saisie-attribution signifiée avant l’ouverture d’une procédure collective résiste à cette dernière. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution est clair : « La survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution.«
La Cour de cassation l’a confirmé en chambre mixte le 22 novembre 2002 (n° 99-13.935). L’effet attributif immédiat protège le créancier, même pour les créances à exécution successive comme des loyers.
Effets du jugement d’ouverture sur la dénonciation
La situation devient plus complexe quand le jugement d’ouverture intervient après la signification au tiers saisi mais avant la dénonciation au débiteur.
Si le jugement survient dans le délai de huit jours imparti pour la dénonciation, celle-ci doit être faite au mandataire judiciaire en cas de dessaisissement du débiteur. La Cour de cassation a jugé que « la saisie doit être dénoncée dans le délai de huit jours, à peine de caducité, au débiteur à la tête de ses biens, ou, dès la liquidation judiciaire, à son liquidateur » (Com., 4 mars 2003, n° 00-13.020).
En redressement judiciaire, la dénonciation dépend des pouvoirs conférés à l’administrateur :
- Mission d’assistance : dénonciation au débiteur et à l’administrateur
- Mission de représentation : dénonciation à l’administrateur seul
Conversion d’une saisie conservatoire en saisie-attribution
Si une saisie conservatoire a été pratiquée avant l’ouverture de la procédure collective mais n’a pas été convertie en saisie-attribution, elle ne pourra plus l’être après. Le gel des poursuites imposé par l’article L. 622-21 du Code de commerce s’y oppose.
En revanche, si la conversion a eu lieu avant le jugement d’ouverture, elle demeure efficace. Cette solution résulte d’un revirement notable de la Cour de cassation (Com., 10 décembre 2002, n° 99-16.603).
Saisie-attribution postérieure au jugement d’ouverture
La règle générale veut que toute voie d’exécution soit interdite après le jugement d’ouverture, selon l’article L. 622-21 du Code de commerce.
Exception : les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture peuvent faire l’objet d’une exécution forcée si elles demeurent impayées (art. L. 622-17 du Code de commerce). Le créancier titulaire d’une telle créance peut pratiquer une saisie-attribution.
2. Règles spécifiques pour certains tiers saisis
Saisie entre les mains d’un comptable public
Les saisies pratiquées entre les mains d’un comptable public obéissent à des règles particulières prévues aux articles R. 143-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Un formalisme renforcé s’impose :
- L’acte doit désigner la créance saisie (art. R. 143-2)
- La signification doit être faite au comptable assignataire de la dépense, à peine de nullité (art. R. 143-3)
- Le comptable doit viser l’original de l’acte de saisie (art. R. 143-4)
Le créancier peut demander à l’ordonnateur des renseignements pour identifier ce comptable (art. L. 143-1).
Saisie entre les mains d’un établissement bancaire
Depuis le 1er avril 2021, l’article L. 211-1-1 du Code des procédures civiles d’exécution impose la transmission électronique des actes aux établissements bancaires.
La saisie n’est valable que si elle est signifiée au siège de l’établissement ou à la succursale qui tient le compte (Civ. 2e, 22 mars 2006, n° 05-12.569).
L’acte rend indisponible l’ensemble des comptes pendant quinze jours ouvrables (art. L. 162-1), délai nécessaire au dénouement des opérations en cours.
Une protection minimale existe : le débiteur conserve une somme à caractère alimentaire (art. L. 162-2).
Saisie entre les mains d’un avocat ou d’une CARPA
Les fonds détenus par un avocat pour le compte de clients doivent être déposés à la CARPA (Caisse Autonome des Règlements Pécuniaires des Avocats).
La Cour de cassation considère que seule la CARPA a qualité de tiers saisi (Civ. 2e, 9 janvier 2003, n° 00-13.887). La saisie doit donc être signifiée à cette caisse et non à l’avocat.
Les sommes détenues par la CARPA sont souvent affectées, ce qui peut les rendre insaisissables. Pour une analyse complète des créances que la loi déclare indisponibles ou insaisissables, un article complémentaire est à votre disposition. Cette question a provoqué un contentieux important.
3. Cas des débiteurs à statut particulier
Débiteur sous mesure de protection
Le Code des procédures civiles d’exécution (art. L. 111-9) classe l’acte de saisie-attribution parmi les actes d’administration.
Pour le débiteur protégé, les règles varient selon la mesure :
- Sauvegarde de justice : le majeur conserve sa capacité, la saisie peut être dirigée contre lui
- Curatelle : signification au majeur et à son curateur (art. 467 du Code civil)
- Tutelle : signification uniquement au tuteur
La dénonciation suit les mêmes règles, un mineur non émancipé n’ayant pas capacité pour la recevoir.
Débiteur en indivision
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir les biens indivis (art. 815-17 du Code civil). Ils peuvent seulement agir sur la part revenant à leur débiteur après partage.
Un arrêt remarqué de la Cour de cassation du 15 mai 2019 (n° 18-12.779) a rappelé qu’il n’existe pas d’indivision entre usufruitier et nu-propriétaire. Un créancier de l’usufruitier peut donc saisir la valeur de l’usufruit sur le prix de vente du bien démembré.
Débiteurs mariés et régimes matrimoniaux
Pour les couples mariés, l’article 1413 du Code civil permet de poursuivre le paiement des dettes sur les biens communs.
Toutefois, l’article 1415 limite cette règle pour les emprunts et cautionnements : ils n’engagent que les biens propres et revenus de l’époux signataire.
En présence d’un compte joint, la saisie doit être dénoncée à chaque cotitulaire (art. R. 211-22). Cependant, le défaut de dénonciation au cotitulaire n’entraîne pas la caducité de la saisie (Civ. 2e, 7 juillet 2011, n° 10-20.923).
4. Situations transfrontalières
Principe de territorialité
La saisie-attribution obéit au principe de territorialité des voies d’exécution. La Cour de cassation considère que « est établi en France le tiers saisi, personne morale, qui soit y a son siège social, soit y dispose d’une entité ayant le pouvoir de s’acquitter du paiement d’une créance du débiteur saisi à son encontre » (Civ. 2e, 10 décembre 2020, n° 19-10.801).
On peut donc saisir les loyers d’un immeuble situé en France même si le propriétaire et le locataire sont étrangers.
Signification dans les collectivités d’outre-mer
Les articles 660 à 662 du Code de procédure civile prévoient un régime spécifique pour la signification des actes dans les collectivités d’outre-mer comme la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie.
L’huissier doit expédier l’acte à l’autorité compétente locale et adresser une copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au destinataire.
Ce régime ne concerne pas les départements d’outre-mer, qui suivent les règles métropolitaines.
Débiteur résidant à l’étranger
Si le débiteur réside à l’étranger, la compétence territoriale revient au juge de l’exécution du lieu d’exécution de la mesure (art. R. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution).
Le délai de dénonciation de huit jours pourrait théoriquement bénéficier d’une augmentation en raison de la distance (art. 643 à 645 du Code de procédure civile), mais cette solution reste discutée en doctrine. Pour éviter tout risque, mieux vaut respecter le délai de huit jours.
La signification internationale complique également la mention de la date d’expiration du délai de contestation dans l’acte de dénonciation, puisque cette date dépend de la remise effective de l’acte au destinataire.
Les règles européennes ou internationales de signification (Règlement CE n° 1393/2007 ou Convention de La Haye) viennent s’ajouter à ce dispositif.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution : articles L. 111-9, L. 143-1, L. 162-1, L. 162-2, L. 211-1-1, L. 211-2, R. 121-2, R. 143-1 à R. 143-4, R. 162-2, R. 211-22
- Code de commerce : articles L. 622-17, L. 622-21, L. 631-12, L. 641-9
- Code civil : articles 467, 815-17, 1413, 1415
- Code de procédure civile : articles 643 à 645, 660 à 662
- Cass. ch. mixte, 22 novembre 2002, n° 99-13.935
- Cass. com., 10 décembre 2002, n° 99-16.603
- Cass. com., 4 mars 2003, n° 00-13.020
- Cass. 2e civ., 9 janvier 2003, n° 00-13.887
- Cass. 2e civ., 22 mars 2006, n° 05-12.569
- Cass. 2e civ., 7 juillet 2011, n° 10-20.923
- Cass. 1re civ., 15 mai 2019, n° 18-12.779
- Cass. 2e civ., 10 décembre 2020, n° 19-10.801
Ces situations particulières, loin d’être anecdotiques, nécessitent une compréhension approfondie des mécanismes juridiques et une expertise pointue pour une gestion optimale. Au-delà de ces spécificités, la saisie-attribution recèle de nombreux pièges et cas pratiques qui méritent une analyse détaillée. Pour être accompagné efficacement dans ces dossiers complexes de saisie-attribution, il est conseillé de faire appel à un avocat spécialisé.