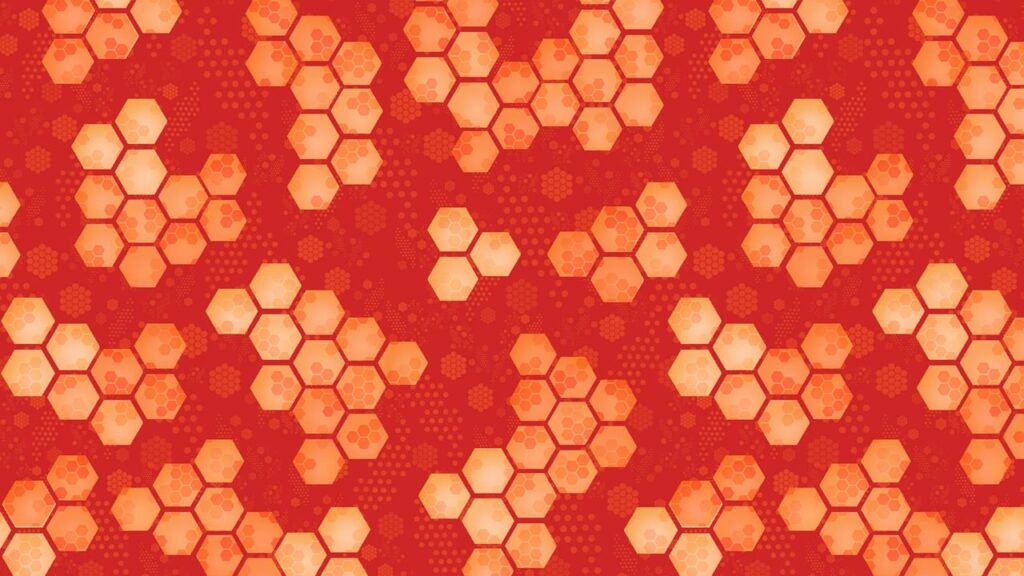La rencontre entre une procédure de saisie-attribution et l’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire, crée une zone de friction juridique majeure. Elle oppose le droit des voies d’exécution, qui vise à permettre à un créancier de recouvrer sa créance, et le droit des entreprises en difficulté, dont l’objectif est de préserver le tissu économique et l’outil de travail ou d’organiser une répartition égalitaire entre les créanciers. Pour une compréhension claire du mécanisme de la saisie-attribution avant d’explorer ses interactions avec les procédures collectives, consultez notre article de référence. Cet article a pour but de démystifier les règles complexes qui régissent la mise en œuvre et l’articulation de ces procédures et de clarifier le sort du créancier saisissant lorsque son débiteur fait l’objet d’une procédure collective.
Le principe de l’arrêt des poursuites individuelles par la procédure collective
La règle fondamentale posée par le droit des entreprises en difficulté est le gel des poursuites. Dès le jugement d’ouverture prononcé, un bouclier protecteur se met en place autour du patrimoine du débiteur, créant une indisponibilité générale de ses actifs. L’article L. 622-21 du Code de commerce est sans équivoque : il dispose que ce jugement « arrête ou interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ». Toute saisie-attribution pratiquée à l’encontre de la société débitrice postérieurement à cette décision serait donc frappée de nullité de plein droit, sans même qu’il soit besoin de prouver un grief, car elle violerait ce principe cardinal.
L’objectif de cette suspension est double. Il s’agit d’une part de préserver l’actif de l’entreprise en difficulté pour donner une chance à sa réorganisation ou, en cas de liquidation, pour maximiser les fonds à distribuer. D’autre part, cette règle garantit le traitement égalitaire des créanciers, en empêchant que certains, plus rapides et agissant individuellement, ne se fassent payer au détriment de la collectivité des autres créanciers, évitant ainsi une concurrence dommageable. L’action individuelle est remplacée par une discipline collective.
Toutefois, ce principe connaît une exception notable. Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, si elles sont nécessaires au déroulement de la procédure ou à la période d’observation, bénéficient d’un régime de faveur. L’article L. 622-17 du Code de commerce prévoit qu’elles doivent être payées à leur échéance. Si tel n’est pas le cas, leur titulaire peut engager des poursuites individuelles et donc, réaliser une saisie-attribution par le moyen d’un huissier de justice sans se voir opposer l’arrêt des poursuites. Cette mesure vise à encourager les partenaires de l’entreprise (toute personne morale ou physique) à continuer de contracter avec elle durant cette période critique.
Le sort de la saisie-attribution pratiquée avant l’ouverture de la procédure
La question centrale pour un créancier est de savoir ce qu’il advient d’une saisie qu’il a eu la diligence de pratiquer juste avant que son débiteur ne soit placé sous la protection du tribunal de commerce et de la justice. La loi apporte ici une réponse claire, qui constitue une dérogation majeure au principe de l’arrêt des poursuites.
L’effet attributif immédiat : un droit acquis pour le créancier saisissant
Une saisie-attribution pratiquée avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective conserve toute son efficacité. L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution établit que « la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remet pas en cause cette attribution. »
La raison de cette résistance tient à la nature même de la saisie-attribution et à son effet attributif immédiat, qui emporte un transfert de propriété. Dès la signification de l’acte de saisie au tiers saisi (par exemple, la banque du débiteur), la créance saisie sort instantanément du patrimoine du débiteur pour être attribuée de manière immédiate au profit du créancier saisissant. L’objet de la saisie change ainsi de propriétaire. C’est l’application combinée du Code de procédure civile et du Code civil qui fonde ce mécanisme. Par conséquent, au moment où la procédure collective est ouverte, le montant de la somme saisie n’appartient déjà plus au débiteur et ne fait donc plus partie du gage commun des créanciers. L’effet attributif immédiat de la saisie-attribution est le pivot de cette résistance ; ses effets et les voies de contestation sont explorés en détail dans notre guide sur ce mécanisme d’exécution forcée.
La Cour de cassation, dans un attendu de principe de sa chambre commerciale du 13 octobre 1998 (pourvoi n° 96-14.295), a confirmé cette logique en cassant la décision de la cour d’appel qui avait été attaquée. La créance ainsi attribuée n’a pas à être déclarée au passif de la procédure collective, puisqu’elle a déjà été payée par ce transfert de propriété. Le moment clé est donc la date de l’acte de saisie signifié au tiers, et non la date de sa dénonciation au débiteur saisi ou celle du paiement effectif.
Le cas particulier des créances à exécution successive
Le traitement des créances à exécution successive, comme un loyer ou une redevance, a généré un contentieux important. La question était de savoir si une saisie-attribution pratiquée avant le jugement d’ouverture pouvait continuer à produire ses effets pour les échéances futures, nées postérieurement à ce jugement. Le régime spécifique de la saisie-attribution des créances à exécution successive est souvent au cœur des litiges en procédure collective.
Dans une décision fondamentale du 22 novembre 2002 (n° 99-13.935, publiée au bulletin), la chambre mixte de la Cour de cassation, considérant la portée de l’effet attributif, a tranché en faveur du créancier saisissant. Elle a jugé que la saisie-attribution « poursuit ses effets sur les sommes échues en vertu de cette créance, après ledit jugement ». Ainsi, le tiers saisi (le locataire, par exemple) doit continuer de verser chaque loyer échu au créancier saisissant, et non au mandataire judiciaire, jusqu’au remboursement complet du montant de la créance cause de la saisie. Cette solution, confirmée depuis, constitue un avantage considérable pour le créancier qui a su anticiper les difficultés de son débiteur.
Il est essentiel de ne pas confondre la créance à exécution successive, qui naît d’un contrat unique (un bail), et les créances successives, qui découlent de contrats distincts se renouvelant dans le temps (des commandes régulières). Pour ces dernières, seule la créance existante au jour de la saisie est attribuée au créancier. Celles qui naîtront de contrats conclus postérieurement à la saisie tomberont dans le périmètre de la procédure collective.
La remise en cause de la saisie-attribution : la période suspecte
Même si une saisie-attribution a été pratiquée avant le jugement d’ouverture, elle n’est pas totalement à l’abri. Le droit des procédures collectives prévoit un mécanisme de contrôle des actes passés durant la « période suspecte ». Cette période s’étend de la date de cessation des paiements, qui peut être fixée par le tribunal jusqu’à 18 mois avant le jugement d’ouverture (période antérieure au jugement), jusqu’à ce jugement lui-même.
Les conditions de l’annulation de la saisie
La loi du 26 juillet 2005, et ses décrets d’application, a introduit une cause de nullité spécifique pour les saisies pratiquées durant cette période. Selon l’article L. 632-2 du Code de commerce, une saisie-attribution peut être annulée si deux conditions cumulatives sont réunies :
- Elle doit avoir été pratiquée après la date de cessation des paiements ;
- Le créancier saisissant devait avoir connaissance de cet état de cessation des paiements de la société au moment de la saisie.
La preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le créancier incombe à celui qui demande la nullité (l’administrateur, le mandataire ou le liquidateur judiciaire). Cette preuve est souvent difficile à rapporter, mais elle peut résulter d’un ensemble d’indices (refus de paiement antérieurs, demande de délais, courriers de relance infructueux, etc.). Il s’agit d’une nullité facultative ; un commentaire de la décision de principe (Cass. com., 12 janvier 2010, n° 09-11.119) souligne que même si les conditions sont remplies, le juge conserve un pouvoir d’appréciation et n’est pas obligé de la prononcer.
La compétence exclusive du tribunal de la procédure
Il est important de noter que cette action en justice, qui est une forme de contestation de la saisie sur un fondement particulier, ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, mais de celle du tribunal qui a ouvert la procédure collective. La Cour de cassation considère que cette contestation est « née de la procédure collective » et doit donc être traitée par le juge de cette procédure (Cass. com., 29 avril 2014, n° 13-13.572). Cette spécificité procédurale est importante à maîtriser pour le créancier qui verrait sa saisie contestée sur ce fondement.
La saisie conservatoire face à la procédure collective : une course contre la montre
Un créancier qui ne dispose pas encore d’un titre exécutoire peut prendre une mesure préventive : la saisie conservatoire. Celle-ci rend la créance indisponible, mais ne l’attribue pas au créancier. Pour obtenir paiement, il doit la « convertir » en saisie-attribution une fois le titre exécutoire obtenu. La réaction du créancier doit être rapide, car le timing de cette conversion est déterminant en cas de survenance d’une procédure collective.
L’importance de la conversion avant le jugement d’ouverture
Si la saisie conservatoire est convertie en saisie-attribution avant le jugement d’ouverture, elle produit son plein effet attributif, conférant ainsi une attribution immédiate de la créance. La créance est alors transférée au créancier saisissant et échappe à la procédure collective, tout comme une saisie-attribution classique. La jurisprudence est constante sur ce point (Cass. com., 10 décembre 2002, n° 99-16.603). Le créancier qui a pris la précaution d’une mesure conservatoire et qui agit rapidement pour obtenir un titre et réaliser la conversion de sa saisie sécurise ainsi sa position à son seul profit.
L’impossibilité de conversion après l’ouverture et ses conséquences
En revanche, la situation est radicalement différente si le jugement d’ouverture de la procédure collective à l’encontre de la société débitrice intervient avant que la conversion n’ait pu être effectuée. L’acte de conversion étant un acte d’exécution, il est paralysé par l’arrêt des poursuites individuelles (qui gèle aussi bien une saisie-vente qu’une exécution provisoire de jugement) dicté par l’article L. 622-21 du Code de commerce. La saisie conservatoire devient caduque et doit faire l’objet d’une mainlevée ; elle ne produit aucun effet. Le créancier perd le bénéfice de son antériorité et de sa diligence. Il se retrouve dans la même situation que les autres créanciers chirographaires et doit déclarer sa créance au passif de cette dernière, avec une chance de recouvrement souvent limitée.
Les obligations et la responsabilité du tiers saisi dans ce contexte complexe
Le tiers saisi, souvent une banque détenant le solde bancaire du débiteur, se trouve dans une position délicate. Si la saisie-attribution est valablement pratiquée avant l’ouverture de la procédure collective, le tiers saisi devient personnellement débiteur du créancier saisissant. Il a donc l’obligation de lui verser les fonds, même après le jugement d’ouverture, sur présentation du certificat de non-contestation. S’il versait les fonds au mandataire judiciaire, il s’exposerait à devoir payer une seconde fois, entre les mains du créancier saisissant. Sa seule issue, en cas de doute, est de consigner les sommes, par exemple via un commissaire de justice, en attendant que la situation soit clarifiée par le juge ou par un séquestre désigné.
L’articulation entre la saisie-attribution et les procédures collectives est un domaine juridique technique où chaque jour, voire chaque heure, compte. Une bonne connaissance de ces règles est fondamentale pour permettre à un créancier de protéger ses droits ou pour une entreprise en difficulté et ses organes de s’assurer du respect des principes d’ordre public.
Que le débiteur soit une société basée à Paris ou en province, les règles sont les mêmes, et leur application rigoureuse emporte des conséquences lourdes. Au-delà de ces interactions, la saisie-attribution peut également présenter d’autres situations particulières nécessitant une analyse experte. Face à de tels enjeux, l’assistance d’un avocat de qualité est une aide précieuse. Notre cabinet, dont vous trouverez les coordonnées sur ce site, vous propose un accompagnement juridique en matière de saisie-attribution, pour sécuriser vos droits et optimiser vos stratégies dans ces circonstances délicates.
Sources
- Code de commerce, notamment les articles L. 622-17, L. 622-21, L. 632-1 et L. 632-2
- Code des procédures civiles d’exécution, notamment les articles L. 211-1 à L. 211-5 et R. 211-1 à R. 211-23